L’observatoire des énergies – Novembre 2025

Sylvain HERCBERG
Une fois de plus, ces derniers mois ont été particulièrement riches pour ce qui concerne l’énergie. Les tendances lourdes sont à l’œuvre, cependant que l’on peut penser assister à un début de décantation, sans qu’il soit possible de conclure à l’émergence à court terme d’une situation plus stable aussi bien pour l’accès aux ressources que pour les orientations technologiques. Une profusion de décisions éclaire néanmoins les enjeux à court terme ainsi que les orientations à moyen terme comme à long terme : les tensions géopolitiques sont toujours l’un des facteurs majeurs liés à l’élaboration de la politique énergétique de la plupart des pays, et peuvent conduire à de nouvelles réalités pour l’exploitation des ressources, ainsi qu’à l’émergence de nouvelles alliances et de nouveaux rapports de force structurant des collaborations au sein de blocs en fonction, par exemple, des tensions et des avantages comparatifs ; il s’agit pour la plupart des pays de réduire l’exposition au risque énergie et de tirer parti de l’énergie comme levier d’action dans la compétition mondiale.
Rappelons quelques faits majeurs : la guerre entre Israël et l’Iran semble n’avoir pas entraîné de rupture majeure avec les tendances à l’œuvre ; la poursuite de la guerre entre l’Ukraine et la Russie conduit à l’annonce de sanctions nouvelles visant à limiter les exportations russes de gaz et de pétrole, notamment quand elles tirent parti de transits par des pays intermédiaires qui n’entendent pas changer de posture ou quand elles sont un moyen de pression sur des pays émergents souhaitant conserver une relation positive avec les États-Unis ; l’atteinte aux installations de raffinage des hydrocarbures reste une source d’inquiétude ; l’augmentation des primes d’assurance pour les flottes de pétroliers et de méthaniers est un fait.
Dans le même temps, la demande d’électricité augmente cependant que l’Agence Internationale de l’Énergie rappelle la baisse des coûts de production pour le photovoltaïque et les batteries, suscitant un intérêt rapidement croissant pour les renouvelables intermittentes du fait de la baisse des coûts pour le stockage en réseau de l’électricité ; à ce titre, il convient de signaler le bénéfice que pourraient en tirer les pays disposant d’une industrie des batteries, le Japon, la Corée du Sud et, bien entendu, la Chine dominante sur cette industrie, mais pas l’Union européenne pour le moment dépassée sur ce domaine au point que les usines en place ou en construction font appel à des technologies et des capitaux chinois ; cela aura-t-il un impact sur la sécurité d’approvisionnement de l’UE ? Et il convient de noter que la Chine et les États-Unis viennent de conclure un accord que l’on peut qualifier de trêve dans la compétition mondiale que se livrent ces deux pays : mais, à plus long terme, qui va contrôler les technologies clés et le raffinage des minéraux, sachant la vision à long terme en place en Chine, l’évolution de la demande d’électricité aux États-Unis, et l’incertitude sur les effets de politiques publiques de soutien dans ce pays ?
La récente négociation commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne a pour conséquence un accroissement massif de la dépendance européenne, mais soulève néanmoins quelques questions : comme on le signalait dans la publication du mois d’août, selon les données disponibles, les exportations énergétiques des États-Unis ont été en 2024 d’environ 330 milliards $, dont 80 milliards en direction de l’UE, principalement gaz naturel liquéfié ; l’UE a accepté d’importer pour 750 milliards $ sur 3 ans soit 250 milliards par an ; il en résulte quelques questions de fond : les États-Unis qui exportaient donc en dehors de l’UE pour 250 milliards $ en 2024 vont-ils pouvoir augmenter leur production de façon massive pour satisfaire l’ensemble de leurs marchés ? l’OPEP+ et les pays non-OPEP+ vont-ils y voir une opportunité à saisir rapidement ? comment vont réagir les fournisseurs « traditionnels » de l’UE ? comment comprendre l’inclusion du nucléaire dans les décisions des États-Unis ?
Une fois de plus, intérêts à court terme et enjeux à long terme s’entrechoquent sans que l’on puisse dire si une forme de cohérence est susceptible d’émerger, sachant l’approfondissement des préoccupations liées à la souveraineté des pays, tous dépendants, mais avec des intensités différentes, d’importations d’énergies primaires et de ressources minérales, ainsi que, pour l’activité économique, du prix des énergies finales. Cela est particulièrement vrai pour la France, où la PPE n’est toujours pas adoptée.
Et il convient de signaler la décision des États-Unis de ne pas envoyer une délégation de haut niveau à la COP30.
Pétrole, gaz, et fossiles
Pétrole
Le prix du pétrole semble se maintenir dans la zone 65 à 70 $ le baril, confirmant les fluctuations anticipées par plusieurs experts. La demande de pétrole reste stable du fait de la situation économique dans le monde et de l’impact de la transition énergétique, malgré la persistance du ralentissement dans plusieurs grands pays d’Asie, dont la Chine où le pic de la demande serait atteint en 2027 ; la demande augmenterait aux États-Unis et en Inde mais baisserait en UE. Reste l’impact possible dans la durée d’un prix bas, et demeure le potentiel que constituent les ressources dans plusieurs pays d’Afrique, en tenant compte toutefois des réticences des investisseurs.
Il convient ici de noter l’impact des décisions de l’OPEP+ et la difficile gestion du dilemme prix/quantités : la production va augmenter (137000 barils/jour en novembre), avec un possible excédent de 4 millions de barils/jour en 2026), conduisant à un risque de surproduction alors que la demande n’augmenterait que de 700000 barils/jour en 2026 quand la demande mondiale est de l’ordre de 105,5 millions de barils/jour ; la plupart des experts envisagent un prix soit stable soit en baisse légère, mais certains évoquent un prix nettement inférieur à 60 $ le baril à moins que l’augmentation du volume des stocks notamment en Chine n’amortisse ce qui serait un choc significatif. L’inde et la Chine seraient les principaux bénéficiaires d’un prix bas.
A noter que la production de gaz et de pétrole non conventionnel aux États-Unis est touchée par cette baisse des prix : baisse des profits, baisse des investissements, diminution des emplois. A noter également une possible mais faible augmentation des coûts de production du fait de la baisse de rendement des gisements en exploitation. Cette situation engendre des tensions au sein du cartel dont les membres souhaitent préserver leurs parts de marché et hésitent à mettre en exploitation de nouveaux gisements faute de rentabilité. Pour le moment, la gestion de ces contradictions semble fonctionner, mais plusieurs sujets d’intérêt apparaissent : l’évolution de l’Arabie si la baisse des prix a un impact négatif sur les ressources qu’elle entend dégager pour la diversification et le développement de son économie, l’effet du retour des majors en Libye, la négociation entre les États-Unis et les BRICS sur les taxes à l’importation, le positionnement des producteurs non-OPEP+ (Brésil, Canada, Argentine, Guyana), le futur de la relation politique entre les États-Unis et l’Arabie qui y investit massivement. Objectifs et intérêts sous-tendent les décisions : gêner la Russie, conforter les accords avec l’Arabie saoudite et les pays du Golfe pour leurs investissements aux États-Unis, maîtriser le coût des produits pétroliers pour les consommateurs américains, maintenir la rentabilité des compagnies américaines. A noter la vente d’actifs russes situés hors Russie à des acteurs suisses.
Pour résumer, le risque de surproduction est réel, comme l’enjeu du prix d’équilibre ; ce qui limiterait les capacités d’investissement pour un temps et conduirait les pays importateurs à faire évoluer les quantités en provenance de leurs différents fournisseurs. Et cela largement surdéterminé par les conséquences de la guerre au Proche-Orient et par les décisions concernant la Russie. Le pilotage va être de plus en plus délicat pour tous les acteurs.
Gaz
Le prix du gaz est sur une tendance à la hausse, et la demande pourrait, selon Exxon, augmenter de 20% d’ici 2050, tirée en grande partie par la production d’électricité dans des centrales à cycle combiné notamment en Asie et aux États-Unis. Le marché et les mouvements de quantités évoluent en fonction des atouts détenus ou non. Les bénéficiaires pourraient être le Qatar, les Émirats et l’Australie.
Plusieurs faits sont à noter : la poursuite d’une augmentation significative de la production du Léviathan pour répondre à la demande de l’Égypte ; la volonté de la Chine de développer sa consommation, en s’approvisionnant peut-être davantage dans le cadre de la BRI ; la volonté du Canada de développer massivement sa production pour sa consommation intérieure, pour les exportations et pour la gestion des tensions avec les États-Unis, et son objectif de devenir le deuxième exportateur mondial à l’horizon 2050 ; le nouveau gazoduc entre la Russie et la Chine dans le cadre des accords signés récemment à Beijing ; le débat au Royaume-Uni sur la reprise des investissements en Mer du Nord en échange d’une baisse des taxes ; le soutien de la Banque mondiale au financement des énergies fossiles (rappelons que les États-Unis ont un poids de 16% dans les votes à la Banque).
Aux États-Unis, la demande augmente du fait de la demande d’électricité due à la multiplication des centres de calcul et de stockage des données ; les projets d’extraction sont nombreux, mais plusieurs projets en Alaska ont été abandonnés car trop chers. La position majeure des États-Unis est confortée malgré les inquiétudes des compagnies gazières dues aux taxes et à la possible opposition du Président à l’utilisation de méthaniers chinois ou fabriqués en Chine. L’exportation dynamise le secteur, que ce soit vers l’Inde ou vers l’UE.
Pour ce qui concerne l’UE, l’avenir est maintenant pour partie inscrit dans le cadre de l’accord commercial avec les États-Unis, qui étaient déjà le principal fournisseur de gaz à l’UE (45% en 2024). La fin des importations de gaz russe qui ont été massives en 2024 se rapproche (fin du transit via l’Ukraine, capacité insuffisante pour transiter par la Turquie), la Hongrie, la Slovaquie et l’Autriche restant les principaux importateurs de gaz russe. La reconstitution des stocks en prévision du prochain hiver se poursuit (100 milliards € en 2024), alors que le monde est incertain et la compétition entre acheteurs intense. La Norvège et le Qatar restent des sources majeures pour l’UE, encore faut-il voir quel impact aura l’accord signé avec les États-Unis ; le prix du gaz va probablement avoir un impact sur le prix de l’électricité, et donc renforcer les contraintes sur la compétitivité de l’industrie ; une fois de plus, le marché de l’électricité et ses règles sont un sujet majeur : qu’en est-il des recommandations du rapport Draghi ?
Charbon
Rien de nouveau pour ce qui concerne le charbon : la demande semble relativement stable, susceptible d’entraîner une baisse des prix. La production d’électricité avec des centrales à charbon reste croissante malgré les annonces concernant la réduction des émissions de CO2, et de nouvelles mines sont ouvertes ; la Chine entend réduire la production d’électricité dans des centrales à charbon, mais la construction de nouvelles centrales reste au plus haut. L’Inde, de son côté, va vers une augmentation de l’extraction pour alimenter des centrales électriques et la demande de l’Indonésie est en augmentation. Selon l’AIE, la consommation de charbon devrait se stabiliser au niveau élevé atteint aujourd’hui du fait de l’augmentation en Asie et aux États-Unis, malgré la sortie du charbon de quelques pays comme l’Irlande.
Le captage et le stockage du carbone sont de nouveau évoqués mais les projets au Royaume-Uni sont abandonnés car trop chers, et les États-Unis ne s’y intéressent plus : les subventions du DOE baissent, et le prix sur le marché du CO2 est trop bas pour être incitatif. Quant au captage dans l’air, il est estimé bien trop cher et trop lent à mettre au point.
Maîtrise du changement climatique et marché du CO2
Les émissions de gaz à effet de serre sont là plus que jamais : 39 Gt CO2 en 2023 (+ 1,5% par rapport à 2022) malgré les mesures incitant à développer les installations bas carbone et la diminution des pertes dans le secteur de l’électricité ; les analyses de cycle de vie montrent le poids important des opérations d’extraction et de transport des ressources fossiles.
Les dernières phases de la préparation de la COP30 se déroulent dans un climat heurté : les émissions de CO2 augmentent, notamment dans plusieurs États membres de l’UE et dans les grands pays d’Asie ; financiers et banquiers manifestent leur inquiétude du fait des conséquences des effets du changement climatique (sécheresses, inondations) sur le PNB. A noter la présence réduite et de « bas niveau » des États-Unis qui accentuent leur pression pour modifier les objectifs de réduction des pays émergents, la volonté de réduction des émissions de la Chine, l’absence de réaction opérationnelle de l’UE à la sortie des États-Unis des accords internationaux alors que les discussions se poursuivent sur la cible 2040 et sur le point de passage en 2035 ainsi que sur un possible changement des règles en UE afin de les simplifier pour les entreprises (on évoque la suppression de taxes pour la sidérurgie et la métallurgie). A noter également les débats désormais classiques sur les outils économiques où sont notamment évoqués la bonne façon d’investir, l’importance des choix technologiques et les soutiens nécessaires pour l’arrivée à maturité des technologies en développement, le fonctionnement d’un possible marché mondial du CO2 tenant compte des spécificités nationales et intégrant l’apport possible des acteurs privés et des secteurs industriels.
Une convergence pourrait émerger entre les recommandations de l’UE, dont la crédibilité est selon certains en jeu, et celles de la Chine, sans que l’on puisse encore en être sûr ; les discussions se poursuivent donc sur les technologies ad hoc, sur le coût des actions et leur financement, ainsi que sur la crédibilité de l’objectif de réduction de 1,5°C.
L’électricité et le nucléaire
L’électricité est le vecteur énergétique de demain ; la demande liée aux data centers, à l’IA et à l’air conditionné se compte en centaines de TWh. Et il ne faut oublier ni l’industrie ni la mobilité électrique. La demande mondiale a augmenté de 4,3 % en 2024, soit plus que le PIB qui a augmenté de 2,2%.
Dans les pays du Proche-Orient et du nord de l’Afrique, elle devrait augmenter de 40% d’ici 2035 avec un recours accru aux centrales à gaz et aux renouvelables ainsi qu’au nucléaire, et la nécessité de développer le réseau de plus de 50%.
Plus que jamais, le prix de l’électricité est un sujet majeur notamment en Europe et il convient de se souvenir du rapport Draghi qui mentionne de façon sous-jacente et de façon explicite la nécessité de s’intéresser au coût complet du MWh qui se concrétise par le prix payé par le consommateur ; selon certains experts, le moment est venu de réfléchir au devenir du marché européen de l’électricité pour intégrer, dans un souci d’optimisation, toutes les composantes du coût, y compris le réseau et le backup des renouvelables intermittentes, et le développement de la production dans la longue durée pour satisfaire la demande ; et ne pas négliger l’impact des subventions aux renouvelables intermittentes ou les taxes. La compétitivité européenne est l’enjeu majeur, l’anticipation et la visibilité sont indispensables.
Des mesures seulement partielles sont décidées dans plusieurs pays européens, par exemple :
Royaume-Uni : abandon du projet de câble Maroc-Royaume-Uni ; abandon de la tarification zonale ; maintien des ambitions pour l’éolien avec un prix garanti par le gouvernement, développement du réseau pour intégrer la production éolienne maritime en particulier écossaise (24 milliards £ ont été décidés pour développer le réseau dans le cadre des 80 milliards £ approuvés pour 5 ans et qui seront répercutés sur les prix) ; possible remise sur les prix aux industriels pour relever le défi des concurrences française et allemande ; montée de l’intérêt pour le stockage en réseau de la production renouvelable intermittente, malgré l’incertitude sur sa pertinence économique.
Allemagne : proposition d’une subvention européenne pour soutenir les électro-intensifs ; abandon du projet de réduction des taxes sur l’électricité du fait des contraintes budgétaires.
Pays-Bas : montée de l’intérêt pour l’effacement faute de réseau à la bonne dimension malgré le prix élevée du MWh.
Il en est de même aux États-Unis où le prix de l’électricité augmente deux fois plus vite que l’inflation et où des besoins d’investissement sont diagnostiqués sur toute la chaîne de valeur, notamment le réseau : développement des interconnexions alors que la demande devrait augmenter de 25% entre 2023 et 2030, évolution des aspects réglementaires sous l’impulsion du DOE et de la FERC ; les besoins de financement y sont massifs d’où une réflexion sur l’organisation du marché, sur le prix, et sur le développement de contrats à long terme, et tout cela en fonction de la régulation propre à chaque État. La production à partir de fossiles et du nucléaire devrait se développer et les décisions du gouvernement conduisent à une division par 2 du développement des renouvelables intermittentes.
Nucléaire
Le nucléaire doit prendre toute sa place ; études et déclarations portent sur les enjeux et les efforts à faire sur tous les maillons de la chaîne de valeur, de la ressource en uranium au MWh. L’AIEA considère que la capacité nucléaire mondiale pourrait doubler d’ici 2050, notamment avec l’appel aux SMR.
Les annonces sont de plus en plus nombreuses :
Belgique : sortie de la sortie du nucléaire ; montée de la coopération avec la France
Manifestation d’intérêt de la Grèce et des États baltes
Projets de SMR en Finlande
Annonces en Suède (SMR), en République tchèque (SMR) et en Bulgarie
Lancement des études concrètes en Pologne (14 milliards $, avec la fourniture de réacteurs par les États-Unis et le soutien de l’US Export Bank) avec 2036 comme objectif pour une première mise en service
Italie : le débat sur l’intérêt du nucléaire est ouvert
Royaume-Uni : évaluation des options possibles pour le financement des SMR ; accord avec les États-Unis conclu lors de la visite du Président des États-Unis (SMR, possible développement par les compagnies électriques et les industriels électro-intensifs) ; horizon est dégagé pour les 2 EPR de Sizewell C : décision du gouvernement d’apporter 14 milliards £ soit 17 milliards € (47,5%), apport de Centrica (15%), de Brookfield (25%) et d’EDF (12,5%) ; par ailleurs un apport de private equity est décidé pour HPC2
États-Unis : approfondissement du débat sur le financement du nucléaire avec un possible appel au Japon pour sécuriser les investissements et maîtriser les risques pour les investisseurs ; projets de centrales par les électro-intensifs, notamment dans le numérique et l’IA ; développement de la propulsion nucléaire pour bateaux ; construction d’AP1000 au Canada voire en Afrique du Sud ; l’importance du nucléaire est confirmée avec l’objectif de leadership mondial, d’où l’effort pour retrouver la maîtrise de tous les maillons et l’effort à faire en R&D pour les SMR et les AMR sous la responsabilité du DOE et du DOD, et la réflexion sur les aspects réglementaires (possible fast tracking pour les licences de SMR). Il s’agit de tripler le parc de production pour disposer de 300 GW en 2050 ; Cela nécessite pour les États-Unis de disposer d’uranium et de capacités d’enrichissement pour s’affranchir de la Russie. Et cela nécessite de disposer du financement nécessaire, d’où la possibilité de subventions
Inde : mise en place d’un nouveau cadre institutionnel pour attirer l’investissement privé, en visant une capacité de 22 GW en 2032 et de 100 GW en 2047 contre 8 GW aujourd’hui
Hongrie : à suivre l’opposition de l’UE à l’achat d’équipements russes
Japon : retour du débat sur l’intérêt du nucléaire qui pourrait s’appuyer sur des SMR
La Chine vise une capacité de 110 GW en 2030 et a décidé la construction de 11 nouveaux réacteurs répartis sur cinq sites
La Corée du Sud a commencé la construction d’un nouvel APR1400 et entend se positionner sur les projets décidés dans le monde, en particulier en UE
L’UE considère possible un parc de 110 GW en 2050 mais des doutes persistent sur l’allongement de la durée de vie opérationnelle à 60 ans et plus
Les SMR sont maintenant bien présents dans les débats : discussions sur le choix des technologies, préparation des licences, …
Et le combustible devient un enjeu d’importance alors que le prix spot de l’uranium augmente ; selon la WNA, les besoins vont augmenter de 30% d’ici 2030 et doubler voire plus d’ici 2050, d’où la nécessité d’investir et d’établir une perspective à long terme.
Il est clair que la compétition entre les fournisseurs de réacteurs qui s’intensifie va durer. Ainsi Westinghouse pourrait tirer parti d’une commande de 10 réacteurs rien qu’aux États-Unis, mais des doutes se manifestent sur sa capacité à faire ; à noter la volonté de la Corée du Sud de se positionner sur les projets décidés dans le monde, en particulier en UE. Et il convient de rappeler que la Russie propose des projets pour répondre aux attentes par exemple en Afrique, en Turquie, au Vietnam, en Asie centrale, projets proposés avec le financement comme cela a été confirmé par le dernier Forum économique de Saint-Pétersbourg.
D’une façon générale, le financement est clé pour toute la chaîne de valeur ; baisser les coûts et réduire la durée de construction sont des enjeux majeurs, ce qui nécessite une vision de long terme sur la politique énergétique des pays intéressés, une visibilité suffisante pour les acteurs industriels et financiers, et une réglementation toujours rigoureuse et stable. Dans ce cadre, il convient de noter le retour de la Banque mondiale pour le soutien au nucléaire. Et il convient également de noter que l’ONU privilégie les renouvelables.
Vers la transition énergétique : poursuite de la montée des enjeux internationaux
La Chine et l’Inde pourraient être les principaux bénéficiaires de l’augmentation de la demande d’électricité, en particulier pour les équipements photovoltaïques ; la Pologne et l’Arabie envisagent un développement significatif du photovoltaïque. Plusieurs évolutions émergent : articulation de l’industrie du PV avec celle des batteries, bonne combinaison de la production intermittente et du stockage ; la Chine pourrait en être le bénéficiaire, d’autant plus que la fabrication de batteries en UE n’est pas à la hauteur des annonces faites et que, de plus, la présence des industriels chinois est réelle dans les investissements en cours aussi bien pour la production que le recyclage des batteries.
A noter également les orientations de la Chine sur la mobilité électrique : production de petites voitures électriques moins chères pour le Japon et l’UE, exportation de composants aux fabricants européens de VE, développement de la production de camions électriques, … Cela pourrait conduire à une concentration de l’industrie de la mobilité électrique en Chine, afin de mieux intégrer les sous-traitants dont certains sont en difficulté financière. En même temps, la Corée du Sud pourrait s’avérer un concurrent redoutable de la Chine pour les batteries.
Aux États-Unis, les décisions suivent les annonces du Président : opposition aux orientations de la Californie sur la mobilité électrique, assèchement des crédits et des subventions pour les renouvelables et la mobilité électrique, et pour les industries associées.
Terres rares et matières premières
Annonces, prises de position et négociations se poursuivent :
Chine : le 4ème plenum du PCC a fixé un objectif de doublement pour les technologies propres, visant le développement économique national et le marché mondial. La négociation entre les États-Unis et la Chine semble avoir abouti après les annonces sur la taxation des échanges, mais le contrôle des exportations des technologies comme des terres rares reste un sujet d’intérêt.
Les terres rares sont désormais des objets de sécurité nationale aux États-Unis : mise en exploitation des ressources de lithium, accélération de la recherche de gisements par les États-Unis en RDC, avec la perspective d’un accord plus large portant notamment sur le développement des infrastructures, investissement dans les gisements de lithium et de nickel au Canada, et peut-être négociation entre États-Unis et Pakistan ; innovation technologique et création d’un fonds minier pour les matériaux critiques sont d’actualité.
La Chine révise sa politique d’exportation notamment pour les produits raffinés, et envisage un contingentement pour l’accès des compagnies étrangères aux ressources.
Hausse du prix du cuivre et renforcement de la maîtrise du raffinage par la Chine.
Accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur une gestion partagée des minéraux.
Annonces de l’Arabie, du Qatar et des Émirats portant sur le développement local des activités d’extraction et de raffinage, et sur leur financement dans le monde, notamment au Canada dans le cadre de la diversification des activités.
L’UE entend constituer des stocks de métaux et de terres rares pour faire face aux risques géopolitiques, ce qui peut offrir un champ de développement à l’industrie française si les compétences historiques sont toujours présentes ou peuvent être reconstituées. Une première usine de raffinage des terres rares voit le jour en Estonie.
Hydrogène
Les perspectives semblent se réduire faute de développement du marché sauf peut-être en Asie où la Chine entend prendre une position dominante sur la fabrication d’électrolyseurs. Les subventions pour l’hydrogène « bas carbone » sont coupées aux États-Unis. Les compagnies européennes et nord-américaines portant des projets d’hydrogène « propre » peinent à se financer, et certains fabricants d’automobiles renoncent au véhicule hydrogène. Le coût de l’hydrogène « vert » est jugé trop élevé par les industriels allemands et la production d’hydrogène reste de l’ordre de 100 Mt dont 1% d’hydrogène vert dans le monde ; des innovations sont toujours espérées sur toute la chaîne de valeur : le prix du gaz et le coût du développement du captage et du stockage du carbone vont-ils être incitatifs ?
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/

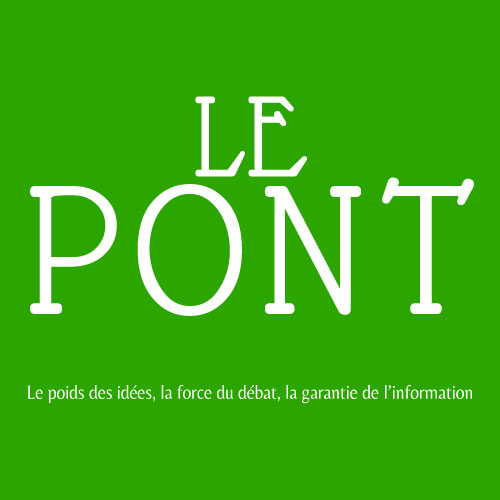





Responses