Observatoire des énergies

La prise de fonction du Président Trump et les tensions internationales se concrétisent par de multiples décisions dont l’impact est difficile à évaluer : cet impact sera-t-il à court terme ou à plus long terme ? Est-ce un changement de paradigme ou est-ce l’amplification de tendances en place depuis plusieurs années ? Le fait est que l’énergie est au cœur des enjeux économiques et géopolitiques comme elle l’a été depuis longtemps. La prise de conscience de l’importance de la sécurité énergétique est maintenant faite et surtout s’exprime : impact des coûts sur la compétitivité des économies, impact de l’accès aux ressources en énergies primaires et aux ressources indispensables pour la mise en œuvre des systèmes énergétiques, impact des transformations technologiques sur la demande d’énergie, impact sur les modalités de la transition énergétique et sur la maîtrise du changement climatique. Et on ne saurait négliger l’intensification de la compétition internationale sur la fourniture des équipements de production de l’énergie finale alors que les innovations technologiques se font à leur rythme propre et que les attentes s’intensifient. Et on ne saurait non plus négliger les changements voire les ruptures dans les « règles du jeu », par exemple sous l’effet des taxes et plus largement des initiatives des Etats-Unis. L’énergie est au cœur de l’imbrication des enjeux, et les incertitudes s’accumulent.
L’Asie du Sud-Est, particulièrement dépendante du pétrole et du gaz importés du Proche-Orient, voit monter les tensions qui portent en particulier sur la sécurité énergétique et le financement des équipements à mettre en place. Agir à la fois sur la maîtrise de la demande et sur l’augmentation de l’offre en visant la décarbonation de la production d’électricité est un impératif dont la satisfaction conduit à des besoins massifs d’investissement.
Pour ce qui concerne l’UE, le prix élevé de l’énergie, notamment celui de l’électricité, 3 fois plus chère qu’en Chine et aux Etats-Unis, constitue un handicap pour la compétitivité. L’approvisionnement en gaz naturel est maintenant un défi majeur : fin du transit du gaz russe via l’Ukraine, même si existent des chemins « gris » pour sa livraison, augmentation du prix du fait de l’importation de LNG des Etats-Unis, compétition entre acheteurs. Et l’on reste dans l’attente de décisions consécutives au rapport Draghi : industrialisation des technologies pour la transition, réduction de la fragmentation du marché du gaz pour en réduire la volatilité du prix, adaptation des « règles du jeu » pour tenir compte du coût complet de l’énergie et, en particulier, de l’électricité pour le consommateur final.
Pétrole, gaz, et fossiles
Pétrole
Après avoir été pendant plusieurs mois de 2024 dans la zone de 80$ le baril puis avoir baissé vers 75$, ce prix s’établit entre 75 et 80$ : équilibre instable entre pays OPEP+ et pays non-OPEP+, absence de hausse significative de la demande chinoise. Encore faut-il tenir compte pour l’avenir de la mise en application des taxes par les Etats-Unis : annonce ferme de la hausse des taxes à l’importation en provenance du Canada et du Mexique puis annonce du report de la date d’application, volonté affirmée du Président Trump de faire baisser les prix de l’OPEP+ pour faire pression sur la Russie malgré l’opposition d’investisseurs aux Etats-Unis du fait de la baisse de rendement des gisements y compris pour le pétrole non conventionnel américain, utilisation des taxes dans la négociation commerciale avec l’UE, … Et cela alors que l’OPEP+ a tenu la réunion prévue pour définir ses orientations pour les prochains mois, en particulier une baisse de la production de 800000 barils par jour afin de soutenir les prix.
Dans ces conditions, il est difficile de tracer des perspectives : faut-il s’attendre à une demande augmentant modérément mais avec des fluctuations, faut-il s’attendre à une production plus chère malgré la contribution des pays non-OPEP+, faut-il s’attendre à une série de contraintes momentanées entraînant des fluctuations significatives sur les prix ? A noter que les Etats-Unis ont largement reconstitué leurs stocks et qu’ils bénéficient de leurs ressources en pétrole non conventionnel tout en s’interrogeant sur la nécessité de nouvelles licences de production. Et il faut s’attendre à une reprise des explorations en eau profonde par les compagnies américaines.
Pour ce qui concerne l’UE, le prix du pétrole reste bien entendu un facteur important pour sa compétitivité ; en termes de quantités, il semble que la contribution de la Norvège est là ; et il ne faut pas exclure une reprise de la production des gisements de Mer du Nord souhaitée par le Premier ministre britannique mais dont on ne sait pas si elle pourra compenser la baisse de rendement des gisements en exploitation et la réluctance des investisseurs.
Plus que jamais, le prix du pétrole est largement un prix politique et les incertitudes persistantes restent liées aux équilibres internationaux et à l’aggravation de la situation internationale autant qu’aux enjeux pour les différents acteurs, et aux ressources mobilisables.
Gaz
Le gaz est de plus en plus un révélateur des enjeux.
La demande et la production restent quasiment stables. La demande chinoise reste également stable, la mise en exploitation de gisements en Malaisie et en Afrique est possible, et le Proche-Orient reste fournisseur de premier plan.
Aux Etats-Unis, la demande d’électricité qui augmente notamment du fait de la multiplication des centres de calcul et de stockage des données conduit à développer la construction de centrales à gaz, et de nouveaux projets d’extraction voient le jour, ainsi que de nouveaux terminaux de liquéfaction pour l’exportation dont la capacité pourrait doubler d’ici 2030 ; d’où une interrogation sur les coûts. De plus, le gaz naturel est un levier d’action vis-à-vis de la Russie comme vis-à-vis de l’UE. De nouvelles sanctions sont possibles, en particulier pour gêner Gazprom dont la production a augmenté de l’ordre de 15% l’année dernière et qui vise toujours 2027 pour un nouveau gazoduc pour exporter vers la Chine.
Pour ce qui concerne l’UE, après une période d’optimisme modéré, l’avenir est incertain. Les importations de gaz russe ont été massives en 2024, mais le transit via l’Ukraine est maintenant terminé et la capacité du transit par la Turquie est insuffisante pour répondre à la demande ; de fait, la Hongrie et l’Autriche restent sont les principaux importateurs de gaz russe, et les contrats en cours avec la Russie signés par les compagnies privées restent en place. Les stocks ont fortement baissé cet hiver, et leur reconstitution en prévision de l’hiver 2025-2026 doit maintenant être négociée. Les Etats-Unis sont maintenant le principal fournisseur de gaz à l’UE et le Qatar le deuxième ou le troisième ; les enjeux associés apparaissent immédiatement : le prix du GNL américain qui doit intégrer le coût du transport vers les ports de mer du Nord et de Grèce ainsi que l’effet de la négociation commerciale initiée par le Président Trump entre les Etats-Unis et l’UE, le prix du GNL qatari alors que le Qatar veut ne pas être pénalisé par le prix du CO2, et qu’en sera-t-il du gaz russe à l’issue des négociations qui ont commencé sur la guerre Russie-Ukraine ? A noter que l’Allemagne a semble-t-il continué d’importer du gaz russe via les ports de mer du Nord et les moyens « gris ». Pour résumer, l’UE remplace sa dépendance au gaz russe par une dépendance au GNL américain ; le prix du gaz va donc augmenter, entraînant l’augmentation du prix de l’électricité et la mise en place par l’UE d’un prix plafond fait désormais l’objet d’une réflexion.
La situation reste tendue pour le Royaume-Uni, d’autant plus que le développement massif des renouvelables intermittentes, un des objectifs majeurs du gouvernement, va nécessiter la construction de centrales à gaz pour le back-up.
Il est donc certain que 2025 ne sera pas simple et que les prix vont augmenter. Au-delà du seul prix du gaz, il y aura un impact sur le prix de l’électricité, ce qui risque d’augmenter les contraintes sur la compétitivité de l’industrie ; le marché de l’électricité et ses règles devraient être de nouveau un sujet majeur : on retrouve les recommandations du rapport Draghi.
Charbon
Rien de nouveau pour ce qui concerne le charbon : la demande semble stagner ou baisser, entraînant selon certains experts une baisse des prix ; et il convient de noter la forte volonté chinoise de réduire la production d’électricité dans des centrales à charbon.
Marché du CO2
Peu d’évolution à la suite des annonces des mois précédents : le rapprochement du Royaume-Uni avec le marché de l’UE reste complexe vus les défis à relever. Et quelle sera la réponse de l’UE à la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris qui est maintenant actée ?
COP29
La COP 29 a acté que l’on n’est pas sur le chemin de -1,5°C et a constaté que si la part des fossiles dans le mix énergétique diminue progressivement, la demande des fossiles augmente en quantités (+15% depuis 2013) ; les fossiles pourraient encore représenter 50% de l’énergie primaire en 2050. On attend donc la déclinaison pratique des recommandations de l’Agence Internationale de l’Energie, en particulier investir pour développer le stockage et le back-up des renouvelables intermittentes.
La Chine s’est exprimée fortement : développer les industries peu carbonées, continuer de développer les technologies propres incluant le nucléaire et la CSC, atteindre la neutralité en 2060 grâce notamment à l’électricité.
Les Etats-Unis sont sortis de l’accord de Paris : suppression de l’objectif de produire 100% de véhicules électriques en 2035, suppression de l’Agence en charge du changement climatique, suppression des fonds destinés à soutenir l’action des pays émergents dans le cadre de la Convention UNFCCC, sans oublier le destin de l’USAID.
Le nucléaire
L’électricité est le vecteur énergétique de demain ; la demande liée aux data centers et à l’air conditionné se compte en centaines et centaines de TWh. Le nucléaire doit prendre toute sa place, et, de plus en plus, les études et les déclarations portent sur les enjeux et les efforts à faire pour tous les maillons de la chaîne de valeur, de la ressource en uranium au MWh. Le développement du nucléaire dans le monde fait l’objet d’annonces dont certaines se concrétisent. Dans sa récente publication sur le nucléaire, l’AIE signale que 420 réacteurs sont en exploitation dans le monde, plus de 60 sont en construction pour environ 70 GW, plus de 40 pays manifestent leur intérêt pour le nucléaire et en particulier les SMR dont près de 1000 pourraient fonctionner en 2050 ; elle signale également l’augmentation de la production d’électricité au Japon et en France ainsi que la généralisation des actions pour allonger la durée de fonctionnement au moins à 60 ans des réacteurs existant.
Aux Etats-Unis, dès son audition au Sénat avant sa prise de fonction, le nouveau Secrétaire à l’énergie a mentionné l’importance du nucléaire avec, comme objectif, le leadership américain dans le monde, d’où l’effort à faire en R&D pour les SMR et les AMR ainsi que pour la fabrication du combustible, le renforcement de l’industrie, la baisse des coûts, et la maîtrise à retrouver sur toute la filière, d’où l’intensification des discussions avec les pays intéressés par le nucléaire notamment l’Inde. L’objectif de tripler le parc de production pour disposer de 300 GW en 2050 est confirmé : allongement généralisé de la durée de fonctionnement des réacteurs en service aujourd’hui à 80 ans, construction de 60 GW sur des sites de centrales à charbon. Cela nécessite de disposer d’uranium et de capacités d’enrichissement ; or le gouvernement fédéral a accentué les sanctions contre les entreprises qui travaillent avec la Russie, déclenchant une réaction russe de limitation des exportations vers les Etats-Unis (la Russie contrôle 40% des capacités mondiales d’enrichissement et fournit à ce jour plus du quart des besoins américains) ; et cela éclaire en partie la négociation tendue avec le Canada, producteur majeur d’uranium.
De ce qui précède, on peut déduire la nécessité de disposer des quantités d’uranium suffisantes ainsi que du cadre réglementaire et de modalités de financement adaptés :
- La production d’uranium a augmenté fortement au Canada en 2024 (+1/3 pour Cameco) et devrait encore augmenter pendant la prochaine décennie, l’extraction du minerai étant plus facile et moins coûteuse qu’en Australie et au Kazakhstan selon les experts ; le prix de l’uranium a doublé depuis 10 ans et va encore augmenter ; le débat pour reprendre l’extraction est ouvert en Suède ; et la Chine manifeste un intérêt encore grandissant pour la Namibie.
- D’une façon générale, le développement des capacités de fabrication du combustible est à l’ordre du jour et le financement devra suivre.
- Baisse des coûts et réduction de la durée de construction sont les principaux défis largement commentés ; ce qui conduit à préconiser une vision de long terme sur la politique énergétique des pays intéressés, à donner une visibilité suffisante aux acteurs industriels et financiers, à disposer de la réglementation nécessaire et surtout stabilisée. Ce qui doit se concrétiser par le refus du « stop and go », ainsi que par la recherche de l’effet de série à partir de designs également stabilisés.
Plusieurs pays envisagent ou construisent des réacteurs. La Chine a décidé la construction de 11 nouveaux réacteurs répartis sur cinq sites, leur construction devrait durer 5 ans. Les projets avancent en Pologne pour un montant de 14 milliard $, avec la fourniture de réacteurs par les Etats-Unis et le soutien de l’US Export Bank. Le débat est ouvert en Italie et en Belgique. Plusieurs pays émergeants ont exprimé leur intérêt pour le nucléaire à la COP29. Il en est de même des états baltes. L’Argentine envisage des SMR pour l’alimentation des industries électro-intensives. La compétition entre les fournisseurs de réacteurs s’intensifie et va durer, cependant que des accords de partenariat et des lettres d’intention sont conclus (par exemple entre la France et l’Inde pour des SMR et AMR).
Pour ce qui concerne, l’UE, rappelons qu’un accord majoritaire s’est fait pour inclure le nucléaire dans la liste des technologies qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, et pour pousser les travaux sur plusieurs projets de SMR ; les industriels du secteur s’unissent pour mettre en place un cadre favorisant les conditions de succès : formation, accès au financement public et privé, réglementation cohérente avec la neutralité technologique adoptée par l’UE. Au Royaume-Uni, un soutien de 5 milliards de £ a été décidé pour la construction de 2 EPR (3,2 GW) à Sizewell, et la recherche de nouveaux sites devient d’actualité.
Vers la transition énergétique : poursuite de la montée des enjeux internationaux
L’augmentation de la demande en électricité est générale dans le monde, notamment en tenant compte des besoins des data centers qui a déjà presque doublé depuis 2019. Il est plus que probable que, sauf l’adoption de politiques très volontariste, la Chine en soit, et de loin, le principal bénéficiaire ; à moins que l’Inde ne prenne une place significative pour les équipements photovoltaïques, ce qui envisagé par un nombre croissant d’experts.
Il n’y a plus d’incertitudes sur les orientations du nouveau Président des Etats-Unis et les décisions ont suivi les annonces : fin des prêts garantis par l’Etat pour les investissements en renouvelables, suppression des 300 milliards de $ de soutien aux développeurs de projets et aux équipementiers pour les renouvelables, abandon prévisible des projets en éolien offshore ; et il est probable que les actions juridiques engagées par les opposants à ces décisions n’en changeront rien. De plus, le soutien aux fossiles s’affirme : exploration, mise en exploitation des gisements de pétrole et de gaz, construction de pipelines, … Et le charbon conserve sa place : il faut tenir compte des besoins en électricité d’une économie en croissance, il faut limiter le prix des carburants, et il faut augmenter les exportations d’énergie primaire vers l’Europe et vers l’Asie.
Au Royaume-Uni, le développement des renouvelables intermittentes est toujours à l’ordre du jour : doubler voire tripler d’ici 2030 les capacités éoliennes (pour atteindre environ 50 GW) et photovoltaïques, disposer du réseau électrique cohérent avec les sites de production reste un problème à régler : les investissements de réseau devraient atteindre 77 milliards de £ entre 2026 et 2031, soit le double des investissements réalisés entre 2015 et aujourd’hui ; la conséquence prévisible en est une augmentation significative du coût de l’électricité pour les consommateurs notamment domestiques. De nouveau, le captage et le stockage du CO2 revient dans l’actualité au Royaume-Uni, mais le capital n’est pas au rendez-vous ; cela rappelle les annonces faites il y a une vingtaine d’années pour plusieurs projets de centrales avec CSC soutenus par des subventions massives, mais qui n’ont pas été réalisés.
A noter le record d’exportation d’électricité pour la France : 89 TWh dont 27 vers l’Allemagne, 22 vers l’Italie, 20 vers le Royaume-Uni ; cela a été réalisé grâce au bon fonctionnement du nucléaire et au bon niveau de la production renouvelable dont l’hydraulique.
A noter pour l’UE le projet d’une liaison électrique de 700 MW entre la Suède et l’Allemagne, cependant que l’Allemagne réorganise le marché de l’électricité pour traiter la volatilité des prix liée aux renouvelables intermittentes et l’objectif de limiter la hausse des prix en développant les interconnexions ; à noter également la baisse de l’installation de panneaux photovoltaïques.
A Davos, l’AIE a mis l’accent sur l’augmentation rapide des renouvelables, en premier lieu dans les pays développés mais trop faible dans les pays émergents, ce qui reste trop lent pour répondre à la préoccupation de l’UE lors que 600 millions d’humains n’ont toujours pas accès à l’électricité (à titre d’exemple, l’Afrique représente 60% du potentiel en renouvelables, mis seulement 2% des investissements.
Pour ce qui concerne les véhicules électriques, BYD a stoppé la production d’une usine au Brésil à cause de contraintes RSE et la Chine a engagé des actions pour limiter l’impact des taxes européennes sur l’importation de véhicules. Tesla s’inquiète maintenant de la concurrence des fabricants chinois ainsi que de la baisse des ventes, et a engagé une action contre l’UE du fait des taxes à l’importation de VE fabriqués en Chine.
A noter la montée rapide des exportations chinoises de panneaux solaires au Proche et au Moyen Orient.
A noter enfin les investissements massifs en renouvelables de la Chine qui dépassent maintenant le total des investissements des Etats-Unis, de l’UE et du Royaume-Uni.
Terres rares et matières premières
La prise de conscience est là aussi réalisée ; les annonces du Président des Etats-Unis à propos des ressources du Groenland et du Canada, et celles de la Chine pour les ressources africaines n’y sont pas pour rien. Les Etats-Unis recherchent effectivement une alternative aux importations en provenance de la Chine, mais les investisseurs ne sont pas tous partant pour réaliser les infrastructures nécessaires ou exploiter les gisements potentiels ou identifiés. La Chine envisage maintenant près de 60 milliards de $ d’investissements dans une vingtaine de pays émergents, probablement sous forme de partenariats public-privé en dehors du cadre des « Routes de la soie ».
Selon l’Agence Internationale de l’Energie, la demande de minéraux critiques reste et restera forte, avec les effets contradictoires sur les prix de la baisse des coûts de production et de l’augmentation de la demande. De plus, il y a en Chine comme dans le reste du monde un mouvement de concentration des acteurs et des opérateurs (par exemple en UE et aux Etats-Unis pour le cuivre et le lithium), ce qui conduit au renforcement d’une situation oligopolistique. Avec la croissance des besoins et de la mise en exploitation des nouveaux gisements est maintenant mise en avant la nécessité d’intégrer le respect de l’environnement et le social dans les conditions d’exploitation. L’idée de développer le recyclage pour récupérer les matériaux critiques d’équipements arrivés en fin de vie fait peu à peu son chemin ; encore faut-il pouvoir le faire à un coût acceptable.
Hydrogène
Les espoirs placés dans ce nouveau vecteur énergétique semblent se réduire de façon significative : la valeur des compagnies européennes et nord-américaines portant des projets d’hydrogène « propre » a fortement baissé (coût des électrolyseurs, coût des équipements de conversion tels que la pile à combustible, coût du transport si l’hydrogène doit aller d’une zone de production vers une zone de consommation). Les investissements restent faibles, moins de 10% par rapport aux annonces, faute de perspectives de développement rapide du marché, sauf peut-être en Asie. Et les grands constructeurs d’avions ne voient pas arriver la propulsion à hydrogène avant au mieux le milieu du siècle.
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/

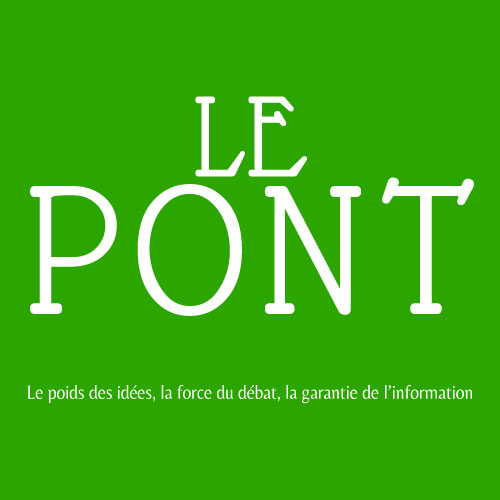




Responses