Observatoire des énergies (avril 2025)


Les décisions du Président Trump et les tensions internationales qui lui sont en partie liées accentuent les incertitudes sur les évolutions du domaine de l’énergie. Il en est de même pour ce qui concerne les orientations et les décisions de l’Union européenne : rythme de la transition énergétique, sécurité d’approvisionnement, gestion des contraintes sur le choix en énergies primaires et en technologies. Les tendances à l’œuvre depuis plusieurs années sont toujours présentes et, plus que jamais, l’énergie est au cœur des enjeux économiques et géopolitiques comme elle l’a été depuis longtemps. La prise de conscience de l’importance de la sécurité énergétique est maintenant faite et surtout s’exprime : impact des coûts sur la compétitivité des économies, impact de l’accès aux ressources en énergies primaires et aux ressources indispensables pour la mise en œuvre des systèmes énergétiques, impact des transformations technologiques sur la demande d’énergie, impact sur les modalités de la transition énergétique et sur la maîtrise du changement climatique.
L’Asie du Sud-Est, particulièrement dépendante du pétrole et du gaz importés du Proche-Orient, voit monter les tensions qui portent en particulier sur la sécurité énergétique et le financement des équipements à mettre en place. Pour l’UE, le prix élevé de l’énergie, notamment celui de l’électricité, 3 fois plus chère qu’en Chine et aux Etats-Unis, constitue un handicap pour la compétitivité. L’approvisionnement en gaz naturel reste défi majeur : fin du transit du gaz russe, augmentation du prix lié à l’importation de LNG des Etats-Unis, compétition entre acheteurs ; et cela alors que les stocks ont été largement utilisés pendant le dernier hiver et que la nécessité de les reconstituer pour l’hiver prochain est impérative. Et les décisions consécutives au rapport Draghi sont attendues pour développer l’industrialisation des technologies pour la transition, réduire la volatilité du prix du gaz, faire évoluer les « règles du jeu » pour tenir compte du coût complet de l’énergie et de l’électricité pour le consommateur final.
L’Agence internationale de l’énergie annonce que la demande d’électricité dans le monde va augmenter de façon importante aussi bien pour les pays émergents et en Chine du fait du développement de l’économie et notamment des besoins de l’IA et de la gestion des données, que pour les pays de l’OCDE du fait de la réindustrialisation et, là aussi, de l’IA et du fait du développement de l’usage des véhicules électriques, ainsi que de la réindustrialisation. Nucléaire et renouvelables intermittentes devraient permettre de satisfaire la demande tout en stabilisant les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les pays développés ; le développement des réseaux et de l’utilisation des batteries sont des enjeux de plus en plus prégnants. La hausse annuelle de la demande d’électricité devrait être de l’ordre 4,3% soit le double de la décennie 2014-2024 ; cette hausse serait satisfaite à plus des trois quarts par les énergies renouvelables, alors que l’électricité reste à 60% produite à partir de ressources fossiles et à seulement presque un tiers sans émission de CO2.
Quant aux compagnies gazières, elles considèrent que les besoins en gaz vont augmenter de près de 60% d’ici 2040, notamment en Asie et pour assurer le backup des énergies intermittentes ; cela pourrait bénéficier en premier aux producteurs américains de gaz non conventionnel.
Pétrole, gaz, et fossiles
Pétrole
Plusieurs facteurs influent sur le prix du pétrole. Après avoir été pendant les premiers mois de l’année dernière aux environs de 80$ le baril, puis avoir baissé vers 70 à 75$, le prix du baril est maintenant de l’ordre de 60 à 65$ ; cela confirme les fluctuations anticipées par plusieurs experts et qui vont probablement persister.
Plusieurs raisons à cette situation d’incertitude notamment à court terme, notamment :
- Le ralentissement de la demande directement liée à la situation économique dans le monde.
- L’augmentation de la production dans les pays de l’OPEP+ (400000 baril/jour).
- Les perspectives de mise en exploitation de nouveaux gisements.
- Les perspectives de rentabilité pour les investisseurs.
Le gouvernement des Etats-Unis a annoncé la reprise des investissements en Alaska et pour les gisements en eau profonde, et le slogan « drill baby drill » est toujours d’actualité avec l’objectif de 50$ le baril aux Etats-Unis pour contrer l’OPEP+ et réduire les recettes de la Russie ; mais les producteurs de pétrole non conventionnel aux Etats-Unis considèrent que ce prix est trop bas pour assurer leur rentabilité et pour financer de nouveaux investissements, et visent un prix plus élevé supérieur à 60$ le baril même si cela gênerait les consommateurs. A noter que la hausse des prix des équipements (prix de l’acier, volatilité sur les marchés de matériaux) est également une source d’incertitude. Et il faut signaler l’annonce de sanctionner les pays importateurs de pétrole du Venezuela.
Des projets de développement de la production de pétrole non conventionnel sont étudiés au Mexique. L’Arabie saoudite est dans une situation complexe : produire avec un prix qui permet de financer ses projets de développement, préserver le fonctionnement de l’OPEP+ avec un prix qui reste proche des attentes de ses partenaires, maintenir ses bonnes relations avec les Etats-Unis en particulier par ses investissements dans l’économie américaine. Au Royaume-Uni, il semble qu’un mouvement de concentrations et de fusions-acquisitions est en cours dans l’industrie pétrolière et gazière afin de réduire les risques pour les investisseurs et de relancer les investissements en Mer du Nord ou, au moins, d’augmenter la production en réduisant l’impact des taxes. Pour ce qui concerne l’UE, le prix du pétrole reste bien entendu un facteur important pour sa compétitivité.
Les équilibres restent donc instables voire inexistants, alors que la demande de pétrole augmente peu mais est susceptible de redémarrer en Chine. Dans ces conditions, il reste difficile de tracer des perspectives : faut-il s’attendre à une demande augmentant modérément mais avec des fluctuations, faut-il s’attendre à une production plus chère malgré la contribution des pays non-OPEP+, faut-il s’attendre à une série de contraintes momentanées entraînant des fluctuations significatives sur les prix ? Plus que jamais, le prix du pétrole est un prix politique et les incertitudes persistent, liées aux équilibres internationaux et à l’aggravation de la situation internationale autant qu’aux enjeux pour les différents acteurs, et aux ressources mobilisables.
Gaz
Le gaz est de plus en plus un révélateur des enjeux.
La demande et la production augmentent modérément, mais le prix augmente. La demande chinoise reste également stable et sa dépendance au gaz russe pourrait être un handicap ; la mise en exploitation de gisements en Malaisie et en Afrique est possible, et le Proche-Orient reste fournisseur de premier plan. Il convient de noter que la production en Inde où la demande augmente significativement est insuffisante et que l’Inde entend augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié des Etats-Unis, sans doute dans le cadre des deals recherchés par le Président des Etats-Unis.
Aux Etats-Unis, la demande d’électricité qui augmente notamment du fait de la multiplication des centres de calcul et de stockage des données conduit à développer la construction de centrales à gaz, et de nouveaux projets d’extraction voient le jour, ainsi que de nouveaux terminaux de liquéfaction pour l’exportation dont la capacité pourrait doubler d’ici 2030 : une dizaine de projets sont annoncés mais la rentabilité des investissements est en question ; d’où une interrogation sur les coûts voire sur un risque de surproduction à terme. En même temps, le gaz naturel est un levier d’action vis-à-vis de la Russie comme vis-à-vis de l’UE
Pour ce qui concerne l’UE, l’avenir est incertain. Les importations de gaz russe ont été massives en 2024, mais le transit via l’Ukraine est maintenant terminé et la capacité du transit par la Turquie est insuffisante pour répondre à la demande ; de fait, la Hongrie et l’Autriche restent les principaux importateurs de gaz russe. Les stocks ont fortement baissé cet hiver, et leur reconstitution en prévision de l’hiver 2025-2026 doit maintenant être négociée. Les Etats-Unis sont le principal fournisseur de gaz à l’UE (45% en 2024) et le Qatar le deuxième ou le troisième ; les enjeux associés apparaissent immédiatement : le prix du GNL américain transporté vers les ports de mer du Nord et de Grèce, la négociation commerciale initiée par le Président Trump entre les Etats-Unis et l’UE, le prix du GNL qatari alors que le Qatar veut ne pas être pénalisé par le prix du CO2. A noter que l’Allemagne a semble-t-il continué d’importer du gaz russe via les ports de mer du Nord et les moyens « gris », et des voix se font entendre pour mettre en service North Steam 2 avec peut-être un financement en partie américain. Il est donc certain que 2025 ne sera pas simple et que les prix vont augmenter. Le prix du gaz aura un impact sur le prix de l’électricité, ce qui risque d’augmenter les contraintes sur la compétitivité de l’industrie ; le marché de l’électricité et ses règles devraient être de nouveau un sujet majeur : on retrouve les recommandations du rapport Draghi.
La situation reste tendue pour le Royaume-Uni, d’autant plus que le développement massif des renouvelables intermittentes, un des objectifs majeurs du gouvernement, va nécessiter la construction de centrales à gaz pour le back-up et de réseau électrique. Le Royaume-Uni souhaite produire la moitié de son besoin en gaz, ce qui conduit les compagnies gazières à demander un réexamen des taxes en vigueur.
Charbon
Rien de nouveau pour ce qui concerne le charbon : la demande semble stagner ou baisser, entraînant selon certains experts une baisse des prix ; et il convient de noter la forte volonté chinoise de réduire la production d’électricité dans des centrales à charbon, mais la construction de nouvelles centrales reste au plus haut, ce qui handicape l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de CO2.
Le captage et le stockage du carbone sont de nouveau évoqués.
Maîtrise du changement climatique et marché du CO2
Peu d’évolution à la suite des annonces des mois précédents : le rapprochement du Royaume-Uni avec le marché de l’UE reste complexe. Et quelle sera la réponse de l’UE à la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris qui est maintenant actée ? Quelle est la perspective des mesures de maîtrise du changement climatique si les Etats-Unis quittent l’UNFCCC ?
L’UE vise un changement des règles afin de les simplifier pour les entreprises notamment en diminuant la taxe CBAM pour les plus petites et pour donner plus de visibilité.
Le nucléaire
L’électricité est le vecteur énergétique de demain ; la demande liée aux data centers et à l’air conditionné se compte en centaines et centaines de TWh. Le nucléaire doit prendre toute sa place, et, de plus en plus, les études et les déclarations portent sur les enjeux et les efforts à faire sur tous les maillons de la chaîne de valeur, de la ressource en uranium au MWh. Le développement du nucléaire dans le monde fait l’objet d’annonces dont certaines se concrétisent, notamment pour ce qui concerne les SMR : discussions sur le choix des technologies, préparation des licences. Dans sa récente publication sur le nucléaire, l’AIE signale que 420 réacteurs sont en exploitation dans le monde, plus de 60 sont en construction pour environ 70 GW, plus de 40 pays manifestent leur intérêt pour le nucléaire et en particulier les SMR dont près de 1000 pourraient fonctionner en 2050 ; elle signale également l’augmentation de la production d’électricité au Japon et en France ainsi que la généralisation des actions pour allonger la durée de fonctionnement au moins à 60 ans des réacteurs existant.
Aux Etats-Unis, le nouveau Secrétaire à l’énergie confirme l’importance du nucléaire avec, comme objectif, le leadership américain dans le monde, d’où l’effort à faire en R&D pour les SMR et les AMR ainsi que pour la fabrication du combustible, le renforcement de l’industrie, la baisse des coûts, et la maîtrise à retrouver sur toute la filière, d’où l’intensification des discussions avec les pays intéressés par le nucléaire notamment l’Inde. L’objectif de tripler le parc de production pour disposer de 300 GW en 2050 est confirmé : allongement généralisé de la durée de fonctionnement des réacteurs en service aujourd’hui à 80 ans, construction de 60 GW sur des sites de centrales à charbon. Cela nécessite de disposer d’uranium et de capacités d’enrichissement.
De ce qui précède, on peut déduire la nécessité de disposer des quantités d’uranium suffisantes ainsi que du cadre réglementaire et de modalités de financement adaptés :
- L’Agence de l’énergie nucléaire et l’AIEA préconisent l’intensification de l’exploration et des investissements sur toute la chaîne du combustible afin de pouvoir satisfaire la demande d’uranium aux horizons 2050 et 2080 ; le dernier Red Book insiste particulièrement sur ces sujets, alors que la production a atteint un point bas en 2020. La demande d’uranium pourrait doubler d’ici 2040.
- La production d’uranium a augmenté fortement au Canada en 2024 (+1/3 pour CAMECO) et devrait encore augmenter pendant la prochaine décennie, l’extraction du minerai étant plus facile et moins coûteuse qu’en Australie et au Kazakhstan selon les experts ; le prix de l’uranium a doublé depuis 10 ans et va encore augmenter ; le Kazakhstan reste le principal producteur de minerai avec près de 40% de la production mondiale et il augmente régulièrement ses ventes à la Russie et à la Chine ; le débat pour reprendre l’extraction est ouvert en Suède ; et la Chine manifeste un intérêt encore grandissant pour la Namibie. La situation au Niger pourrait avoir un impact durable sur l’approvisionnement de l’UE, au moins en termes de coût.
- D’une façon générale, le financement est un défi urgent, que ce soit sur la chaîne de fabrication du combustible ou sur la construction de centrales ; par ailleurs, les nécessités de baisser les coûts et de réduire la durée de construction sont largement commentées ; ce qui conduit à préconiser une vision de long terme sur la politique énergétique des pays intéressés, à donner une visibilité suffisante aux acteurs industriels et financiers, à disposer de la réglementation nécessaire et surtout stabilisée. Dans ce cadre, il convient de noter qu’il n’est pas impossible que la Banque mondiale devienne un soutien au nucléaire, ce qui pourrait réduire l’avantage de la Russie et de la Chine qui proposent aux pays intéressés par le nucléaire des offres combinant équipements et financement de ces équipements.
Plusieurs pays envisagent ou construisent des réacteurs. La Chine a décidé la construction de 11 nouveaux réacteurs répartis sur cinq sites, leur construction devrait durer 5 ans. Les projets avancent en Pologne pour un montant de 14 milliards $, avec la fourniture de réacteurs par les Etats-Unis et le soutien de l’US Export Bank. Le débat est ouvert en Italie et en Belgique. Plusieurs pays émergeants et les Etats baltes ont exprimé leur intérêt. La compétition entre les fournisseurs de réacteurs s’intensifie et va durer, cependant que des accords de partenariat sont conclus et des lettres d’intention signées (par exemple entre la France et l’Inde pour des SMR et AMR). A noter pour ce qui est du Royaume-Uni que le financement de Sizewell est en bonne voie avec appel au financement privé, soutien de l’Etat, et la participation d’EDF toutefois limitée à 20%, et que le Royaume-Uni souhaite devenir un fabricant majeur de SMR.
Pour ce qui concerne la France, il convient de noter que le récent Conseil de politique nucléaire a fixé comme priorités la maîtrise industrielle, la mise en place d’un programme de travail sur les réacteurs de 4ème génération RNR donc sur la fermeture du cycle d’ici 2050, ainsi qu’une revue de la situation sur l’EPR2 afin de pouvoir prendre les décisions nécessaires au cours du premier semestre 2026 une fois obtenus les avis favorables nécessaires de l’UE et de l’ASNR ; la construction des EPR2 bénéficierait d’un contrat pour différence avec un maximum de 100€/MWh.
Vers la transition énergétique : poursuite de la montée des enjeux internationaux
L’augmentation de la demande en électricité est générale dans le monde, notamment en tenant compte des besoins des data centers qui a déjà presque doublé depuis 2019. Il est plus que probable que, sauf l’adoption de politiques très volontaristes, la Chine en soit, et de loin, le principal bénéficiaire ; à moins que l’Inde ne prenne une place pour les équipements photovoltaïques ; encore faut-il que les financements soient disponibles pour y développer la production et l’usage. Et il faut suivre la R&D japonaise sur des cellules PV ultrafines.
Les orientations du Président des Etats-Unis sont connues, les décisions suivent les annonces : fin des prêts garantis par l’Etat pour les investissements en renouvelables, suppression des 300 milliards de $ de soutien aux développeurs de projets et aux équipementiers pour les renouvelables, abandon prévisible des projets en éolien offshore, le tout entraînant le retrait des européens ; et il est probable que les actions juridiques engagées par les opposants à ces décisions n’en changeront rien. De plus, le soutien aux fossiles s’affirme : exploration, mise en exploitation des gisements de pétrole et de gaz, construction de pipelines, … Et le charbon conserve sa place pour tenir compte des besoins en électricité d’une économie en croissance et augmenter les exportations d’énergie primaire vers l’Europe et vers l’Asie.
Au Royaume-Uni, le développement des renouvelables intermittentes est toujours à l’ordre du jour : doubler voire tripler d’ici 2030 les capacités éoliennes (pour atteindre environ 50 GW) et photovoltaïques, disposer du réseau électrique cohérent avec les sites de production reste un problème à régler : les investissements de réseau devraient atteindre 77 milliards de £ entre 2026 et 2031, soit le double des investissements réalisés entre 2015 et aujourd’hui ; la conséquence prévisible en est une augmentation significative du prix de l’électricité. De nouveau, le captage et le stockage du CO2 revient dans l’actualité, mais le capital n’est pas là ; cela rappelle les annonces faites il y a une vingtaine d’années pour plusieurs projets de centrales avec CSC soutenus par des subventions massives, mais qui n’ont pas été réalisés.
A noter pour l’UE le projet d’une nouvelle liaison électrique de 700 MW entre la Suède et l’Allemagne, cependant que l’Allemagne réorganise le marché de l’électricité pour traiter la volatilité des prix liée aux renouvelables intermittentes ainsi que l’objectif de limiter la hausse des prix en développant les interconnexions. La hausse du coût prévisible des réseaux conduit à réfléchir de nouveau au bon niveau d’interconnexions sur le continent européen.
Pour ce qui concerne les véhicules électriques, BYD a stoppé la production d’une usine au Brésil à cause de contraintes RSE et la Chine a engagé des actions pour limiter l’impact des taxes européennes ; et les investissements de BMW au Royaume-Uni ralentissent. En UE, la demande semble se porter avant tout sur les véhicules hybrides.
Terres rares et matières premières
La prise de conscience est là aussi réalisée ; les annonces du Président des Etats-Unis à propos des ressources en terres rares du Groenland et du Canada sans oublier l’Ukraine, et celles de la Chine pour les ressources africaines n’y sont pas pour rien. Les Etats-Unis recherchent une alternative aux importations en provenance de la Chine, ils s’intéressent aux ressources de la RDC tout en envisageant de taxer les importations en provenance non seulement de Chine mais aussi de tous les pays du sud-est asiatique ; ils entendent également explorer la possibilité d’exploiter les minéraux rares du fond des mers. Ils envisagent par ailleurs un accord avec le Royaume-Uni : accord commercial, financier ? Il est trop tôt pour le dire précisément.
La Chine envisage maintenant près de 60 milliards de $ d’investissements dans une vingtaine de pays émergents, probablement sous forme de partenariats public-privé en dehors du cadre des « Routes de la soie », et elle augmente les subventions pour exploiter son sous-sol.
Selon l’Agence Internationale de l’Energie, la demande de minéraux critiques reste et restera forte, avec les effets contradictoires sur les prix de la baisse des coûts de production et de l’augmentation de la demande. De plus, il y a en Chine comme dans le reste du monde un mouvement de concentration des acteurs et des opérateurs (par exemple en UE et aux Etats-Unis pour le cuivre et le lithium), ce qui conduit au renforcement d’une situation oligopolistique. Avec la croissance des besoins et de la mise en exploitation des nouveaux gisements est maintenant mise en avant la nécessité d’intégrer le respect de l’environnement et le social dans les conditions d’exploitation. L’idée de développer le recyclage pour récupérer les matériaux critiques d’équipements arrivés en fin de vie fait peu à peu son chemin.
A noter la place prépondérante prise par l’Indonésie sur l’extraction du nickel (60% du marché en 2024), largement soutenue par la Chine en technologie et en financement ; et à noter les perspectives de développement de l’extraction du cuivre au Pakistan.
Hydrogène
Les espoirs placés dans ce nouveau vecteur énergétique semblent se réduire : la valeur des compagnies européennes et nord-américaines portant des projets d’hydrogène « propre » a fortement baissé (coût des électrolyseurs, coût des piles à combustible, coût du transport). Les investissements restent faibles, moins de 10% par rapport aux annonces, faute de perspectives de développement rapide du marché, sauf peut-être en Asie.
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/
-
Sylvain Hercberghttps://lepontdesidees.fr/author/shercbergauteur/

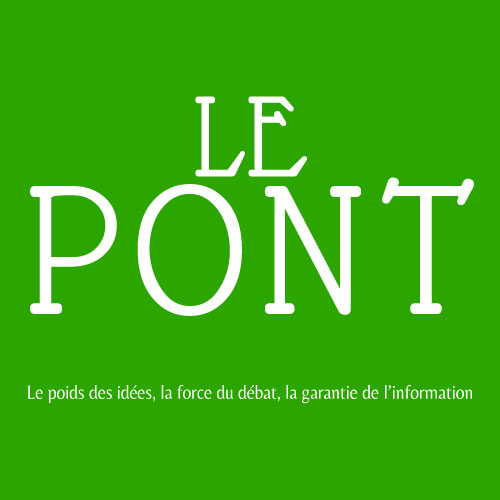




Responses