En aucun cas la reconnaissance d’un Etat de Palestine ne peut relever de la seule et unique décision du président de la République.

Olivier PASSELECQ

Cela pour deux raisons essentielles : d’abord parce qu’une décision d’une telle importance ne peut être prise par le président sans que le Premier ministre et les membres du Gouvernement concernés y soit directement associés, ensuite et surtout, ce qui est une circonstance aggravante, lorsque le Gouvernement est démissionnaire et strictement limité à l’expédition des affaires courantes.
Il convient donc d’examiner successivement ces deux questions cruciales :
- la reconnaissance d’un nouvel Etat par la France dépend-t-elle exclusivement de ce qu’il est convenu d’appeler le « domaine réservé » du président ?
- une décision diplomatique d’une telle envergure peut-elle être considérée comme une simple « affaire courante » ?
La réponse à ces deux questions ne peut être que négative.
1/ Constitutionnellement, le domaine réservé n’existe pas.
Il ne s’agit que d’une pratique qui n’a jamais pu être justifiée par la moindre disposition textuelle et qui relève donc d’un usage, certes reconnu et accepté par le Premier ministre et le Gouvernement, mais qui ne reste qu’un simple usage.
Au cœur de ce domaine réservé, que trouve-t-on ? On y trouve, essentiellement, les deux grands domaines régaliens que sont la Défense et la Diplomatie, dont le général de Gaulle s’est évidemment emparé sans coup férir dès le début de la Ve République et que tous ses successeurs ont considéré, eux aussi, comme faisant partie de leur pré carré.
Mais c’est ici précisément qu’il faut revenir à la Constitution, qui n’offre au président aucun privilège en la matière. L’article 19 de la Constitution donne en effet une liste très restreinte des pouvoirs que le chef de l’Etat peut exercer seul, c’est-à-dire sans que ses actes soient contresignés par le Premier ministre et les ministres responsables. Il s’agit de la nomination du Premier ministre, du référendum, de la dissolution, des pouvoirs exceptionnels (article 16), du droit de message au Parlement et de trois prérogatives concernant le Conseil Constitutionnel.
Toutes les autres attributions du président, à commencer par celles qui concernent la diplomatie, relèvent donc d’un domaine partagé entre lui, le Premier ministre et le Gouvernement, et en aucun cas d’un prétendu domaine réservé.
2/ Une décision diplomatique d’une telle importance ne peut en aucun cas être considérée comme une « affaire courante ».
Circonstance aggravante pour Emmanuel Macron, la décision de reconnaître ce nouvel Etat, lorsqu’il l’a présentée à la tribune de l’ONU le 22 septembre, est intervenue alors que la France est privée de Gouvernement. Depuis la démission de François Bayrou le 9 septembre, et malgré la nomination d’un nouveau Premier ministre, le Gouvernement est en effet réduit à expédier les affaires courantes.
La question essentielle est de savoir alors en quoi consiste exactement la notion d’affaires courantes.
Cette notion, fondée sur une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, englobe deux catégories d’actes : d’une part, les actes ordinaires, qui sont ceux qui doivent permettre d’assurer le fonctionnement quotidien de l’ Etat et de garantir la continuité des services publics, et d’autre part, les actes urgents, qui correspondent à un problème particulier qu’il convient de traiter sans délai. Etant précisé que seule l’urgence dite « impérieuse » peut permettre au pouvoir exécutif de prendre légalement ce genre de décisions.
Une autorité publique qui prend une décision qui ne correspond pas à ces deux catégories méconnaît donc de façon manifeste son domaine de compétence. Or la reconnaissance de la Palestine est-elle un affaire ordinaire ? Evidemment NON ! Est-elle une affaire à ce point urgente qu’elle ne pouvait attendre la formation d’un nouveau Gouvernement ? A l’évidence NON, puisqu’aucun processus en ce sens n’était engagé depuis de nombreuses années et n’imposait que cette reconnaissance devienne tout à coup une urgence « impérieuse ».
Une fois encore, Emmanuel Macron aura donc transgressé la Constitution et démontré que, contrairement à ce que l’on peut entendre dire ici ou là, ce ne sont pas les institutions de la Ve République qui sont en cause, mais ceux qui s’en servent, et qui s’en servent mal…
Enfin et surtout, en prenant seul sa décision concernant la Palestine, le président de la République s’est conduit en fait comme un véritable récidiviste, puisque c’est un an plus tôt, le 30 juillet 2024, qu’il a déjà pris une décision diplomatique lourde de conséquences : celle de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, entraînant une quasi rupture de la France avec l’Algérie. Et, bis repetita, cette décision a été prise alors que le Gouvernement de Gabriel Attal était lui aussi démissionnaire et réduit à expédier les affaires courantes. Ce sont donc, coup sur coup, deux décisions d’une importance extrême et d’une portée considérable qui ont été prises en violation flagrante de la Constitution.
*Constitutionnaliste
Professeur de droit public à l’IPAG de l’Université Panthéon Assas
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/

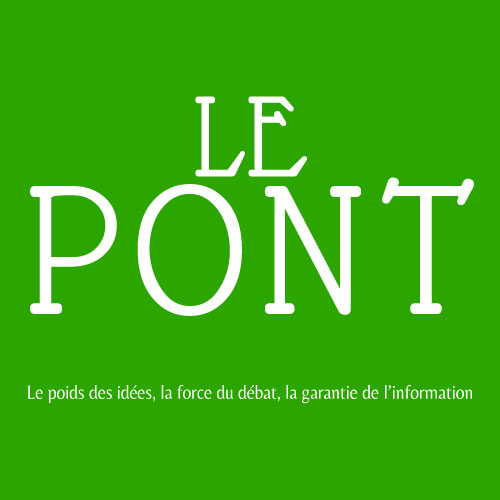



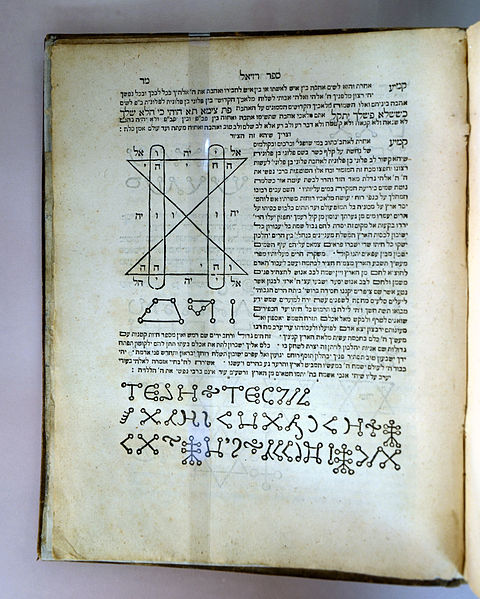


Responses