Douze hommes en colère


Tout récemment, sur une chaîne télévisée, un film de 1957 a été diffusé. Il s’agit de « Douze hommes en colère » avec Peter Fonda comme acteur principal. L’histoire est basée sur une pièce de théâtre écrite par Réginald Rose en 1954.
Ce célèbre huis-clos cinématographique peut éclairer quelques débats contemporains qui concernent la démocratie et particulièrement la liberté d’expression.
Les douze hommes sont douze jurés d’une cour d’assise. Leur décision peut conduire un jeune homme à la chaise électrique ou à sa libération.
Au début de la séance du jury, onze jurés se prononcent pour la culpabilité et un seul met en doute les résultats de l’enquête policière.
Au fil de la discussion, les arguments sont interrogés et certaines preuves mises en question. Le débat s’installe et au fur et à mesure qu’il se déroule, c’est le doute qui s’invite autour de la table.
Arguments et convictions viscérales s’opposent jusque dans des contradictions très musclées.
Au bout du compte, à la fin du film le vote s’est inversé. Les accusations et les certitudes de culpabilité se sont effondrées.
Les douze hommes votent « non coupable ».
Ce que nous pouvons retenir, c’est que le vote démocratique et la liberté d’expression ne sont pas les mêmes en début et en fin de film.
Si le vote s’arrête à l’aube du scénario, la démocratie et la liberté d’expression ont été respectées.
Pourtant à la fin de l’histoire, alors que la décision s’est complètement retournée, elles le sont tout autant.
Ce qui nous intéresse dès lors, c’est ce qui se passe entre les deux temps de début et de fin.
Lorsque le film commence, il y a des convictions, des certitudes et des émotions.
Tout au long du film, il y a débat et les arguments sont avancés. Les convictions et les certitudes sont remises en chantier. Les observations, les questions et les informations sont échangées.
Les acteurs prennent du recul par rapport à leur prise de position.
Cette histoire interroge la démocratie qui lorsque les urnes livrent leurs scrutins se base sur des chiffres, fruits de la quantité de convictions, de certitudes et d’émotion. C’est ce qui guide les choix.
La liberté d’expression dont les figures de proue d’outre-Atlantique se revendiquent aujourd’hui pour soutenir l’extrême droite n’est pas interrogée. Souvent des leaders politiques qui conduisent aux extrêmes alimentent et s’alimentent jusqu’à l’embonpoint de ce qui faisait le début de notre film
L’histoire peut se rappeler à nous en ce moment où se commémore la découverte et la libération du camp d’Auschwitz. Que se serait-il passé dans les années 30 si les citoyens avaient été informés de ce qui allait advenir ?
La liberté d’expression se devrait d’être couplée à un devoir d’information et à une obligation de débat et de réflexion.
Les débats quant à eux ne devraient pas se limiter au combat d’idées, mais s’ouvrir à l’échange et à l’écoute des arguments et des perceptions des uns et des autres.
A défaut d’écoute et d’échanges, c’est la prévalence d’un aspect, d’une sensibilité qui l’emporte avec souvent à la clé, la victoire de mécontents.
C’est d’autant plus alarmant que les situations sans solution s’accumulent de par le monde.
L’immigration est montée en épingle car source d’incompréhension, de chocs culturels alors que ses raisons entremêlent misères, faim, violence économique ou sociale et surtout politique et militaire, appauvrissement ou accaparement des terres.
Que des humains cherchent à sauver leur vie, voilà qu’ils deviennent des criminels ou au mieux des illégaux, victimes de réseaux mafieux de passeurs.
En guise de conclusions, pouvons-nous nous dire que la victoire du nombre si essentiel à la démocratie ne peut se concevoir sans débat, sans arguments et surtout juste information ?

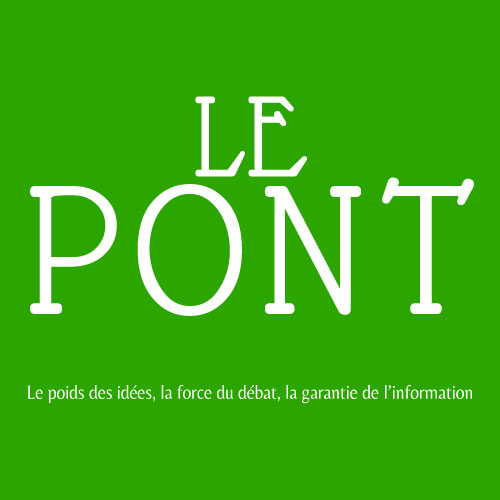

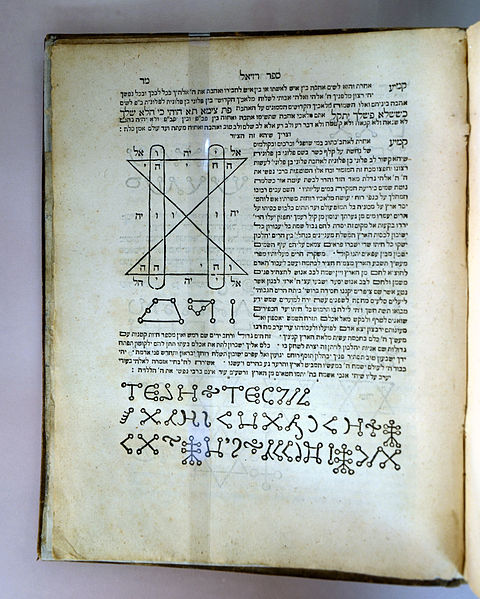



Responses