Le Proche et le lointain


Géographie et dialectique du proche et du lointain (1)
Roland Pourtier
« Proximité et distance », intitulé d’une séance de l’Académie des sciences d’outre-mer du 7 octobre 2022, peut paraître quelque peu énigmatique. Pourtant, toute l’ambition et l’immensité du sujet apparaît dès lors qu’on prend conscience que la distance et la proximité sont constitutives de l’espace, et par conséquent de la géographie qui en étudie l’agencement et l’organisation par les sociétés humaines. Toute monographie d’une parcelle de la terre, commence par en indiquer la superficie en kilomètres carrés. Et si la mesure d’un espace paraît trop abstraite, on l’exprimera, signe des temps, en nombre de terrains de football. Le rapprochement des deux termes, la mise en miroir du proche et du lointain, ouvrent de facto un registre infini de pratiques et de significations.
Entre les deux ruptures ultimes de l’être au monde que sont la naissance et la mort, la vie ne se construit-elle pas sur une trajectoire balançant sans cesse entre proximité et distance ? Pour dire les choses différemment, à l’instar de monsieur Jourdain avec la prose, tout un chacun fait en permanence de la géographie sans le savoir.
Covid 19 en apporta la preuve. En 2020, l’humanité entière fit, en temps réel, l’expérience concrète de l’espace en redécouvrant brutalement ce que signifie la distance entre le sujet et ce qui l’entoure (Umwelt). « Confinement », « présentiel », « distanciel », « visioconférence », « cluster » – d’usage jusqu’alors plutôt confidentiel – envahirent les médias. On découvrit avec stupeur l’injonction de s’isoler, de prendre ses distances vis-à-vis de l’Autre, le « prochain », pestiféré en puissance parce que proche. N’allait-on pas dans la foulée exhumer les monades des cartons scolastiques ?
Le proche et le lointain devinrent les gérants du quotidien quand on prit la mesure des risques mortifères de la proximité. La Chine opta pour la radicalité de l’enfermement. La Suède, pendant un temps, laissa faire. En France, l’interdiction de s’éloigner de plus d’un kilomètre de son domicile détermina le périmètre des pérégrinations autorisées, comme si coronavirus se pliait à l’étalon métrique… Les compas exhumés de tiroirs poussiéreux tracèrent le cercle de l’espace légalement accessible. Plus tard, cartes et GPS furent mis à contribution pour définir les limites d’une liberté spatiale élargie à 100 kilomètres. Qui ne se souvient de cette échappée belle, du bonheur de se réapproprier l’espace en élargissant l’échelle des parcours légaux ?
L’échelle, qui est à la géographie ce que la chronologie est à l’histoire, retrouvait sa fonction de métronome de nos mobilités dans l’espace-temps. La pandémie redonna toute leur force au lieu, à la place, à l’espacement, au prix d’un casse-tête topologique. Souvenons-nous, il n’y a pas si longtemps, de l’agencement des lieux accueillant du public, de la condamnation d’un siège sur deux au nom des distances de sécurité. Souvenons-nous de nos faces de zombi sous les masques.
Covid 19 a éveillé à la conscience de l’espace.
Ces quelques remarques liminaires soulignent à quel point le champ sémantique ouvert par une réflexion autour du proche et du lointain est vaste et divers. Mon propos partira de l’hypothèse selon laquelle ce qui est apparu comme extraordinaire avec l’intrusion du coronavirus, ne relève pas d’une quelconque génération spontanée, mais doit plutôt être considéré, d’une part comme un révélateur d’une dimension constitutive des sociétés humaines. D’autre part comme un accélérateur de leurs mutations. J’ai regroupé quelques-unes des réflexions que le sujet m’inspire en quatre points
1 – Espèces d’espaces
Le livre de Georges Perec, « Espèces d’espaces », introduit mon premier point. Je cite : « Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner », construisant ainsi « une géographie dont nous avons oublié que nous sommes les auteurs »[1]. Perec est sans doute l’écrivain qui s’est le plus interrogé sur l’espace, sous tous ses aspects, depuis la page où s’inscrivent les mots pour le dire, jusqu’au vaste monde englobant la totalité du réel. L’inquiétude exprimée par Pérec – « l’espace est un doute » – rompait avec les vieilles certitudes du matérialisme historique assénées par Engels dans ce lapidaire « La preuve du pudding c’est qu’on le mange ».
Il est vrai, qu’en un sens, l’espace c’est comme le pudding, sa consommation apporte la preuve de sa réalité, qu’il s’agisse de contemplation, d’aménagement, de parcours, de conquête, d’interdits. Sa perception et ses usages s’opèrent selon une gradation du proche, à portée de main, d’une réalité immédiate, vers des lointains d’autant plus flous qu’ils sont distants, jusqu’à se fondre dans un «universel» abstrait. L’Ukraine nous préoccupe par sa proximité. On s’émeut moins pour le destin des Ouigours, le Xinjiang est si loin. Le « mort-kilomètre » résume bien cette fonction de la distance qui fait d’ego le centre de l’« espace vécu », pour emprunter l’expression à Armand Frémont[2].
Nous avons cependant été bercés à la musique suave du « village planétaire », depuis que la révolution des transports a rétréci l’espace-temps. Le monde est à nous. De brillants esprits annonçaient l’un, Francis Fukuyama, « La fin de l‘histoire »[3], l’autre, Bertrand Badié, « La fin des territoires »[4], dans l’euphorie du triomphe du libéralisme économique après l’effondrement du bloc communiste.
Ces deux essais resteront emblématiques d’une mondialisation qui joua sur l’amenuisement des distances, la réduction des coûts du fret, la main-d’œuvre abondante et bon marché des pays en développement, dans un monde où la division Nord/Sud s’était substituée à la division Est/Ouest. Le principe des « avantages comparatifs », la toute-puissance du marché multiplièrent dès lors les délocalisations, jusqu’à créer les situations de dépendance dont l’Europe paye aujourd’hui le prix.
En réaction à la mondialisation libérale, comme un retour de balancier dont l’histoire est coutumière, le besoin de repères familiers, d’identité, redonne du lustre à la proximité. La vision irénique d’un monde lisse où tous les hommes se donnant la main formeraient une chaîne de fraternité est ébranlé par le « Choc des civilisations » théorisé en 1993 par Samuel Huntington. Les revendications identitaires nourries par la résurgence des mémoires et les mouvements migratoires contribuent à cette fragmentation de l’espace qui maintient l’Autre à distance.
Le territoire redevient un enjeu. Les frontières, dépréciées par le courant sans-frontiériste, retrouvent leur raison d’être. Dans un essai publié à contre-courant de la pensée dominante, « L’éloge des frontières » Régis Debray s’interroge en ces termes : « Et si le sans-frontiérisme était un leurre, une fuite, une lâcheté ? » car « Partout sur la mappemonde, et contre toute attente, se creusent ou renaissent de nouvelles et d’antiques frontières »[5]. Nous voici bien au cœur du sujet, entre proximité et distance, car la frontière correspond à un besoin de limites, de bornage, de distinction entre l’Un et l’Autre, nécessaire, quelle qu’en soit l’échelle, tant à la viabilité des sociétés qu’à l’ordre international, ce que la « société fluide » de la post-modernité ne permet pas.
A l’échelle du quotidien, le local a le vent en poupe. La France, de surcroît, ne cesse de rejouer le débat entre Jacobins et Girondins. Les lois de décentralisation de 1982 s’ancrent dans un besoin profond de reconnaissance des « territoires » dont le Sénat s’est fait le porte-parole. Indépendamment de ce débat qui interroge les politiques publiques, le local est perçu comme antidote au rouleau compresseur d’une mondialisation destructrice des particularismes culturels. Les initiatives locales érigent la proximité en vertu cardinale. Les circuits courts sont plébiscités par la clientèle aisée des villes, la même qui revendique de manger « bio ». A Paris, les magasins misant sur la proximité prolifèrent (« Au bout du champ », « Agri-Bio » et autres boutiques qui font de la « priorité au local » un argument de vente). Les « abonnés du panier », les AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) misent sur les liens de proximité entre agriculteurs convertis à l’agroécologie, et consommateurs citadins à la sensibilité écologique. Les grandes surfaces multiplient de leur côté les initiatives, pour ne pas être en reste, entre « alliances locales » et groupements régionaux de producteurs. Le « près-de-chez-vous » rapporte.
Le proche est désormais une valeur en soi, tant écologique (sauver la planète) qu’économique (sauver les paysans) que culturelle (valoriser le « terroir »). La flambée des prix de l’énergie, les menaces de rareté dans un contexte politique tendu, les craintes suscitées par les mutations énergétiques en cours ne peuvent qu’encourager les initiatives pour réduire la dépendance envers des ressources stratégiques importées. Les déboires de Nord Stream 2 sont à cet égard exemplaires des risques encourus à privilégier le marché en sous-estimant les rapports de force géopolitiques.
Étroitement associé à l’économie domestique, le proche a cependant ses limites. Les circuits absurdes illustrés par le pot de yaourt dont les composants pouvaient parcourir des milliers de kilomètres avant qu’il atterrisse sur les rayons de supermarché, ne condamnent pas pour autant les échanges à grande distance qui enrichissent l’ordinaire. Sinon cessons de consommer du café, des bananes, des ananas ou des avocats, et revenons au régime alimentaire singulièrement fruste antérieur au XVIème siècle. De toute façon, pauvre en énergie, l’Europe restera longtemps dépendante d’approvisionnements lointains. Le modèle de l’arapède n’a pas d’avenir.
Je passerai rapidement, faute de temps, sur quelques aspects pourtant très importants du sujet mais qui mériteraient chacun une séance dédiée.
– la mise à l’écart des indésirables soit par enfermement dans des prisons, « lieux de privation de liberté » (cachot, cellule, geôle, ergastule…), soit par éloignement (les bagnes d’autrefois dans les colonies, île du Diable en Guyane, Nouvelle Calédonie pour les proscrits de la Commune) ;
– la distance comme attribut de la puissance, qu’il s’agisse des empires, des capacités de projection militaire, des réseaux d’échange mondiaux. Les empires continentaux (Empire d’Alexandre le Grand, empire romain, empire mongol …) sont nés de leur capacité à contrôler les routes. Les empires coloniaux, de leur maîtrise des mers permettant de se projeter à des milliers de kilomètres. Le troisième Reich allemand s’est brisé d’être trop distendu, comme celui de Napoléon. Vladimir Poutine rêve de reconstituer l’URSS, alors que de Vladivostok aux frontières européennes les défis logistiques sont énormes. L’Empire du Milieu se projette de plus en loin de son centre, la Road and Belt Initiative renouant avec les routes de la soie et leur variante maritime qui rappelle les expéditions sur les côtes africaines de l’amiral Zheng He au début du XVème siècle.
– la conquête des espaces interplanétaires. Pendant la guerre froide, l’espace a été le grand enjeu de la rivalité entre l’URSS et les États-Unis. L’URSS marque les premiers points avec Sputnik en 1954 et le vol de Gagarine en 196I. Les États-Unis marquent le deuxième point avec le vol habité vers la lune en 1969. La conquête de l’espace reste l’apanage des super-puissances, dont désormais la Chine. Les distances parcourues donnent le vertige mais sont peu de chose par rapport aux milliards de kilomètres d’un univers en expansion. « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » disait Pascal. Les images fantastiques envoyées par Hubble et depuis 2022 par James Webb, troublent ce silence mais entretiennent cette frayeur en repoussant à l’infini les limites entre mesure et incommensurable.
– la proximité et la distance comme constituants majeurs de la géopolitique : la première réunion de la Communauté politique européenne à Prague, pas plus tard que le 6 octobre 2022, rassemblant les 44 pays composant l’Europe géographique, à l’exception de la Russie et de la Biélorussie écartées du fait de l’agression contre l’Ukraine, n’est-elle pas une tentative de donner corps à un ensemble disparate, mais que rapproche, nonobstant les déchirements du passé, la contiguïté territoriale et les héritages culturels ? La proximité n’est cependant pas une panacée : l’histoire est remplie de conflits de voisinage. Les « îles partagées » montrent combien l’unité géographique n’induit pas l’unité politique, ainsi que l’illustre l’épineuse question irlandaise.
2- Homo mobilis
Proximité et distance ne sont pas des catégories statiques. Elles ne prennent sens que dans leur rapport au temps par le truchement des mobilités. L’histoire de l’humanité s’accomplit dans l’expansion de l’oekumène et la contraction de l’espace-temps. La révolution des transports, l’a fait entrer dans l’ère de la mobilité généralisée. Toujours plus loin, toujours plus vite, du supersonique au fast food.
Covid 19 a ralenti cette course sans frein, contribuant à une revalorisation de la proximité, amorcée depuis un certain temps par les mouvements écologistes : pourquoi chercher au loin ce qu’on trouve près de chez soi ? L’éloge de la lenteur va de pair avec la protection de la planète. La « jet society » doit faire aujourd’hui profil bas, les réseaux sociaux se faisant juges de nos déplacements. Le bilan carbone est scruté avec attention. Les footballeurs qui se déplacent en avion plutôt qu’en train viennent d’être montrés du doigt, tout comme les utilisateurs de jets privés. L’espace jusqu’alors symbole de liberté, fait maintenant l’objet d’une surveillance acrimonieuse. Ne bougeons plus pour sauver la planète ! Vive Siméon le Styliste et les anachorètes.
Proximité et sobriété sont érigées en nouveaux mantras d’un monde sommé de réduire les déplacements d’un lieu à un autre, économie d’énergie et lutte contre le réchauffement climatique obligent. Ces préoccupations occultent une autre raison qui rend les déplacements problématiques depuis que la mise à portée de bourse de la terre entière a engendré le tourisme de masse. Venise est une victime emblématique de l’abolition des distances : image monstrueuse des bateaux de croisière surplombant la sublimissime.
Le monde enchanté de Lonely Planet et du Routard est secoué par l’effondrement des distances-temps qui met en branle des centaines de millions d’humains : un milliard et demi de touristes internationaux en 2019, chiffre ramené à 400 millions en 2020, mais qui est en passe de revenir au niveau d’avant Covid. Chiffres énormes, d’autant plus qu’ils s’accompagnent d’une concentration dans les lieux du désir collectif, bords de mer en été, stations de ski en hiver, villes-musées. Nourrir 10 milliards d’hommes n’est pas un problème, les tenir sur une planète non extensible en est un, beaucoup plus préoccupant pour l’avenir.
D’autant que la mobilité est un des marqueurs sociaux les plus significatifs. David Goodhart propose dans « Les deux clans »[6] une lecture du monde distinguant anywhere, ceux de partout, et somewhere, ceux de quelque-part. Se dessine ainsi une « nouvelle fracture mondiale » entre ceux qui se sentent bien partout, profitant des facilités de joindre l’ici et l’ailleurs, le proche et le lointain, et ceux qui restent attachés, volontairement ou sous la contrainte, aux lieux de leurs origines ou de leur résidence. Nouveaux nomades versus enracinés, les groupes sociaux ne cessent de se réinventer dans leur rapport à l’espace en redéfinissant les conditions de la cohabitation.
Entre proximité et distance, les déplacements sont devenus une préoccupation majeure de la quotidienneté. Les mobilités urbaines constituent un enjeu prioritaire des politiques de la ville. Les maires des grandes villes se réclamant de l’écologie doivent leurs succès électoraux à leur programme favorisant les « mobilités douces », les transports en commun et la bicyclette. Le vélo plutôt que l’auto. Une frange de la société urbaine ne se reconnaît plus en effet dans l’apophtegme qui colle aux années Pompidou : « Les Français aiment la bagnole ». C’est oublier qu’en milieu rural, il est impossible de se passer de l’automobile. Emmanuel Macron ironisant sur les Amish ou l’évocation du char à voile sonnent le glas des nostalgies défuntes. Dans le monde réel, l’occupation des ronds-points par les gilets jaunes a montré combien le coût de la distance pesait sur le budget des populations aux revenus modestes : les somewhere s’insurgeaient contre les anywhere. Entre proximité et distance, l’usage de l’espace se heurte à cette aporie indépassable : tout le monde ne peut être au même endroit au même moment.
Centre et périphérie sont ainsi devenus des figures familières d’une représentation de l’espace couplée à l’analyse politique. Le succès de « La France périphérique » de Christophe Guilluy[7] a contribué à les populariser. La distance entre centre et périphérie, modulée par l’offre de transport, constitue un paramètre essentiel des stratégies résidentielles, dans tous les pays du monde, quel que soit leur régime politique. Que règne le marché ou une bureaucratie d’État, il faut à un moment donné arbitrer entre le proche et le lointain, les isochrones et la valeur du foncier, laquelle décroît selon un gradient proportionné à la distance aux centres.
3 -Distance spatiale, distance sociale
Le vocabulaire du confinement a hésité entre « distance physique », et « distance sociale ». Cette dernière expression (formalisée en 1918 dans le contexte de la grippe espagnole comme social distanciation), s’est imposée d’emblée car, même si les recommandations officielles portent sur la distance physique – un à deux mètres de distance entre deux personnes- le social, en arrière-plan, n’est jamais loin. Le langage courant le confirme : « prendre ses distances », « garder ses distances », « tenir à distance ». Symétriquement, « être à sa place », « avoir une bonne place », « rester à sa place » – ou « s’en sortir ». L’ambivalence des mots en dit long sur ce Janus qui oppose et unit tout à la fois spatial et social.
L’habiter est à cet égard une question centrale : fractures sociales et ségrégations spatiales n’y font qu’un, de l’apartheid, forme extrême d’une séparation radicale des « races », aux processus universels de formation de ghettos. Qu’il s’agisse de race ou de classe, proximité et distance déterminent les stratégies résidentielles : valorisation de l’entre-soi, mise à l’écart de l’Autre, qu’on n’accepte comme proche que s’il est le même. Le « village planétaire » n’a jamais connu autant de persécutions des minorités. Paradoxalement, le « vivre-ensemble » se révèle de plus en plus improbable à l’ère des réseaux dits sociaux qui séparent plus qu’ils ne rapprochent en nourrissant les dérives communautaires sinon les haines. L’espace public ne l’est plus que de nom quand les identités se replient dans l’antre de l’entre-soi, maintenant l’Autre à distance. C’est pourquoi les politiques d’intégration ou d’assimilation relèvent de la quadrature du cercle, partout dans le monde.
La France en fait la démonstration avec la montée des communautarismes, conséquence de l’immigration extra-européenne. Les « territoires perdus de la République »[8] ou « Les territoires conquis de l’islamisme »[9] alertent sur la sécession de quartiers relégués par la double distance géographique et socio-culturelle. Le racial amplifie le fossé culturel, se substitue ou se surajoute au social.
On comprend à quel point la « reproduction sociale » est une question cruciale. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron[10] mirent l’accent sur les déterminants culturels. Il faut y ajouter ce que j’appellerai la « trappe résidentielle » par comparaison avec la trappe à pauvreté. On dit aujourd’hui l’ascenseur social en panne : cela est en grande partie la conséquence des assignations territoriales, de la difficulté à s’extraire des « quartiers », pour des raisons tant culturelles qu’économiques.
Le lieu colle à la peau. Il participe à la reproduction des inégalités sociales, parce qu’il est très compliqué de se soustraire au déterminisme spatial aggravé par la carte scolaire. Les stratégies résidentielles, à la base du busing aux États-Unis, étudié de longue date par des géographes comme Kevin Cox, ou les ruses pour contourner les affectations dans les établissements d’enseignement, disent la force du lien entre lieu et mobilité sociale. Le réseautage commence à l’école. Au point que nombre de familles qui en ont la possibilité s’en remettent au privé pour échapper au piège géographique. Il n’existe aucune solution satisfaisante à une question aussi décisive pour la démocratie. L’égalité spatiale étant impossible, comment corriger les inégalités sociales ? L’ouverture des lycées Henri IV ou Louis-le-Grand, à la suite de l’expérience de Sciences Po Paris, à des jeunes issus de quartiers défavorisés, pour être exemplaire, ne peut être que marginale.
Les « transfuges de classe », lesquels bénéficient depuis quelques années d’une mode médiatique dans le sillage d’Annie Ernaux[11] ou d’Edouard Louis, ne sont-ils pas, grâce à l’école, tout comme ce fut le cas d’Albert Camus qui dans son discours de réception du prix Nobel, fit l’éloge de son instituteur, des transfuges d’espace ? L’intérêt du roman d’Annie Ernaux, « La place »[12] tient dans son titre et son ambiguïté. La réussite sociale se traduit par une mise à distance du milieu d’origine, par un changement de place en se rapprochant des lieux concentrant pouvoir, avoir, savoir, beauté, tout ce sur quoi se construit la distinction. Le changement social passe, à un moment donné, par l’espace.
4- Proxémie et espace virtuel
J’emprunte à l’anthropologue américain Edward T. Hall, ce terme de « proxémie ». Dans « La dimension cachée », l’auteur expose le résultat de ses « recherches sur la façon dont l’homme utilise l’espace »[13]. Il en associe les caractéristiques culturelles à la dimension spatiale, qualifiée de « cachée » parce que généralement inconsciente, mais qui joue pourtant un rôle important dans les interactions entre individus et dans les processus de sociabilité.
Proximité et distance contribuent à la structuration aussi bien du langage que de l’ensemble des comportements qui participent à la communication. Hall évoque l’«expérience profonde, générale, non verbalisée, que tous les membres d’une même culture partagent et se communiquent à leur insu ». La communication verbale elle-même porte le sceau de la distance entre locuteurs : 10 à 20 cm pour le secret, un peu plus pour l’intime, jusqu’à plusieurs mètres pour le public. La proximité joue par ailleurs un rôle important, mais généralement sous-estimé, dans la transmission des connaissances et des savoir-faire : l’apprentissage doit beaucoup à l’imitation. Dans un registre a priori très différent, celui de la psychanalyse, le « parlêtre » de Lacan établit un pont entre être et langage, rejoignant à sa façon les considérations proxémiques.
Je ne m’aventurerai pas plus avant sur ce terrain qui ne m’est pas suffisamment familier, mais on voit bien que le sujet embrasse un champ aussi immense que complexe qui s’étend de la linguistique à la logistique, de la philosophie à la géographie : Emmanuel Kant donna l’exemple d’un enseignement associant ces deux disciplines. Entre physique et métaphysique, l’espace et le temps ont toujours été des questions fondamentales de la philosophie. Je suis parce que je suis là : le Dasein de Heidegger[14] répond au cogito cartésien en associant l’être au temps, tout autant qu’à une spatialité construite entre proche et lointain.
Depuis Hall, les recherches en rapport avec la proxémie n’ont pas cessé, celles notamment d’Abraham Moles et Elisabeth Rohmer à l’université de Strasbourg consacrées à la « Psychologie de l’espace »[15]. Il est vrai que les changements sociétaux ont donné une importance inattendue à la question de la proximité. C’est ainsi que le féminisme outre-Atlantique a poussé les hommes à ne pas se trouver seul avec une femme dans un ascenseur et à laisser ostensiblement ouvertes les portes de leur bureau. Qui sait quel effet d’aubaine pourrait jaillir d’une proximité tentatrice…Dans le même ordre d’idée, le monde du spectacle est mis sur la sellette pour le détournement d’usage des loges.
Quelques économistes se sont de leur côté emparés de la question de la proximité. Le groupe « Dynamiques de Proximité », fondé en 1993, parfois qualifié d’«École de la Proximité », et l’équipe « Proximité » dirigée par André Torre (AgroParisTech) se sont donné comme champ d’étude le rôle de l’espace et des territoires dans les relations industrielles et l’innovation. Il n’est pas sans intérêt de remarquer, qu’après un quart de siècle de recherches, leurs initiateurs confessent que « La question de la proximité géographique reste encore largement une énigme : est-ce une banalité ou l’expression d’un apport social à l’espace complexe ? »[16]. L’intuition de Pérec, « l’espace est un doute », est toujours d’actualité.
En matière de lieux de travail, « space matters » – si l’on accepte cette entorse à la francophonie. Les États-Unis avaient ouvert la voie avec les open space, à une époque où en France on privilégiait les bureaux fermés. Depuis lors, le coworking et autres variantes d’espaces collaboratifs ont fait flores avec l’épanouissement de l’économie numérique. Covid 19 toutefois a remis en question l’usage collectif et le partage des lieux de travail. Les économies avancées ont montré à cette occasion leur capacité de découplage de tout un pan de l’activité productive des lieux jusqu’alors dédiés à son exercice. Du moins partout où les infrastructures de télécommunication sont suffisamment performantes pour que le télétravail se généralise à ces nouveaux métiers qui n’ont pour outil qu’un ordinateur et un smartphone.
Aujourd’hui, télétravail, téléenseignement, télémédecine, et surtout e-commerce bouleversent les pratiques spatiales et les relations inter-individuelles. Toutefois, la dématérialisation des activités de production et de service n’élimine pas le besoin de contact physique, de proximité charnelle. Le distanciel, les visio-conférences et autres MOOC (Massive Open Online Course), restent désincarnés en comparaison du présentiel. Car la communication ne se réduit pas au message verbal, elle s’enrichit de la gestuelle, des mimiques, des regards, des odeurs, du corps sensible. Avec la fin du confinement, les relations proxémiques sont revenues en force. Il n’est que de voir la rapidité avec laquelle certains lieux de sociabilité, en particulier les terrasses de café, ont refait le plein. L’été dernier les plages étaient à nouveau noires de monde. Les corps qui se pressent les uns contre les autres dans les night-clubs, les attroupements festifs, les communions religieuses, les manifestations sportives etc. expriment ce besoin de faire corps, d’abolir pour un temps la distance en faveur d’une proximité où l’humain se ressource.
Les comportements grégaires constituent une réponse à l’envahissement de nos existences par le virtuel. Parce que les réseaux d’ordinateurs ne font pas société, même s’ils interrogent sur le monde à venir, qu’esquisse notamment Daniel Cohen dans son récent ouvrage, « Homo numericus »[17]. Le numérique ne sera pas la poétique de demain.
Des pages entières de journaux vantent ces jours-ci les mérites du « métavers » grâce auquel les chirurgiens pourront « préparer des opérations dans le monde virtuel avant d’opérer les patients ». L.es nouvelles technologies de stockage et de transmission d’information de type blockchain ou les cryptomonnaies, libérées des contingences de distance, sont censées permettre à un nombre infini de personnes de se connecter les unes aux autres. Se connecter, certes, mais à quelle fin ? L’expansion fulgurante du numérique à l’échelle mondiale, y compris dans les pays en développement – il suffit de penser au Kenya et à sa position de pointe dans l’utilisation de la monnaie électronique – modifie radicalement les pratiques socio-spatiales. Mais s’il abolit les distances, le numérique ne supprime pas pour autant le besoin vital d’être ensemble, de rechercher des affinités dans la proximité, de se « frotter la couenne ». La peau est autant enveloppe qu’osmose.
Le lien de l’Un à l’Autre, quelle qu’en soit l’échelle, famille, communauté, ethnie, nation, se construit toujours dans un balancement entre proche et lointain. « 700 millions de Chinois et moi et moi et moi, avec ma vie, mon petit chez-moi » chantait Jacques Dutronc en 1966… Dans l’introduction à un ouvrage beaucoup plus sérieux qu’une chanson, intitulé « Les cultures et le temps », Paul Ricoeur, s’interrogeant sur la temporalité des cultures écrivait ceci : « La distance dans la proximité, la proximité dans la distance, voilà le paradoxe qui règne aujourd’hui sur tous nos efforts pour reprendre les héritages culturels du passé, pour les réactiver sur un mode actuel »[18]. C’est sur cette méditation que je ferme les pages de ma géographie vagabonde qui vogue entre matière et mémoire sur les trajectoires du proche et du lointain. « J’y pense et puis j’oublie. C’est la vie, c’est la vie ».
[1] Pérec Georges, Espèces d’espace, Paris, édition Galilée, 1974.
[2] Frémont Armand, La région, espace vécu, Paris, PUF, 1976.
[3] Fukuyama Francis, La fin de l’histoire et le dernier homme, New York, The Free Press, Paris, Flammarion, 1992.
[4] Badié Bertrand, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité du respect, Paris, Fayard, 1995.
[5] Debray Régis, L’éloge des frontières, Folio, Gallimard, 2013
[6] Goodhart David, Les deux clans, Paris, Les Arènes,2019, traduction discutable du titre anglais The road to somewhere, Londres, C Hurst & Co. Ltd, 2017.
[7] Guilluy Christophe, La France périphérique, Paris, Flammarion, 2014.
[8] Brenner Emmanuel, pseudonyme de Bensoussan George, Les territoires perdus de la République, Paris, édition Mille et une nuit, 2002.
[9] Rougier Bernard (dir.), Les territoires conquis de l’islamisme, Paris, PUF, 2020.
[10] Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude, Les héritiers, Paris, Éditions de Minuit, 1964.
[11] Texte rédigé avant l’attribution du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux
[12] Ernaux Annie, La place, Paris, Gallimard, 1983.
[13] Hall T. Edward, La dimension cachée, Paris, Éditions du Seuil, 1971, traduction de The Hidden Dimension, New York, Doubleday,1966.
[14] Heiddeger Martin, Sein und Zeit, 1927, Être et temps, Gallimard 1992.
[15] Moles Abraham et Rohmer Élisabeth, Psychologie de l’espace, Paris, Casterman, 1972. Voir aussi le recueil de textes Psychosociologie de l’espace, Paris, L’Harmattan, 1998.
[16] Torre André, « Proximités : retour sur 25 ans d’analyse », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 2018, 5/6, pp 917-936.
[17] Cohen Daniel, Homo numericus. La civilisation qui vient, Paris, Albin Michel, 2022.
[18] Ricoeur Paul, Les cultures et le temps, Paris, UNESCO, Payot, 1975.
Professeur émérite des Universités, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer
-
Roland Pourtierhttps://lepontdesidees.fr/author/rpourtierauteur/
-
Roland Pourtierhttps://lepontdesidees.fr/author/rpourtierauteur/




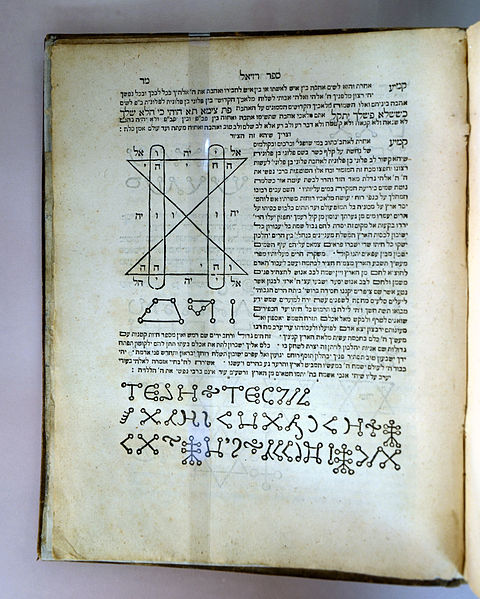


Responses