La géopolitique mondiale du nucléaire


Les relations entre Etats se sont profondément modifiées en quelques années, annonçant la fin d’une internationalisation « heureuse », vers des rapports de force de plus en plus explicites.
Dans le paysage qui se dessine, le rôle de l’énergie nucléaire, au côté des énergies renouvelables, apparait comme essentiel ; l’énergie nucléaire se retrouve de nouveau au cœur de la géopolitique mondiale. Et dans la période actuelle de tensions internationales, les relations de pouvoir et d’influence entre les États font l’objet de nombreuses exégèses qui en intègrent les dimensions territoriales, politiques, démographiques, économiques, culturelles et environnementales. Sur l’énergie, indispensable pour satisfaire les besoins de la vie quotidienne, faire fonctionner l’économie des pays et permettre leur développement, les études géopolitiques se concentrent généralement sur l’accès aux ressources, particulièrement sensible pour le pétrole et le gaz, très inégalement distribuées.
La matière première combustible de l’énergie nucléaire, l’uranium, est moins localisée et d’un stockage aisé ; ses variations de prix affectent faiblement le coût de l’électricité produite. Sa disponibilité reste néanmoins un enjeu, comme on peut le constater au-travers des politiques actives chinoises et russes en Afrique. Cependant, d’autres facteurs, tels que l’accès à la technologie et au savoir-faire, ainsi que celui aux ressources financières, structurent et organisent les analyses géopolitiques concernant le nucléaire civil.
Depuis le discours « Atoms for peace » (1953) de Dwight Eisenhower à l’ONU, la géopolitique du nucléaire civil a évolué, mais reste marquée par la forte dépendance du pays acheteur de réacteurs vis-à-vis du pays vendeur, et cela sur de très longues périodes, malgré les bouleversements géopolitiques profonds survenus dans le monde depuis. Trente-cinq ans après la chute de l’empire soviétique, le russe Rosatom est encore le fournisseur quasi-exclusif du combustible des réacteurs VVER de l’Europe de l’Est et Westinghouse en est resté un fournisseur important pour les réacteurs occidentaux de conception américaine.
La Russie, malgré ses vastes ressources fossiles, a maintenu le développement de son nucléaire civil et étendu son influence en vendant de nombreux réacteurs à l’étranger. Actuellement, elle a en cours des réalisations dans une dizaine de pays importants au niveau mondial ou régional, dont la Chine, l’Égypte, la Hongrie, l’Inde et la Turquie. A l’opposé, les Etats-Unis ont mené une politique nucléaire erratique et arrêté les constructions sur leur sol pendant une longue période, l’électricité nucléaire n’y étant plus compétitive contre les énergies fossiles, le charbon, puis, maintenant, le gaz de schiste. Leur industrie est alors devenue moins influente dans un marché mondial atone après les accidents de Tchernobyl puis de Fukushima. Toutefois, depuis quelques années, les Etats-Unis ont pris conscience du retard qui se creusait avec la Russie et la Chine. Surlignant le lien intrinsèque de l’énergie nucléaire avec la sécurité nationale, ils se sont fixé l’objectif de redevenir leader mondial du nucléaire civil. Cette stratégie offensive et visible en Europe avec l’AP1000 de Westinghouse et la promotion des SMR de conception américaine.
La constance de la politique nucléaire fut aussi très variable chez d’autres grands acteurs du nucléaire mondial. Le Royaume-Uni de l’ère Thatcher, après la mise en exploitation des ressources fossiles de la mer du Nord, a démantelé les capacités nucléaires industrielles du pays, pourtant très significatives sur les réacteurs et le cycle du combustible. La Canada, qui maitrisait sa propre filière, à eau lourde, a aussi arrêté les développements de réacteurs.
L’accident de Fukushima a mis à l’arrêt de nombreuses centrales japonaises et fragilisé l’industrie nationale au moment où elle commençait à s’attaquer aux marchés mondiaux ; elle ne semble plus aujourd’hui en capacité de jouer un rôle en dehors du Japon dans la dynamique qui se dessine.
L’Allemagne a rejeté l’usage de l’énergie nucléaire et son industrie a soit périclité, soit a été vendue à la France.
La Corée du Sud et la France continuent d’être actives sur le marché des réacteurs, avec plusieurs succès internationaux. Elles proposent chacune un produit moderne et éprouvé : l’APR-1400 pour la Corée et l’EPR pour la France.
Au bilan, seuls ces deux pays, avec les Etats-Unis, la Chine et la Russie ont la capacité de proposer des modèles de réacteurs qualifiés sur le marché international.
Les petits réacteurs modulaires (SMR) sont l’objet d’un intérêt général ; ils visent à introduire de l’agilité et provoquer une rupture dans l’évolution d’une industrie dont la taille et la complexité des produits sont en constante augmentation. De nombreux pays, une vingtaine d’après l’AIEA, cherchent à tirer parti de ce mouvement pour créer ou relancer leurs capacités de conception et de réalisation de réacteurs, et réduire ainsi leur dépendance pour de nouvelles réalisations nucléaires. Par exemple, parmi eux, il y a le Royaume-Uni qui compte ainsi profiter du renforcement de son industrie nucléaire, porté par la réalisation d’Hinkley Point, pour recréer des capacités de conception nationales. Les cycles de développement dans le nucléaire sont longs, même pour les petits réacteurs, on ne peut donc pas parier sur l’arrivée de nouveaux entrants pouvant influencer le jeu géopolitique mondial avant une dizaine d’années. Pour l’instant, seules la Chine et la Russie ont fait la démonstration de la viabilité technique de leurs concepts de SMR, mais ne les ont pas encore exportés et leur viabilité économique reste incertaine.
Lors de l’acquisition d’un réacteur, la dépendance ne se limite pas aux produits et services nécessaires au fonctionnement, mais concernent aussi l’accès aux capitaux nécessaires à la construction, au-travers de prêts dans lesquels le pays vendeur a souvent une contribution importante. Les taux d’intérêt accordés ont un impact majeur sur l’économie de projets dont la réalisation se situe généralement sur une dizaine d’années. L’ingénierie financière est donc essentielle, et dépend des capacités du pays acheteur et du pays vendeur, ainsi que des choix d’allocation des risques de réalisation entre les deux. Un exemple notable est celui de la Russie ; la centrale d’Akkuyu en Turquie, en cours de construction, est fournie et financée par Rosatom, qui en sera également le propriétaire-exploitant. Le combustible usé sera repris par la Russie, et l’engagement turc consiste simplement à racheter une partie de l’électricité produite à un tarif préétabli, le reste étant vendu au tarif du marché. Aucun risque sur ce projet pour la Turquie, mais, en contrepartie, une part significative de la production électrique turque sera sous contrôle total russe pendant des décennies. Bien qu’il s’agisse d’un cas extrême, le financement a toujours été au cœur des projets nucléaires à l’export, même avec l’emploi de schémas plus classiques.
La géopolitique du nucléaire civil se joue enfin sur le cycle combustible dont certaines technologies, l’enrichissement de l’uranium et le retraitement du combustible usé, peuvent être utilisées à des fins militaires et qui présentent donc des risques de prolifération. Il y a un consensus international pour limiter leur diffusion et les installations civiles existantes sont soumises au contrôle de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA).
Un deuxième point important pour le combustible nucléaire est sa densité énergétique qui facilite son stockage, facilitant la création de réserves stratégiques et la spéculation des acteurs du marché.
L’uranium n’est pas un minerai rare, mais la rentabilité de son exploitation est corrélée à sa concentration. Il est actuellement extrait dans une douzaine de pays d’un poids géopolitique très variable, comprenant le Kazakhstan (45% de la production mondiale), le Canada (14%), la Namibie (11%), l’Australie (9%), l’Ouzbékistan (7%), et présente des réserves identifiées couvrant les besoins mondiaux jusqu’à la fin de ce siècle, les plus importantes étant en Australie.
Les mines sont opérées par de grands groupes internationaux, principalement américains, australiens, chinois, canadiens, français et russes, en partenariat avec des sociétés locales. L’uranium est ensuite converti dans une forme gazeuse pour être enrichi. La dernière étape, la fabrication des assemblages, est dans la plupart des cas réalisée par les vendeurs de réacteurs, dans un marché qui peut être compétitif pour certains types de combustible, et de niche pour d’autres.
Dans tous les cas, on retrouve toujours un nombre limité de pays maitrisant des technologies d’un accès difficile, et seuls la Chine, les Etats-Unis, la France et la Russie possèdent des capacités couvrant à peu près l’ensemble du cycle.
L’accident de Fukushima en 2011 a mis à l’arrêt, transitoire ou définitif, de nombreux réacteurs dans le monde. Les capacités de production du cycle combustible se sont trouvées largement surdimensionnées, faisant chuter les prix et conduisant à la fermeture de mines et d’installations. La Russie a profité de cette période pour devenir le producteur de référence du marché mondial. L’invasion de l’Ukraine a mis en évidence cette dépendance à un moment où un nombre important de nouveaux réacteurs sont lancés ou mis en production, induisant des investissements importants pour la réouverture de mines et la construction de nouvelles installations de conversion et d’enrichissement.
L’énergie nucléaire impose des échelles de temps incomparablement longues pour former les personnes, maitriser les technologies, construire des réacteurs et réaliser des installations dont la durée de vie couvre le siècle. Devenue une composante importante de la lutte contre le réchauffement climatique, elle s’impose fortement dans la géopolitique d’un monde en profonde mutation où les alliances peuvent se nouer ou dénouer rapidement.
La complexité technique du nucléaire du 21e siècle, de son financement et de sa chaîne d’approvisionnement exigent une réponse européenne unifiée, combinant innovation technologique, coopération transfrontalière et stratégie industrielle ambitieuse. Sans cela, l’UE risque de perdre sa souveraineté énergétique face aux géants américains, russe et chinois, tout en échouant à atteindre ses objectifs climatiques.
La France, un des rares pays qui a sauvegardé en grande partie ses capacités, est un atout pour l’Europe dans un monde où les rapports de force deviennent plus brutaux et les dégâts provoqués par le réchauffement climatique plus apparents.
Ancien président de NucAdvisor
-
Alain Valléehttps://lepontdesidees.fr/author/avaleeauteur/
-
Alain Valléehttps://lepontdesidees.fr/author/avaleeauteur/
-
Alain Valléehttps://lepontdesidees.fr/author/avaleeauteur/
-
Alain Valléehttps://lepontdesidees.fr/author/avaleeauteur/

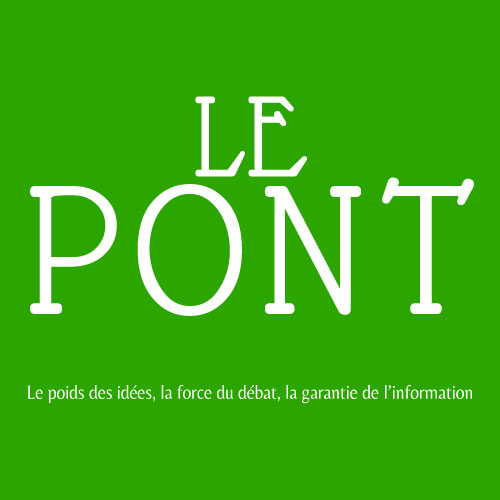






Responses