Affaire Le Pen : la politique saisie par le droit ? Ou l’inverse ?


Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 31 mars sur l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national condamnant Marine Le Pen à une peine d’inéligibilité de cinq ans immédiatement exécutoire a provoqué un déferlement de critiques et de polémiques rarement atteint à propos d’une décision de justice.
Que n’a-t-on pas entendu ? Démocratie « exécutée », « gouvernement des juges », « justice politique », etc. Les Médias en faisant des tonnes, rajoutant aux indignations de certains politiques des commentaires outranciers transformant cette affaire en véritable tsunami.
Car ce jugement, en vérité, n’est que la stricte application de la Loi, en l’espèce la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, prolongée par l’article 131-26-2 du code pénal issu de la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017, qui prévoit une peine complémentaire d’inéligibilité obligatoirement prononcée à l’encontre des coupables de crimes ou de délits, parmi lesquels les détournements de fonds publics, soit l’infraction précisément reprochée à Marine Le Pen.
Ainsi, le tribunal correctionnel a d’abord considéré que les faits qui lui étaient reprochés étaient suffisamment probants et convaincants pour la considérer comme coupable : un détournement de fonds publics européens d’une durée de plus de dix ans (de 2004 à 2016), d’un montant de plus de 4 millions d’euros, organisé et systématisé pour financer le parti RN lui-même. Or, s’il y a une culpabilité, il doit y avoir une peine, et en l’espèce une double peine, car à la peine principale de quatre ans d’emprisonnement dont deux ferme et de 100.000 euros d’amende, s’est ajoutée la peine d’inéligibilité de cinq ans avec application immédiate prévue par l’article 131-26-2 du code pénal.
Ensuite, les juges ont retenu que Marine Le Pen a joué dans cette affaire, du début à la fin, un rôle central et déterminant, et que pour cette raison elle ne pouvait pas échapper à une lourde condamnation, d’autant plus que sa défense a consisté à refuser en permanence de reconnaitre avoir commis la moindre infraction.
Enfin, quant à l’inéligibilité et à son caractère exécutoire, les juges ont dû suivre la loi, qui la leur impose, sauf à eux d’écarter cette peine, mais en motivant leur décision. C’est là que réside le paradoxe, mal compris par la plupart des commentateurs et évidemment par les condamnés : c’est au Tribunal correctionnel qu’il appartenait de démontrer pourquoi il ne prononçait pas l’exécution immédiate de l’inéligibilité, et non l’inverse. Disposition pouvant apparaître comme contestable mais validée par le Conseil Constitutionnel en 2017 comme ne méconnaissant pas le principe d’individualisation des peines. C’est la raison pour laquelle le Tribunal a dû justifier l’application immédiate de l’inéligibilité par des motifs réels et sérieux, au premier rang desquels le risque de récidive, puisque Marine Le Pen n’a jamais reconnu tout au long du procès le caractère délictuel des faits qui lui étaient reprochés.
La décision des juges est donc justifiée et correspond de plus à une jurisprudence solidement établie en la matière, les exemples récents d’élus sanctionnés d’une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire à la suite de détournement de fonds publics étant légion : parmi eux, pour n’en citer que deux, l’ancien président de la Polynésie, Gaston Flosse, et l’ancien maire de Toulon, Hubert Falco.
L’inéligibilité avec exécution provisoire a donc été systématiquement décidée par les juges dans tous les cas semblables à celui de Marine Le Pen. Celle-ci aurait donc dû être moins confiante et ne pas adopter la ligne de défense contreproductive qui a été la sienne pendant le procès. D’autant plus que le Parquet, rappelons-le, avait eu la main lourde, puisqu’il avait requis contre elle cinq ans de prison dont deux ferme, 300.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire. Elle savait ainsi, en tant qu’avocate elle-même, parfaitement à quoi s’en tenir.
La loi, rien que la loi, mais toute la loi : voilà ce qui justifie, juridiquement, la décision du Tribunal correctionnel de Paris.
Mais en l’espèce, si la politique a bel et bien été saisie par le droit[1], serait-il totalement impossible que l’inverse se soit également produit ? La politique ne se serait-elle pas, parallèlement, saisie du droit ?
Telle est la question qui mérite d’être évoquée, en reprenant étape par étape les épisodes marquants de cette affaire.
- 1/ Pourquoi les députés du Rassemblement national ont-ils permis à Richard Ferrand d’accéder à la présidence du Conseil Constitutionnel en s’abstenant lors du vote de la commission des lois le 19 février 2025, alors qu’ils avaient la possibilité de l’en empêcher ? Marine Le Pen espérait-elle une éventuelle faveur en retour ?
- 2/ L’occasion attendue s’est d’ailleurs présentée le 28 mars 2025 avec une décision QPC concernant l’exécution immédiate d’une peine d’inéligibilité d’un élu municipal mahorais, où le Conseil Constitutionnel a émis une « réserve d’interprétation » laissant entendre que le juge qui décide de l’exécution immédiate doit tenir compte de « la préservation de la liberté de l’électeur». Voilà qui a pu faire croire à Marine Le Pen qu’elle pourrait en profiter en tant que candidate à la prochaine élection présidentielle. Mais l’espoir fut vite déçu, le Tribunal correctionnel de Paris ayant décidé de ne pas la faire bénéficier de l’opportunité offerte par le Conseil Constitutionnel.
Alors que, en revanche, les juges en ont fait profiter Louis Alliot, n’assortissant pas son inéligibilité d’une exécution immédiate en invoquant, précisément, « la préservation de la liberté de l’électeur » dans la perspective des prochaines municipales, lui permettant ainsi de ne pas être déchu de son mandat de Maire de Perpignan.
C’est là que se situe assurément le point crucial de toute cette affaire : il était tout à fait possible de faire profiter Marine Le Pen, elle aussi, de la même indulgence. Or cela n’a pas été le cas. Sur ce point précis, est-ce le droit, ou la politique qui l’a emporté ? - 3/ Compte tenu du séisme politique et médiatique provoqué par cette décision, promesse a été faite que l’appel interjeté par Marine Le Pen serait jugé dans les meilleurs délais, c’est-à-dire dès l’été 2026, ce qui peut lui laisser, ici encore, le nouvel espoir d’une « seconde chance » de se présenter à l’élection présidentielle de 2027.
- 4/ En tout cas, ces avatars successifs n’auraient-ils pas pour objet, tout compte fait, de conduire le Rassemblement national à ne pas déstabiliser le système institutionnel, donc à ne pas censurer le Gouvernement, à ne pas provoquer une nouvelle dissolution et surtout à ne rien faire qui puisse entraîner une élection présidentielle anticipée ? Et, du côté de Marine Le Pen, sa victimisation ne pourra que la favoriser dans les sondages et renforcer son poids électoral. Bref, une sorte d’arrangement gagnant-gagnant, mais dont nul ne sait quelle en sera l’issue.
[1] Pour reprendre le titre de l’un des ouvrages majeurs de Louis FAVOREU « La politique saisie par le droit », Economica, 1988.
Professeur de droit public à l’IPAG de l’Université Panthéon Assas
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/

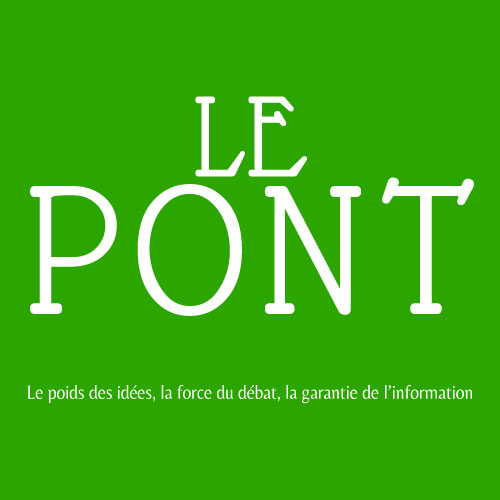


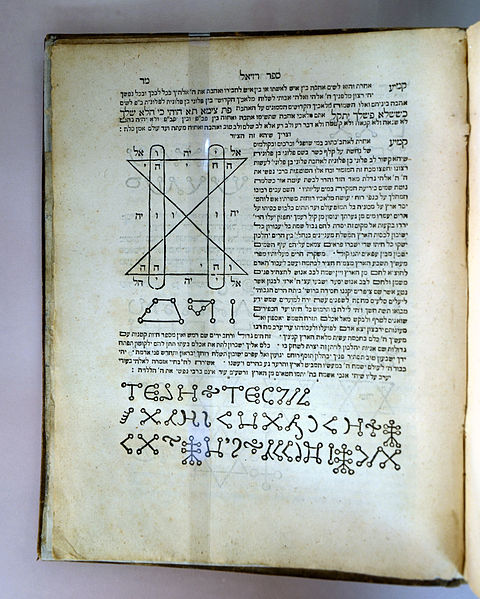



Responses