Communication de Bernard Salha au Xe Forum Européen Franco-Allemand

Bernard Salha*
Depuis plus de vingt ans, la France et l’Allemagne travaillent côte à côte dans le domaine de l’énergie. Cette coopération ne se limite pas à des déclarations d’intention. Elle se traduit par des initiatives concrètes, visibles et durables. L’European Institute for Energy Research (EIFER), créé en 2002 par EDF et le Karlsruhe Institute of Technology KIT, sous la forme juridique d’un Groupement d’Intérêt Economique Européen, et localisé à Karlsruhe en est l’illustration la plus claire.
Sa création s’est inscrite dans le cadre du partenariat industriel entre EDF et l’énergéticien allemand du Baden-Württemberg EnBW initié en 2001. C’est tout naturellement qu’EDF s’est tournée pour ce partenariat de recherche vers l’Université de Karlsruhe, reconnu au plus haut niveau dans la communauté scientifique (devenu en 2009 le Karlsruhe Institute of Technology, par la fusion de l’Université de Karlsruhe avec le Forschungszentrum Karlsruhe de la société Helmholtz).
Ainsi dès sa fondation, l’institut avait une ambition simple et ambitieuse : associer l’expertise d’un grand énergéticien français à l’excellence scientifique d’une université allemande de premier plan. Vingt ans plus tard, cet objectif a porté ses fruits. L’institut joue un rôle clé dans la transition énergétique vers des systèmes durables et neutres en carbone en Europe. Il agit comme un lien entre EDF et le Karlsruhe Institute of Technology (KIT), favorisant la coopération scientifique et industrielle notamment dans les domaines de l’hydrogène, des é-fuels, des systèmes énergétiques intelligents et de l‘environnement, qui fera l’objet d’une intervention plus tard cet après-midi.
Plus de cent dix chercheurs – venus non seulement de France et d’Allemagne, mais aussi de plus de quinze autres nationalités y travaillent aujourd’hui. Cette diversité illustre l’ouverture européenne et internationale de notre coopération.
Pour EDF, EIFER permet d’élargir l’expertise de sa Recherche et Développement (environ 2000 chercheurs) grâce à l’expérience et l’excellence académique et d’innovation allemande, sur les sujets e-fuels une bonne compréhension approfondie de la transition énergétique en Allemagne.
Une coopération scientifique et humaine
EIFER n’est pas seulement un centre de recherche. C’est un lieu de rencontre, un espace de collaboration où des cultures scientifiques différentes se croisent et s’enrichissent mutuellement. La diversité des profils – ingénieurs, physiciens, chimistes, économistes, spécialistes de l’environnement – permet d’aborder la transition énergétique dans toute sa complexité.
En effet, la transition énergétique n’est pas uniquement une question technique. Elle touche aux choix industriels, aux modes de vie, aux équilibres territoriaux et même à la stabilité géopolitique. En réunissant des chercheurs de différents horizons, EIFER développe une approche systémique. Cette méthode est essentielle pour anticiper les évolutions à venir et construire des solutions adaptées.
Pour le KIT, c’est l’opportunité de valoriser ses compétences scientifiques dans le domaine de l’énergie (plus de 5000 chercheurs) et d’augmenter sa visibilité à l’international via ce partenariat avec un énergéticien d’envergure mondiale.
Ainsi, EIFER peut être vu comme le trait d’union ou le « traducteur » entre l’énergéticien et les instituts de recherche du KIT, ayant le souci d’apporter de la valeur à ses 2 membres, en associant
également d’autres partenaires académiques et/ou industriels et notamment des start-ups, comme accélérateur d’innovation.
Des thèmes de recherche stratégiques
Depuis sa création, l’institut s’est concentré sur des sujets qui sont aujourd’hui au coeur des politiques européennes :
• L’hydrogène et ses dérivés : vecteur énergétique pour décarboner l’industrie et les transports.
• Les e-fuels : carburants de synthèse indispensables pour l’aviation et le maritime, deux secteurs difficiles à électrifier.
• Les systèmes énergétiques locaux et intelligents : nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables et gérer les flux de manière efficace.
• La séquestration du carbone par les écosystèmes : un foyer de solutions naturelles à mobiliser en complément des solutions technologiques.
• La gestion durable de l’environnement : afin de concilier transition énergétique et préservation des ressources naturelles.
Chacun de ces thèmes répond à un besoin identifié. Chacun s’inscrit dans une logique d’application concrète. Les recherches menées à Karlsruhe sont donc directement reliées aux attentes de l’industrie et des collectivités.
Des projets concrets et ambitieux
Pour illustrer la force de la coopération franco-allemande, il est utile de citer quelques projets emblématiques.
• Le projet HADES : il associe EIFER, le DLR en Allemagne, le CNRS en France, et plusieurs autres laboratoires européens. Son objectif est de produire de l’hydrogène à partir de l’ammoniac, une molécule facile à stocker et à transporter. L’ammoniac peut être produit à partir d’hydrogène renouvelable et d’azote, disponible en abondance dans l’air. Sa décomposition permet ensuite de libérer de l’hydrogène pur, utilisable comme carburant. Cette solution offre des perspectives intéressantes pour le stockage saisonnier de l’énergie et pour l’approvisionnement de secteurs industriels éloignés des sites de production.
• Le projet POSEIDON : il vise à transférer vers l’industrie les résultats des recherches menées au KIT sur les carburants de synthèse. Les e-fuels combinent hydrogène renouvelable et CO₂ capté dans l’air ou dans les procédés industriels. Ils constituent une alternative crédible aux carburants fossiles, en particulier pour l’aviation et le transport maritime. POSEIDON permet de passer de la recherche fondamentale à des applications industrielles concrètes.
• Les partenariats industriels : la collaboration avec Sunfire, entreprise pionnière dans le domaine de l’électrolyse haute température, illustre le lien étroit entre recherche et innovation. Sunfire développe des électrolyseurs capables de produire de l’hydrogène vert de manière plus efficace. Avec Bosch, un acteur majeur de l’industrie allemande, EIFER travaille sur l’industrialisation de ces électrolyseurs, étape cruciale pour réduire les coûts et favoriser une adoption à grande échelle.
Ces projets démontrent la solidité du partenariat. Ils prouvent que la coopération franco-allemande n’est pas seulement un slogan, mais une réalité qui produit des résultats tangibles.
Ce tour d’horizon est loin d’être complet : il faut également mentionner les entreprises créées à partir du savoir-faire développé, telles qu’EIFHYTECH ou URBANOMY.
Une complémentarité entre nos deux pays
Ce qui fait la force de la coopération, c’est la complémentarité des approches. La France et l’Allemagne n’ont pas les mêmes traditions énergétiques, ni les mêmes choix de politique énergétique.
L’Allemagne, plaque tournante du marché européen de l’électricité, est située au centre de l’Europe et constitue ainsi une région stratégique pour les flux d’électricité. Il est essentiel de bien comprendre le développement des technologies innovantes ainsi que leur impact sur les marchés et les systèmes électriques européens afin de garantir la stabilité et la sécurité du système énergétique européen.
EIFER apporte de son côté une contribution importante en fournissant des analyses sur les nouvelles réglementations européennes, étudient leurs impacts sur les systèmes énergétiques, anticipent l’évolution des marchés et expérimentent de nouveaux modèles d’innovation. La complémentarité permet d’aller plus loin que ce qu’un seul pays pourrait accomplir.
Une complémentarité qui s’est renforcée avec des accords concrets en matière d’énergie qui ont été conclus lors de la rencontre fin août 2025 entre le chancelier fédéral Friedrich Merz et le président Emmanuel Macron dans le cadre du 25e Conseil des ministres franco-allemand comprennent notamment les éléments suivants :
1. Un accord-cadre de soutien mutuel en matière de politique énergétique entre l’Allemagne et la France, qui comprend un
règlement du différend de longue date sur l’énergie nucléaire. L’Allemagne renonce à une classification négative de l’énergie nucléaire dans l’UE, tandis que la France soutient la stratégie allemande en matière d’hydrogène et une meilleure interconnexion des réseaux électriques.
2. Un engagement commun à développer une architecture énergétique européenne coopérative d’ici 2040, axée sur la sécurité des investissements, la diversité technologique et la sécurité d’approvisionnement.
3. La promotion de projets d’infrastructure concrets, tels que l’extension du corridor sud-ouest de l’hydrogène (H2Med, HY-FEN) et l’amélioration des interconnexions entre les deux pays, ainsi que la coopération avec la Pologne.
4. Accords sur la comptabilisation du CO₂, la réduction des obstacles réglementaires et la flexibilisation des prix de l’électricité, en particulier pour les industries à forte consommation d’énergie.
Ces accords visent à renforcer la coopération entre l’Allemagne et la France en matière d’approvisionnement énergétique, à consolider le marché européen de l’énergie et à favoriser la transition vers des technologies neutres sur le plan climatique.
Le principe de la neutralité technologique soutenue par la Commission européenne est une voie également très prometteuse pour nos pays.
Les règles et politiques de l’UE définies dans ce cadre ne doivent pas favoriser ni discriminer une technologie particulière. Autrement dit, la réglementation doit rester indépendante du choix technique : ce qui compte, ce sont les résultats ou les objectifs (sécurité, protection des données, durabilité, concurrence, réduction des émissions…).
• Pas de préférence imposée : l’UE ne dicte pas quelle technologie doit être utilisée, toutes sont acceptables dans la
mesure où elles permettent d’atteindre l’objectif de neutralité carbone.
• Favoriser l’innovation et la concurrence : chaque acteur peut développer ou utiliser la technologie de son choix, tant qu’elle respecte les normes et objectifs définis.
• Flexibilité et adaptation : comme les technologies évoluent très vite, ce principe évite que la réglementation devienne obsolète trop rapidement.
Dans le domaine de l’énergie et du climat, les objectifs de réduction de CO₂ ou d’efficacité énergétique sont fixés, mais les entreprises et États membres choisissent eux-mêmes les moyens techniques (éolien, solaire, nucléaire, hydrogène…).
Une coopération qui dépasse la recherche
La collaboration ne s’arrête pas aux laboratoires. Elle inclut également la formation et l’ancrage territorial.
• La formation : le KIT propose des doubles diplômes franco-allemands, des thèses en cotutelle et des universités d’été. Ces programmes préparent une nouvelle génération de scientifiques et d’ingénieurs européens, capables de travailler dans un cadre international et d’aborder les défis de la transition énergétique avec une vision globale.
• Les territoires : la coopération est particulièrement visible dans la région trinationale du Rhin supérieur, où Français, Allemands et Suisses développent ensemble des projets de mobilité propre, d’économie circulaire et de réseaux énergétiques intelligents. Cette région joue le rôle de laboratoire grandeur nature. Les expériences menées localement peuvent ensuite être reproduites ailleurs en Europe.
Les défis à venir
Les enjeux énergétiques qui se posent aujourd’hui sont considérables :
• Décarboner l’industrie lourde, qui reste fortement dépendante des énergies fossiles.
• Trouver des solutions pour l’aviation et le maritime, secteurs qui représentent une part croissante des émissions mondiales.
• Déployer des réseaux intelligents capables d’intégrer massivement les énergies renouvelables.
• Développer des solutions de stockage, qu’il s’agisse d’hydrogène, de batteries stationnaires ou de chaleur stockée dans des matériaux solides.
• Renforcer l’efficacité énergétique, notamment dans les bâtiments et les infrastructures urbaines.
Aucun pays ne peut relever seul ces défis. Mais ensemble, la France et l’Allemagne disposent des compétences scientifiques, des capacités industrielles et de l’expérience de coopération nécessaires pour y parvenir.
Conclusion
Depuis plus de vingt ans, EIFER incarne la coopération franco-allemande dans le domaine de l’énergie. Ce partenariat est un exemple de confiance, de continuité et de résultats concrets.
Il a déjà permis de réaliser des avancées significatives. Il continue de produire de nouvelles solutions, au service de la transition énergétique. Et il prépare l’avenir en formant de jeunes chercheurs et en associant l’industrie aux efforts de recherche.
Ainsi la promotion de la neutralité technologique soutenue par la Commission européenne qui fixe les cibles attendues, tout en laissant libre le choix des technologies qui permettront de les atteindre, est une voix complémentaire pour renforcer cette coopération. EIFER a la capacité d’y contribuer..
C’est ainsi, par le travail commun, par la complémentarité des approches et par la continuité de l’effort, que nous pourrons construire un système énergétique européen plus sûr, plus propre et plus durable.
* Directeur R&D d’EDF, Président de la SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform)
Vous pourrez retrouver l’ensemble des communications du Xe Forum Européen Franco Allemand dans un prochain numéro de Passages.
-
Bernard Salhahttps://lepontdesidees.fr/author/bsalhaauteur/

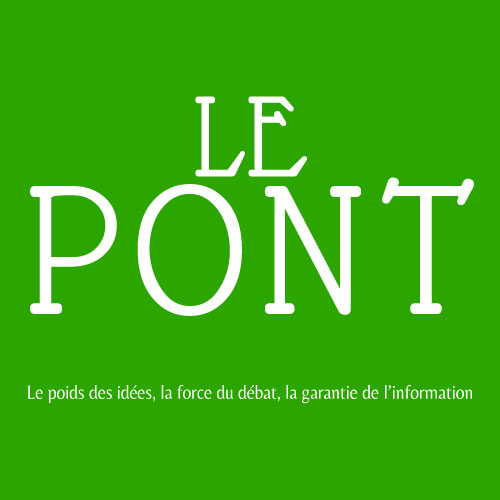






Responses