Énergie : ZFE, PPE, DPE – les langages sont loin d’être neutres


La politique énergétique a connu depuis la crise de décembre 73 des inflexions et retournements fantastiques, en France, dans l’Union Européenne, au niveau mondial. Ici, nous retrouvons en juin 2025 des débats importants : ZFE, PPE, DPE ,… Il faut clarifier dans les termes de ces débats les concepts que nous utilisons : sont-ils obsolètes ? détournés de leur sens initial ? reflètent-ils les équilibres d’aujourd’hui entre les préoccupations et les groupes d’intérêts ? Qu’en est-il en particulier pour le domaine résidentiel et tertiaire ?
Je propose de regarder la genèse de la situation actuelle et l’évolution des langages utilisés.
Après le choc pétrolier de 1973, la France crée l’agence qui deviendra l’ADEME, engage la réalisation d’un important parc de centrales électronucléaires standardisées, lance des programmes d’économies d’énergies dans les mobilités, l’industrie, le résidentiel, remplace par le TGV le projet d’aérotrain Paris-Lyon, … On a même en septembre 1974 un plan de retour du charbon ! A ce moment, l’électricité en France est encore largement produite à partir du fuel lourd et du charbon, avec bien sûr un socle robuste d’hydroélectricité et une contribution modeste d’un « nucléaire de première génération ». Pour construire des statistiques, on introduit des « coefficients d’équivalence en énergie primaire » : combien de kWh d’électricité produit-on à partir d’une tonne de pétrole ? de charbon ? La préoccupation du changement climatique s’impose au plan international à partir de la Conférence de Rio (1992) : la perspective n’est pas totalement identique à la volonté de « maîtrise de l’énergie » de la période précédente mais on change peu la stratégie en France. Surtout, on doit relever ici la montée d’un rôle fort de Bruxelles qui dispose d’une « compétence partagée » avec les États membres. On eut le protocole de Kyoto puis le plan « 3X20 en 2020 » adopté en décembre 2008 ; pour l’électronucléaire, le mariage franco-allemand rêvé en 1989 engendre l’EPR qui subira le grave échec d’Abu Dhabi , avant un divorce en 2009. Les réglementations thermiques successives durcissent les contraintes pour le résidentiel en conservant le « coefficient d’équivalence en énergie primaire (CEP) » de 2,58 qui prend une image de vérité objective. Fukushima en 2011 déclenche des réactions antinucléaires dans plusieurs pays, y compris chez nous où apparaît l’idée de faire tomber à 50% la part du nucléaire dans la production d’électricité. Les budgets publics consacrés à la rénovation thermique du résidentiel croissent mais le mécanisme du « diagnostic de performance énergétique DPE » est accusé de servir de support à des fraudes et tricheries. La guerre en Ukraine déclenche de graves conséquences sur le marché du gaz naturel et le coût des énergies fossiles : l’électronucléaire est remis en selle dans plusieurs pays. En France, le Président de la République annonce à Belfort en février 2022 des virages importants pour l’éolien, le solaire et le « nouveau nucléaire » : l’électricité va être pour 50 ans un vecteur énergétique à peu près entièrement décarbonné qu’il va falloir privilégier autant que possible, les coûts étant bien entendu pris en considération. Toutefois, pour le résidentiel, peu de changements, la RT 2020 remplaçant simplement 2,58 par 2,3 alors qu’un coefficient de 1 aurait été plus cohérent avec la nouvelle stratégie. Conserver ce calcul en énergie primaire a surtout pour conséquence de freiner le développement de l’utilisation de l’électricité dans le résidentiel, alors que se renforce le besoin de climatisation et alors que se diffuse dans d’autres pays l’utilisation de la pompe à chaleur (PAC), en particulier dans le schéma associant PAC, plancher chauffant et rafraichissant à basse température (PCRBT) et géothermie à faible profondeur. Les débats sur le sujet du calcul « en énergie primaire » sont maintenant académiques ! Le bouleversement apparaît lorsque l’administration change radicalement le statut du DPE : à partir de janvier 2025, il devient interdit de mettre en location une habitation classée « passoire énergétique ». Qu’expliquera-t-on au propriétaire d’un appartement dont le bien est ainsi ostracisé parce qu’il utilise une électricité qu’il faut multiplier par 2,3 ? L’incitera-t-on à remplacer pour le chauffage l’électricité par le gaz ?
Cette incohérence sera-t-elle l’objet d’une campagne analogue à ce qui est lancé en juin 2025 contre les ZFE ou la PPE ? Personne n’a intérêt à une telle conséquence !
Pour ma part, je recommande une triple initiative :
- Remplacer le « coefficient » de 2,3 par la valeur de 1
- Supprimer l’interdiction de mise en location d’une habitation classée G par son DPE
- Faire lancer par l’ADEME et le BRGM un site d’information honnête sur l’intérêt du schéma PCRBT + PAC + géothermie à faible profondeur, avec présentation des cartes pertinentes.
Bref, il est important que la PPE ajoute la dimension « chaleur et refroidissement » à l’approche actuelle des questions énergétiques !
Ingénieur général des mines et ancien délégué aux risques majeurs
-
Philippe Vesseronhttps://lepontdesidees.fr/author/pvesseronauteur/
-
Philippe Vesseronhttps://lepontdesidees.fr/author/pvesseronauteur/
-
Philippe Vesseronhttps://lepontdesidees.fr/author/pvesseronauteur/
-
Philippe Vesseronhttps://lepontdesidees.fr/author/pvesseronauteur/

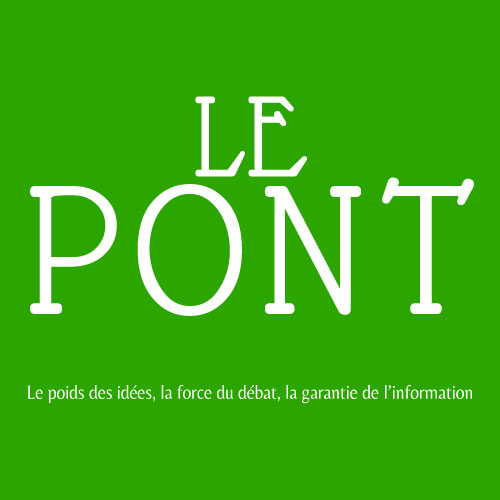






Responses