Faute de majorité, la Ve République confrontée à une épreuve sans précédent
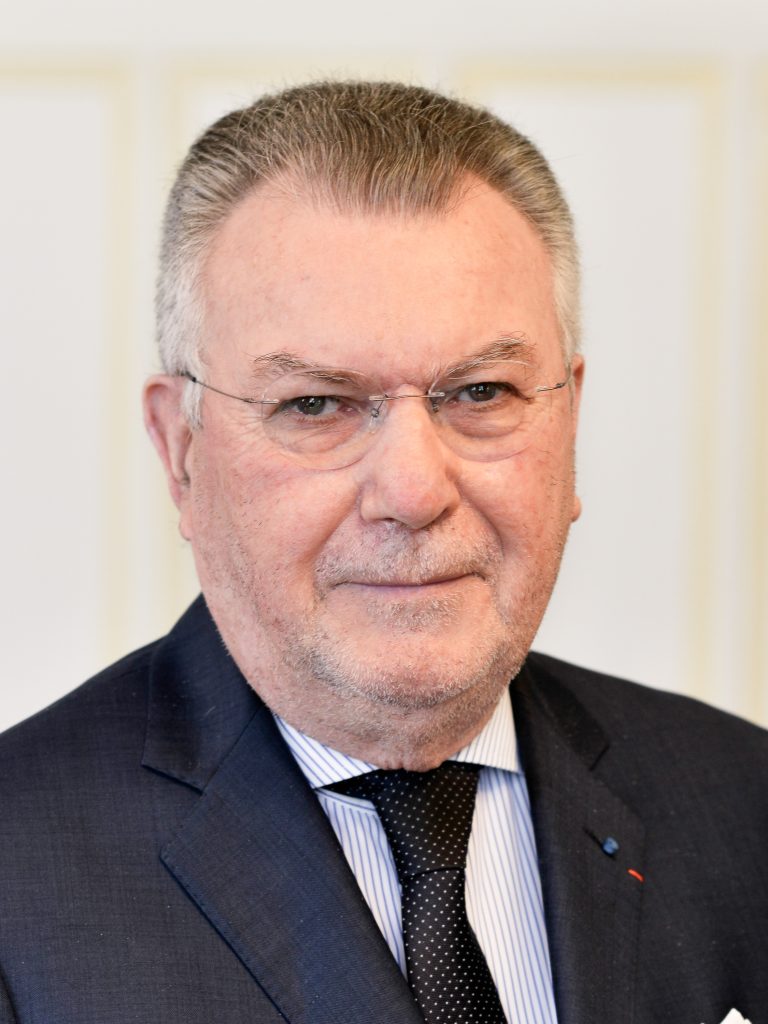
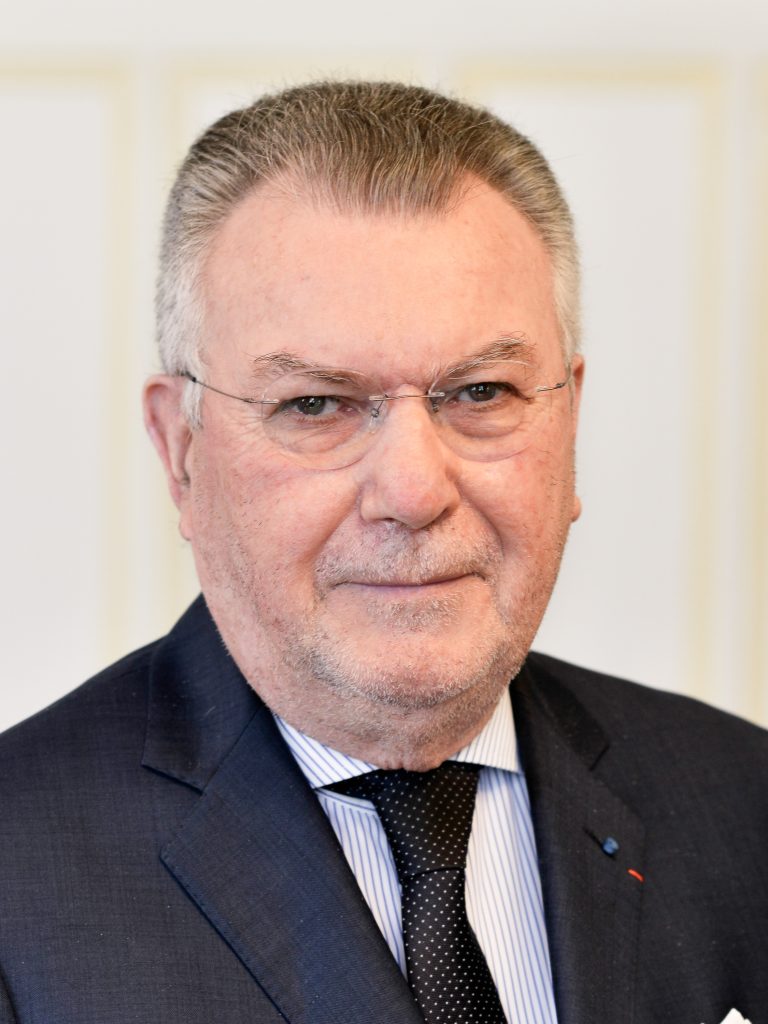
Caractérisée depuis 65 ans sans interruption par ce que l’on appelle le fait majoritaire, c’est-à-dire par l’existence d’une majorité parlementaire homogène, disciplinée et durable, que celle-ci soit absolue ou relative, ou qu’elle soit conforme à la majorité présidentielle ou opposée à elle dans le cas d’une cohabitation, la dissolution du 9 juin a débouché sur une Assemblée Nationale sans aucune majorité, et plus morcelée que jamais en dépit de l’existence apparente de trois blocs à peu près égaux mais dont nul ne sait s’ils resteront unis ou s’ils se diviseront.
La Ve République se trouve ainsi pour la première fois de son histoire confrontée à une épreuve totalement inédite, lourde d’incertitudes et de difficultés, d’autant plus que l’impossibilité de dissoudre l’Assemblée pendant un an ne peut être qu’un facteur aggravant pour le pouvoir exécutif, durablement affaibli face à un Parlement à l’abri de toute sanction.
Les institutions risquent donc d’être mises à mal par un retour aux poisons et délices du « régime d’assemblée » tel que l’ont pratiqué les IIIe et IVe Républiques, marquées par une instabilité ministérielle et une impuissance gouvernementale chroniques.
La Constitution permettra-t-elle d’éviter ce risque ? Telle est effectivement la question qu’il est légitime de se poser.
1/ Il convient tout d’abord de rappeler qu’en 1958, selon la volonté du général de Gaulle, la Constitution a été élaborée très précisément pour corriger les défauts des Républiques précédentes et de rééquilibrer les institutions au profit du pouvoir exécutif, et cela sans que quiconque à l’époque puisse imaginer qu’il existerait en permanence une majorité absolue à l’Assemblée Nationale.
C’est la raison pour laquelle ont été instaurées des procédures destinées à permettre à un Gouvernement de faire adopter les lois considérées par lui comme indispensables pour appliquer son programme sans pour autant disposer d’une majorité de députés (et de sénateurs) souhaitant les voter. Ces procédures relèvent de ce qu’il est convenu d’appeler le « parlementarisme rationalisé », dont le plus bel exemple est le fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet l’adoption d’un texte sans vote. Mais cet article n’est pas le seul dont un Gouvernement minoritaire peut se servir pour obtenir du Parlement qu’il adopte les textes législatifs auxquels il tient. Il peut ainsi utiliser, entre autres, les ordonnances prévues par l’article 38, le vote bloqué de l’article 44, l’ordre du jour prioritaire de l’article 48, ou la commission mixte paritaire de l’article 45 lui permettant de contourner l’obstacle du Sénat. Les articles 47 et 47-1 l’autorisent même, au cas où le budget de l’Etat ou le budget de la sécurité sociale ne serait pas adopté dans les délais prescrits, à les mettre en vigueur par ordonnances.
Ce ne sont donc pas les armes qui manquent au Gouvernement pour appliquer son programme, d’autant plus qu’il n’est pas obligé, il faut le rappeler, d’obtenir un vote de confiance de l’Assemblée pour entrer en fonction.
2/ Si la rationalisation du parlementarisme prévue par la Constitution est l’atout décisif qu’un Premier ministre pourra efficacement utiliser, il convient maintenant d’envisager ce que le Président de la République, pour sa part, pourra faire pour gérer cette nouvelle forme de cohabitation avec, cette fois-ci, non pas une majorité parlementaire homogène s’opposant à lui, mais une coalition aux contours incertains et à ce jour non identifiée.
Le premier constat qui s’impose en tout cas à la suite de la dissolution et du résultat des élections législatives des 30 juin et 7 juillet, c’est que l’hyper présidentialisme tel qu’il est pratiqué depuis 7 ans est mort, du moins pendant un an, faisant place au contraire à une sorte d’hyper parlementarisme. Le chef de l’Etat ne pourra plus imposer sa prédominance sur les autres institutions comme il l’a fait jusqu’ici, à commencer par le Premier ministre et le Gouvernement, réduits au rang de simples exécutants des volontés présidentielles.
Ce qui ne signifie pas pour autant que le Président sera privé de tout moyen d’action, bien au contraire. Il pourra ainsi exercer son rôle d’arbitre et de garant des intérêts vitaux du pays tels que le prévoit l’article 5 de la Constitution, conserver ses prérogatives en matière de diplomatie et de défense ainsi qu’une partie de son pouvoir de nomination, organiser un référendum et prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle (avec l’accord du Gouvernement), présider le Conseil des ministres, nommer le Premier ministre en gardant une certaine latitude au cas où aucune coalition ne serait capable de lui imposer son choix. Sans oublier bien sûr la possibilité de recourir aux pleins pouvoirs de l’article 16, au cas où « les institutions de la République serait menacées d’une manière grave et immédiate » et « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics serait interrompu », ce qui est une hypothèse qu’il est impossible de totalement exclure.
3/ C’est en appliquant « la Constitution, rien que la Constitution, mais toute la Constitution », pour reprendre la célèbre formule utilisée par François Mitterrand en 1986, au moment où s’ouvrit la première cohabitation, que la Ve République pourra surmonter la nouvelle crise qui l’affecte aujourd’hui. On peut en effet considérer que la Constitution de 1958 possède à la fois les qualités de robustesse et de souplesse qui lui ont permis d’affronter avec succès une série impressionnante de défis : la décolonisation, la guerre d’Algérie, la crise politique de 1962, la crise sociale de 1968, l’alternance, les trois cohabitations, le passage du septennat au quinquennat…
Ce n’est donc pas un hasard si la loi fondamentale a pu atteindre et dépasser les 65 ans d’existence et contrairement à ce qui peut être affirmé parfois de façon péremptoire, ce ne sont pas les institutions qui sont en cause, il faut le répéter inlassablement, mais ceux qui s’en servent. Refuser d’admettre cette évidence et ne pas être capable d’éviter de reproduire les erreurs ou les dérives du passé pourrait alors, malheureusement, conduire à une inévitable crise de régime.
Pour l’instant, Emmanuel Macron a décidé… de ne rien décider, profitant précisément de la possibilité que lui offre la Constitution, qui ne fixe pas de délais en l’espèce, de prendre tout son temps pour nommer un nouveau Premier ministre. Il a ainsi accepté le 16 juillet la démission du Gouvernement Attal, qui reste en place pour gérer les affaires courantes, et qui peut demeurer en fonction aussi longtemps qu’il le souhaitera, car un Gouvernement démissionnaire ne peut pas être renversé par une motion de censure. On pourrait même envisager qu’il le reste indéfiniment. Mais cette éventualité serait évidemment politiquement inacceptable, et pourrait provoquer de la part du Parlement une mise en cause du Président de la République lui-même, en vertu de l’article 68 de la Constitution, pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».
Professeur de droit public à l’IPAG de l’Université Panthéon Assas
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/
-
Olivier Passelecqhttps://lepontdesidees.fr/author/opasselecqauteur/






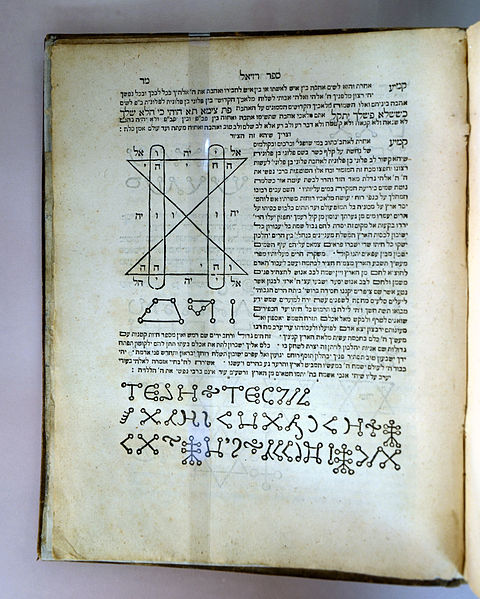

Responses