L’Ours russe et le Dragon chinois


Avec L’Ours et le Dragon, Russie-Chine : histoire d’une amitié sans limites (Tallandier 2025), Sylvie Bermann s’est engagée dans une histoire de longue durée, qui prend sa source au XIIIe siècle, éclairant par son analyse rigoureuse et empathique l’évolution des relations séculaires entre les deux empires. Sa connaissance de l’histoire contemporaine est enrichie par une belle carrière diplomatique, puisqu’elle fut ambassadeur de France à Pékin (2011), à Londres (2014) et à Moscou en 2017. En outre, elle a pu observer les rapports entre les grandes puissances à l’ONU pendant une dizaine d’années, lorsqu’elle était membre de la délégation française au Conseil de sécurité. L’ancienne diplomate est bien connue des téléspectateurs de LCI qui apprécient la modération et la rigueur de ses analyses.
Son essai montre que les relations entre la Russie et la Chine sont déterminées par les contraintes de leurs frontières communes, mais davantage encore par les aléas et décisions de la politique. À partir du XIXe siècle, avec l’essor des États-nations et du nationalisme, l’idéologie joue un rôle grandissant entre ces deux empires, surtout depuis la révolution bolchevique qui inspire la formation et les conquêtes du parti communiste chinois. Après l’avènement de la République populaire, Mao Zedong se soumet à l’hégémonie méprisante de Staline, voyant dans son régime le chemin à suivre pour le développement d’une Chine communiste, acceptant ainsi de maintenir en l’état nombre de concessions politiques et territoriales que le maître du Kremlin a obtenues en participant tardivement à la guerre contre le Japon. Et malgré tout, Mao reste stalinien. Pour cette raison, il n’accepte pas le XXe congrès, la dénonciation du culte de la personnalité et l’idée de coexistence pacifique avec les États-Unis qui en découle. Il s’engage dans le « grand bond en avant », une entreprise calamiteuse du point de vue économique qui engendre une famine monstrueuse causant vingt à trente millions de morts. Par la suite, les délires et le chaos de la révolution culturelle engagée dès 1969 péjorent encore les relations sino-soviétiques. La fin de la guerre froide et l’acceptation en Russie de l’économie de marché et, pour un temps, des valeurs libérales n’ébranlent en rien l’assise du régime communiste chinois, mais contribuent à un règlement des conflits frontaliers et à l’apaisement des rapports entre les deux États.
La période contemporaine des relations sino-soviétiques est plus difficile à déchiffrer, d’autant qu’elle implique, encore davantage que par le passé, la politique américaine, elle-même sans ligne directrice. Il reste à expliquer « l’amitié sans limite » dont se prévalent Poutine et Xi pour définir les liens politiques dont ils se réclament. Leurs interactions sont de plus en plus inégales, mais cette fois au profit de la Chine qui a connu une croissance économique exceptionnelle au cours des dernières décennies. Ce rapprochement reflète des assujettissements de circonstances marqués par la guerre du Kremlin contre l’Ukraine et par celle que prépare la Chine contre Taiwan, mais rien dans l’histoire de longue durée proposée par notre auteur ne permet de lui conférer une assise solide. Ces empires ont toutefois des régimes tyranniques semblables et se sentent menacés par tout ce qui est au principe des valeurs occidentales : la liberté, l’État de droit, l’esprit critique. Ainsi, le gouvernement chinois prétend défendre sur la scène internationale la souveraineté des États, leur intégrité territoriale et l’intangibilité de leurs frontières. Et pourtant, il apporte son soutien économique et militaire à la Russie dans ses guerres.
Pour assumer leurs fonctions, les diplomates observent la vie politique en restant sur la réserve, la négociation orientant de manière pragmatique le choix des solutions possibles. Sylvie Bermann assume ce réalisme. Elle est admirative de Kissinger, acceptant sa conception particulière du réalisme. Son analyse accorde peu d’importance aux idées et aspirations des sociétés chinoises ou russes, aux phénomènes de révolte et de dissidence qui peuvent occasionnellement s’y exprimer. Alexeï Navalnyi est mort et personne n’a plus l’idée de protester sur la place Tian’anmen. La guerre en Ukraine est pour notre auteur « un révélateur de la perte d’influence de l’Occident et du basculement du monde ». On est entré dans un monde multipolaire, avec la montée en influence, sinon en puissance, du « Sud global ». Il est vrai que l’universalisme des principes de la Charte des Nations unies a perdu toute signification pour la majorité des dirigeants de ce monde et on peine à imaginer ce qui pourrait surgir de la fin de la désintégration des idéaux de légitimité politique que cette organisation s’emploie encore à défendre, au moins avec le soutien de l’Union européenne. Les relations « amicales » entre la Russie, la Chine et les BRICS semblent reposer avant tout sur des similitudes de régimes intérieurs et des intérêts conjoncturels. Cet état de fait ne reflète pas pour autant une nouvelle expression de la « fin de l’histoire », car ces configurations improbables de la société internationale restent aléatoires et mouvantes.
professeur honoraire des relations internationales à l'Université de Lausanne, il est l'auteur de "Des foules et du populisme" aux éditions Campagne Première
-
Pierre de Senarclenshttps://lepontdesidees.fr/author/deqfrss/

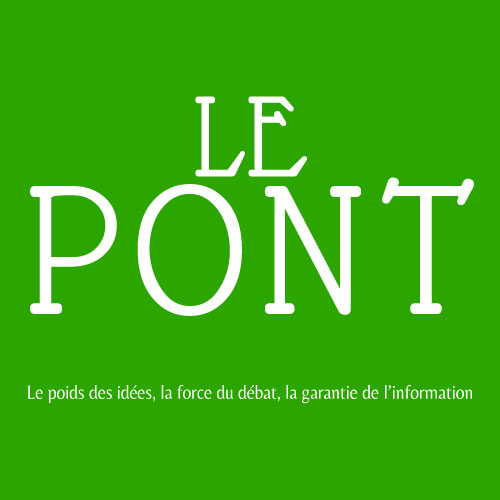


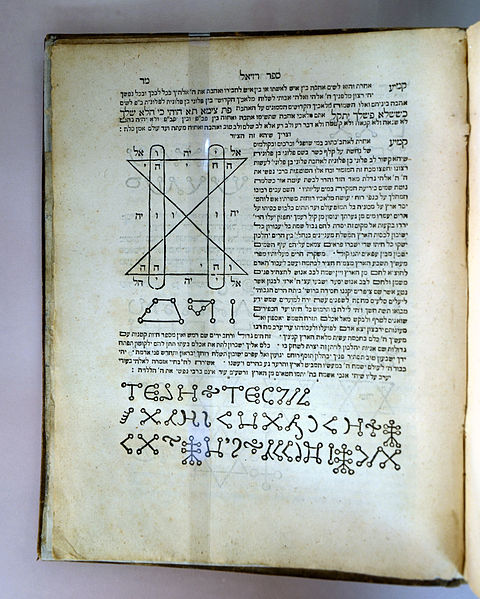


Responses