Le point de vue du vivant



Didier Sicard
Il n’y a pas de plus grand paradoxe, que l’écart du regard porté sur la mort entre nous humains, refoulant sans cesse ce moment de la mort à venir en craignant de l’aborder en situation de souffrance et nous humains confrontés à son imminence. Ce paradoxe est à la source d’une demande de fin de vie auto réalisé au moment même de ce refoulement comme une façon de l’escamoter, « je ne la subirai pas mais je l’anticiperai. C’est ma liberté. Je suis autonome. Je ne dépends de personne. Je veux bien mourir mais sans souffrance ».
Ce discours est d’ailleurs très séduisant pour la plupart de ceux qui y adhèrent, gardant un très mauvais souvenir d’une ou de plusieurs morts cruelles dans leur entourage.
La mort, en effet a changé depuis un demi-siècle. Elle n’est plus un moment de rassemblement autour du lit, ce rite collectif peut-être le plus important de la vie. Elle est habituellement médicalisée et déléguée à une équipe de soignants, souvent dans une grande solitude ou parfois avec un accompagnement de l’entourage, limité par un horaire hospitalier indifférent au sens de ce moment ultime.
Le deuxième paradoxe est que la confiscation de la mort par la médecine, se double de l’abandon qu’elle a pour elle justement à ce moment. Les études universitaires médicales n’offrent aucun temps de réflexion sur ce sujet. La mort est un « échec » pour une médecine de plus en plus fascinée par elle-même, ses progrès, ses réussites. Mais les hôpitaux sont généralement inadaptés à cette situation (les brancards aux urgences pour accueillir les mourants !) Le nombre de soignants médecins et infirmières ne cesse de baisser. Ce paradoxe d’une médecine, qui a capturé la mort mais ne sait qu’en faire, est à la source d’une angoisse légitime pour nous les vivants qui ont le sentiment d’abdiquer leur liberté à ce moment, et revendiquent de pouvoir mettre fin à leur vie en cas de souffrance insupportable (près de 95% des citoyens). On peut se demander ce que pensent les 5 % restants !
Cette revendication oublie simplement l’essentiel. Au moment l’affronter la mort, notre adieu au monde, en effet, nous vivants, sommes en état d’hétéronomie absolue. Jamais notre existence n’aura été aussi fragile. L’autonomie d’une liberté revendiquée s’efface, oublieuse de sa revendication au profit d’une demande d’aide comme jamais nous ne l’avons eu Une aide à mourir, parfois, pour 2 % des citoyens mais aussi une demande de retarder la mort « Je veux bien mourir, mais ne veux pas qu’on me tue, » me disait un malade en fin de vie.
Ces deux paradoxes, changement de notre regard sur la mort selon le moment, médecine toute puissante, mais peu intéressée par la mort, nourrissent les débats politiques sur la fin de vie, monopolisés par cette illusion d’autonomie, de « consentement libre et éclairé » plutôt que d’interrogations sur la perception du sens de sa vie, du sentiment d’inutilité sociale, d’abandon, de réaction émotionnelle à un évènement ,etc., de discernement qui finit par faire de notre mort, un projet comme un autre. Nous faisons tous des projets mais une loi ne peut jamais faire d’un projet une réalité contrainte. La mort n’est pas un instant que l’on peut détacher de la vie. Elle en est la conclusion et elle nous fait découvrir des espaces de paroles parfois inconnues de nous-mêmes que nous n’avons jamais dites. Les projets de la loi actuelle, même si elle est reportée, sine die, n’en tiennent pas compte en détachant la mort de la vie, en l’inscrivant comme le comble de l’autonomie, comme s’il s’agissait d’une réglementation d’exercice ou d’accès à un droit au logement !
Certes, les articles concernant les soins palliatifs répondent à cette situation très particulière qui est à ce moment le besoin de l’écoute de la personne, une écoute qui accueille le brouillard de la pensée, voire le désir réel d’en finir. Mais le décalage entre le projet et la réalité est considérable. Que signifie un droit opposable à les soins palliatifs en l’absence d’accueil disponible ?
La création de maisons d’accompagnement est une excellente attention, mais son nombre sera bien loin de répondre à la demande.
Une loi devrait donc avant tout considérer que notre fin de vie est un moment crucial de nécessité de solidarité, et non l’expression d’un simple individualisme inconscient de ses conséquences pour les autres. Proposer ainsi « une aide à mourir, » euphémisme pour euthanasie ou suicide assisté qui répondrait aux vœux de 95 % des citoyens oublie le fait qu’elle repose sur le vœu de citoyens loin de leur mort, faisant l’impasse sur l’évaluation de ses conséquences sur les publics, dits vulnérables, fragilisés, blessés, stigmatisés, personnes vieillissantes, en situation de handicap, ou de précarité sociale évoluant dans des contextes de situation personnelle bien souvent dégradée, en fonction d’un environnement, plus ou moins délétère , mais aussi le surgissement d’une culture nouvelle qui fait fait de la mort programmée le refus du vieillissement de l’affaiblissement de nos facultés, comme si un humain n’avait de sens que dans la plénitude de ses moyens. Le concept persistant de dignité finit par imposer sa marque et être intégré dans l’imaginaire collectif, comme une norme souhaitable. Encore une fois c’est le regard qui crée l’indignité et à ce moment de la fin de vie, la dignité est un sentiment à peu près toujours absent.
« À quoi bon vivre ? » A cette question qui est un appel à l’aide, la loi répond « je vous comprends, il vaut mieux mourir et nous pourrons vous y aider ». Une loi qui, qu’on le veuille ou non, ouvre de nouvelles perspectives qui vont de la résignation des plus vulnérables des plus fragiles, à l’encouragement des plus nantis à ne pas accepter une finitude naturelle. C’est d’ailleurs cette dernière dimension qui est la plus active la plus militante, qui fait de la fraternité, un encouragement à la mort, qui refuse la solidarité et ignore qu’il n’y a pas un » je »sans « tu » , avec ce décalage entre la demande et l’inconscience du risque pour les autres « Mon corps m’appartient, mon ultime liberté « etc. de la DMD sont des slogans emblématiques de cette militance sociologiquement, très précise, aux revendications libertaires, militance des combats pour l’avortement calqués sur la fin de vie, alors que justement une loi permettant l’avortement a pour finalité de protéger la vie des mères.
Plus concrètement, les projets qui ont été présentés intègrent d’inscrire un « délit d’entrave »(comme pour la lutte contre l’avortement) destiné aux soignants qui refuseraient une demande d’assistance au suicide ou d’euthanasie tous en n’inscrivant pas le délit d’incitation, le refus de la transgression condamné, « faites votre devoir », le serment d’Hippocrate conduit aux tribunaux, permettre à toute personne choisie par les malades de procéder à la mise à mort, méconnait les conséquences incalculables à payer à long terme d’un tel geste pour celle-ci, les conflits familiaux etc… Décider d’une temporalité légale de mise à mort, sans prendre en compte les facteurs sociaux, psychologique ou médicaux qui peuvent déterminer cette demande, est d’une ignorance tragique de la réalité.
Une telle loi refuse d’anticiper les conséquences autre que celles prévues, comme un aveuglement volontaire. C’est une loi pour les vivants en bonne santé et non pas pour les personnes en fin de vie qui pourraient trouver un encouragement à mourir avant l’heure, tant les structures de soins antidouleur, soins palliatifs sont si difficiles d’accès et le resteront longtemps.
Certes, la possibilité de demander la mort conduit naturellement à l’intégrer dans l’imaginaire pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur réside dans les garanties futures que mon vœu sera exaucé, et que celle-ci sera alors la source d’une sérénité inconnue. Pour le pire, en introduisant ce droit comme un encouragement, qui peut venir court-circuiter les assistances qui se voient rejetées avant même leur existence ou leur mise en œuvre. L’expérience montre comment le stress terrible après l’accident, l’annonce d’une maladie neurologique grave peut conduire ou souhaite mourir de façon quasi absolue et que six mois après, étrangement, le désir de vivre ressurgit en chacun d’entre nous.
Mais peut-être, avant tout une loi doit anticiper les demandes d’élargissement permanent des indications à demander la mort comme nous, l’enseignent les lois du Benelux et du Canada, qui se modifient sans cesse en fonction des demandes jugées de plus en plus légitimes.
Professeur de médecine, ancien Président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE)
-
Didier Sicardhttps://lepontdesidees.fr/author/dsicardauteur/
-
Didier Sicardhttps://lepontdesidees.fr/author/dsicardauteur/
-
Didier Sicardhttps://lepontdesidees.fr/author/dsicardauteur/
-
Didier Sicardhttps://lepontdesidees.fr/author/dsicardauteur/





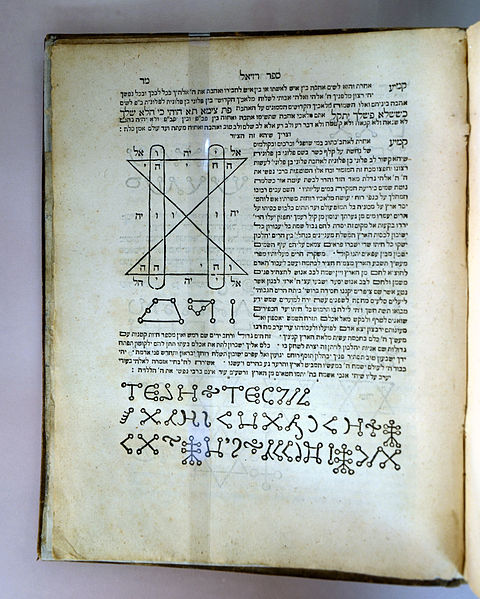


Responses