Nouvelle organisation de la filière nucléaire : faire de la responsabilité un principe fondateur


La maîtrise de l’immense potentiel de l’énergie nucléaire constitue l’aboutissement d’un long processus de transfert de connaissances de la sphère scientifique vers le secteur industriel, susceptible d’être analysé comme un exemple emblématique de politiques publiques réussies. Fondée sur des découvertes scientifiques majeures réalisées au cours de la première moitié du XXᵉ siècle, son industrialisation prit son essor avec le dépôt de trois brevets en 1939 par l’équipe de Joliot-Curie, issue de la recherche publique. Ce développement fut ensuite soutenu de manière constante par la puissance publique, avant d’être partiellement compromis sous l’effet de contraintes européennes, appuyées par des gouvernements dépourvus de vision stratégique.
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la recherche scientifique en France est reconnue comme excellente, mais l’appareil industriel ne suit pas. Pour remédier à ce déséquilibre, une organisation étatico-industrielle est mise en place, accompagnée d’un effort de formation visant à diffuser les compétences scientifiques vers le monde des ingénieurs. Cette démarche repose sur une conviction forte : tirer parti des progrès de la science pour moderniser l’industrie française. Le résultat permis à la France de développer un système électrique parmi les plus performants du monde, un modèle intégré, alliant vision industrielle, maîtrise publique, service de l’intérêt général et garantissant une électricité abondante, décarbonée et bon marché.
Dans ce contexte, le rôle de l’État s’est affirmé alors avec clarté : s’inscrire dans une vision de long terme. L’État devint ainsi un acteur central de l’investissement, du débat démocratique, de l’information et de la formation des citoyens, tout en assurant la mise en place des normes et des contrôles nécessaires. L’ensemble des ministères impliqués réunissait des personnels hautement qualifiés, bénéficiant d’une formation scientifique rigoureuse, dont les missions, clairement définies et étroitement coordonnées, reflétaient une compréhension fine des enjeux stratégiques liés à la maîtrise de l’énergie nucléaire, ainsi qu’une capacité affirmée à inscrire leur action dans une approche systémique.
Puis une nouvelle époque a vu le jour, où l’individualisme devint la norme et le principe de précaution tellement central, que l’industrie en fut ralentie au point de négliger son avenir. Sous l’impulsion de directives européennes et de partis politiques sans vergogne, le débat public se focalisa sur les risques engendrés par les activités humaines considérés comme inadmissibles. La traque du risque zéro et l’éradication de toute incertitude se sont érigées en cause militante, jetant l’opprobre sur le progrès scientifique. Les démocraties firent de la protection des populations un leitmotiv, en multipliant les structures de prospective, de prévention, de contrôle et de sécurité.
Pourtant, la mission de la recherche scientifique est d’œuvrer à améliorer la protection et la qualité de la vie, avec des résultats qui témoignent d’avancées concrètes : progrès médicaux, recul de la mortalité, meilleure maîtrise de l’environnement, amélioration de la sécurité alimentaire. Parallèlement, progresser dans notre compréhension du monde rend visible de nouveaux risques — présents, latents ou futurs. Le savoir n’élimine ni l’incertitude ni les menaces possibles. Il oblige au doute, attitude essentielle des scientifiques[1].
En outre, l’omniprésence croissante des technologies dans la vie quotidienne a nourri une méfiance généralisée dans l’opinion publique, brouillant la frontière pourtant essentielle entre la solidité des faits scientifiques et la volatilité des opinions personnelles.
L’exemple de l’énergie nucléaire est emblématique. Une industrie fut développée sur une vision stratégique et long terme d’une puissance publique, consciente de son rôle de protection et développement du bien-être de sa population, tel un État souverain. Des évènements catastrophiques et des pollutions soi-disant ingérables sont venus entacher la confiance de la population. Associations et partis politiques se réclamant de l’écologie se sont constitués en grande partie autour d’une opposition à l’énergie nucléaire semant le doute et la peur dans la population. Garde-fous, création de multiples agences de contrôle et de prévention du risque, réglementation à outrances, exigences au-delà de la rationalité ont eu raison d’une filière industrielle, qui permettait pourtant le rayonnement de la France sur la scène internationale et qui proposait en sus, des emplois hautement qualifiés et non délocalisables. D’ailleurs, encore actuellement, sur le site du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche est écrit en préambule de la description « des acteurs institutionnels français du nucléaire » [2] : « L’exploitation de l’énergie nucléaire ne peut se faire que dans un cadre juridique spécifique, en raison d’une part des risques ou inconvénients que peuvent présenter les installations nucléaires ».
Aujourd’hui, face à la crise de confiance qui fragilise les responsables politiques — pourtant chargés de planifier le renouveau de l’industrie nucléaire — et une filière dans son ensemble, qu’est-il possible de faire ? Qui possède aujourd’hui la légitimité, la vision et les compétences pour garantir la maîtrise de l’énergie nucléaire sur le long terme ? Devons-nous miser sur le service public, le secteur privé, ou une alliance des deux ? À quelle échelle pertinente agir : celle de notre pays ou celle de l’Europe ? Ces questions, essentielles pour notre souveraineté énergétique et notre avenir, doivent être posées clairement. Il s’agit de déterminer avec discernement la juste frontière entre les décisions relevant de la responsabilité publique et celles pouvant être confiées à l’initiative du secteur privé.
Surtout que la véritable crise est également ailleurs : une véritable crise des compétences scientifiques et industrielles : les pays occidentaux ont vu s’éroder leurs capacités à construire et à exploiter dans la durée, des objets techniques complexes. Dans ces conditions une question devient légitime : quelle serait l’acceptabilité de l’énergie nucléaire auprès de la population, si dans un futur proche, nous ne parvenons pas à construire bien et rapidement nos prochains réacteurs et à les maintenir en bonnes conditions, à tel point que le prix de l’électricité augmenterait de manière importante et que les incidents d’exploitation se multiplient ? Et au-delà de ces considérations, quel modèle de société et de secteur économique, voulons-nous pour nos enfants ? Quand aujourd’hui des centaines de milliers de jeunes ne trouvent pas d’emplois avec des diplômes de Master dans le domaine des services[3] et que 17,2% des moins de 25 ans sont au chômage en France (contre 6,8% en Allemagne)[4], un objectif réaliste de réindustrialisation semble nécessaire. Pour l’atteindre, outre l’éducation qui doit être sérieusement réformée, les infrastructures de production d’énergie doivent être dimensionnées aux besoins réels du pays aujourd’hui et demain, en garantissant un accès équitable à l’ensemble des acteurs, sur tout le territoire, à un coût maîtrisé et soutenable.
C’est d’ailleurs, déjà en 2015, l’objectif de développement durable (ODD) n°7[5], adopté par la communauté internationale, traitant d’un accès universel à une énergie propre. Or actuellement dans le monde, 685 millions de personnes vivent sans électricité et 2,1 milliards de personnes sont privées d’un accès à des modes de cuisson non polluants[6]. En outre, le dernier rapport publié en juin 2024, par des Agences internationales dont l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montre que l’accès à l’énergie régresse pour la première fois en dix ans[7]. Aujourd’hui même en France, ce principe est mis à mal, affaiblissant les fondements même de notre souveraineté énergétique et de notre cohésion sociale.
A défaut de trouver des solutions toutes faites, certaines exigences peuvent nous aider à bâtir un début d’organisation, en redonnant tout son sens à la souveraineté : celle d’un peuple maître de ses choix, capable de se projeter collectivement dans l’avenir et de reprendre en main les leviers de son développement économique et social, dans une vision à long terme. L’objectif est bien de réduire nos dépendances sinon de les maitriser ou au moins de garder la liberté de les choisir.
Pour relever ce défi, l’État doit pouvoir s’appuyer sur des compétences élargies autour de l’enjeu du futur de l’énergie nucléaire, articulées autour de trois piliers fondamentaux :
- Une prospective de long terme, exécutée par des experts dont la responsabilité est de présenter avec rigueur et transparence les conditions réelles d’industrialisation des technologies, sans en minimiser les défis ni en exagérer la faisabilité,
- Un principe de subsidiarité pleinement déployé, permettant aux décisions d’être prises au plus près du terrain et des compétences,
- Une formation scientifique et technique au cœur des priorités éducatives.
Cela implique la mise en place des instances de pilotage robustes, capables d’assurer une cohérence interministérielle tout en associant les parties prenantes (élus, industriels, enseignants et chercheurs, monde associatif). Elles auraient pour mission de cartographier les interdépendances, de proposer des réponses coordonnées sous la forme de plans sectoriels sur au moins dix ans et des moyens de financement adaptés, afin d’assurer la résilience des filières industrielles adossées aux applications de l’énergie nucléaire. En parallèle, il est essentiel d’investir massivement dans la recherche.
La souveraineté ne saurait se concevoir sans une organisation publique adaptée, au service d’un projet collectif et démocratique : la reconquête industrielle visant à retrouver une santé économique et notre influence dans le monde. La filière nucléaire en est la base. Si nous ne faisons pas cet effort, son centre de gravité qui s’est largement déplacé en Asie[8] y restera irrémédiablement.
L’énergie nucléaire est bien plus qu’une simple énergie bas-carbone, elle est la base essentielle d’un bien commun qui est l’accès à l’énergie, mais elle n’est pas forcement soutenue par un service public, tel que nous l’avons connu par le passé. A nous de réinventer une organisation efficace et résiliente, où la responsabilité de chaque acteur sera l’enjeu central. Car finalement, c’est bien la responsabilité, en nous inscrivant dans un projet plus grand que notre existence qui nous mène à des choix et des actions éclairés et rationnels. Elle nous positionne à la croisée des choix passés, de l’action présente et de la promesse future.
[1] https://www.polytechnique-insights.com/dossiers/societe/que-signifie-avoir-confiance-en-la-science/comment-trier-le-bon-du-mauvais-doute/
[2] https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/acteurs-gouvernance-du-nucleaire
[3] https://www.lefigaro.fr/vox/societe/qu-est-ce-qui-cloche-dans-mon-cv-quand-la-surproduction-d-elites-mene-au-declassement-des-bac-5-20250414
[4] https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-euro-indicators/w/3-02102024-ap#estat-inpage-nav-heading-0
[5] https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
[6] https://iea.blob.core.windows.net/assets/cdd62b11-664f-4a85-9eb6-7f577d317311/SDG7-Report2024-0611-V9-highresforweb.pdf
[7] https://trackingsdg7.esmap.org
[8] https://www.transitionsenergies.com/avenir-energie-nucleaire-en-asie/
Docteure en physique nucléaire, maitresse de conférences au Cnam en sciences et technologies
-
Emmanuelle Galichethttps://lepontdesidees.fr/author/egalichet/
-
Emmanuelle Galichethttps://lepontdesidees.fr/author/egalichet/
-
Emmanuelle Galichethttps://lepontdesidees.fr/author/egalichet/

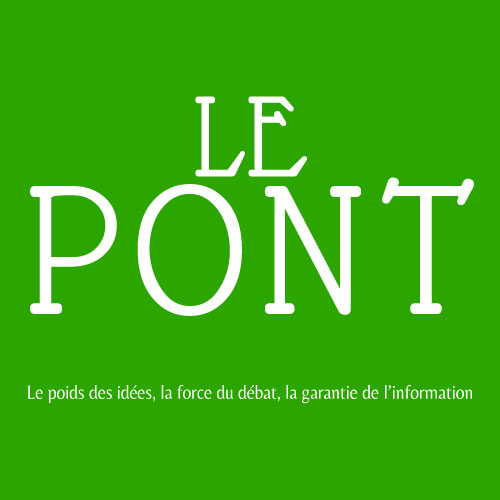






Responses