Palestine, choses vues


Un reportage des archives de la Revue Passages (N° 189, novembre 2016)
Sonya Ciesnik
Qalandia check point… C’est juste une part de la routine, vous vous le dites à vous-même avec appréhension. Le bruit métallique des portes rappelle la prison, et la pensée de la prison provoque immédiatement une soif extrême, un désir de boire, plus fort que toute sorte de peur ou d’indignation… Et maintenant il y a le regard narquois de la soldate de Tsahal aperçu de derrière la fenêtre insonorisée de son poste, contrôlant toute possibilité de communication. La queue des Palestiniens au check point fait pression instinctivement pour franchir le barrage, une masse collective de corps dans laquelle l’on pourrait se perdre. Ici, dans les territoires, un peuple sous occupation est en train d’être divisé, avec un sentiment d’effacement, sans que personne ne puisse entendre son cri de protestation : le microphone a été éteint.
Le printemps arabe a été comme une flamme allumée en 2011 en Tunisie et qui s’est propagée à travers le monde arabe, perturbant les ordres sociaux et politiques, et délogeant des régimes tyranniques qui semblaient destinés à durer éternellement. Le feu a pris au Maroc, en Algérie, au Yémen, à Bahreïn et à Oman sous forme de manifestations. Des régimes sont tombés en Libye et en Égypte. Alors qu’ailleurs des populations entières descendaient dans la rue, pourquoi n’y a-t-il pas eu de soulèvement important en Palestine ? Alors que diverses manifestations étaient organisées à Ramallah, le problème essentiel étant de savoir s’il fallait privilégier la main ou le gant. Les Palestiniens devaient-ils s’attaquer à leur politique intérieure gangrenée ou à l’occupation israélienne ? Ce que les Israéliens ont vécu comme une période de calme relatif, les Palestiniens l’ont vécu comme une asphyxie lente et constante : plus de colonies, plus d’expulsions, plus d’assignations à résidence, et plus de terres perdues en raison du mur qui sépare leur territoire de celui d’Israël.
En septembre 2016, en compagnie de Gerard Sebag, journaliste de France Télévisions, j’ai été guidée autour de Ramallah par Kaied, un journaliste local d’une vingtaine d’années. Kaied, qui vit à Naplouse mais travaille à Ramallah, possède une façon particulière et détachée de décrire les monuments et les bâtiments. C’était comme si nous les regardions à travers un voile qui nous empêchait de voir leur plein potentiel. Alors qu’il avait des amis qui avaient vécu en Arabie Saoudite et au Koweït pour de meilleures possibilités d’emploi, Kaied avait choisi de rester en Cisjordanie et de travailler dans le domaine des droits des citoyens et du développement social. À cette fin, il nous a proposé de rencontrer les dirigeants locaux du mouvement Fatah, des comités de femmes palestiniennes ainsi qu’un expert travaillant avec le président palestinien Mahmoud Abbas.
Alors que nous attendions Kaied au milieu de la poussière tourbillonnante et du trafic, juste après le check point de Qalandia, devant le mur séparant les territoires palestiniens d’Israël, nous avions sous les yeux toute l’histoire tragique racontée par des peintures murales : des soldats israéliens fantomatiques et sans visage tirant sur des femmes et des enfants, et quelques mètres plus bas, un feddayin qui riposte, embusqué derrière des rochers. À Tel-Aviv, sur un panneau publicitaire, le message était très différent : des soldats de Tsahal vantaient une série télévisée dans laquelle des jeunes hommes et femmes, vêtus d’uniformes, aux sourires rayonnants, se posaient en défenseurs de la nation. Le passage d’un territoire à l’autre formait un décalage comme dans une maison-miroir.
Difficile de rester objectif dans ce contexte. Rester objectif serait l’équivalent de rester indifférent. Ainsi de Jean Genet défendant la Révolution palestinienne dans les années 1970 avec son livre Le Captif Amoureux, et lucide sur le fait que les dirigeants palestiniens comptaient en tirer profit, je me suis mise à douter que je servais à mon tour à une « opération de propagande ».
La cause palestinienne étant éclipsée par la guerre en Syrie et la menace de l’État islamique, une Américaine discutant avec différentes associations palestiniennes prouverait qu’un citoyen des Etats-Unis, et par extension les Etats-Unis eux-mêmes, s’intéressaient à la Palestine. Quand Gérard Sebag et moi sommes arrivés, nous avons été accueillis par une telle effusion d’hospitalité, que nous sommes passer d’une réunion à une autre agrémentée par du thé chaud et des pâtisseries et discutant de la souffrance des Palestiniens sous l’occupation israélienne. Mais les gens étaient charmants, intelligents et intéressants, alors pourquoi ne pas se prêter à cet exercice de propagande ?
Alors que nous étions assis dans un bureau spacieux qui dominait les collines brumeuses de Ramallah, le président de l’Association des ingénieurs palestiniens, Majdi Al-Saleh, a décrit les années après-Oslo. Pour les Palestiniens, cet ensemble d’accords prouvait à quel point il serait difficile d’avancer vers la paix. En divisant la Cisjordanie en trois divisions administratives, les zones A, B et C, les accords d’Oslo ont été largement considérés comme une farce permettant aux Israéliens de poursuivre leur expansion territoriale. Al-Saleh fait remarquer que «le nombre de colons israéliens vivant en Cisjordanie a triplé depuis la signature du premier accord en 1993» et que «les Palestiniens vivant dans les zones A et B sont confinés dans des Bantoustans » précisant que ces enclaves étaient une « règle dans ce qui était devenu une mer de colonies».
Quant à la zone C, qui comptait plus de 60 pour cent de la Cisjordanie, Al-Saleh a noté qu’aucun développement ne pourrait se produire sans la permission d’Israël. Une route ne pouvait être pavée, un puits ne pouvait être creusé, et un tuyau ne pouvait pas être posé sans un permis délivré par l’administration civile – l’organe directeur d’Israël en Cisjordanie. De tels permis sont rarement accordés et les structures qui sont construites sans eux sont susceptibles d’être démolies par l’armée israélienne. (1)
Al-Saleh a expliqué plus profondément le lien entre le développement, la construction et la décision indépendante. Après la deuxième Intifada, son association avait supervisé une grande partie de la reconstruction en Cisjordanie. Cependant, son travail a bien pu être mené en vain parce que « des ingérences étrangères travaillaient à créer des divisions parmi les Palestiniens ». Il a souligné la surprenante victoire du parti des Frères musulmans en Jordanie, qui ont remporté des sièges au parlement jordanien. Cette victoire électorale, ainsi que le basculement en Turquie de la laïcité à la gouvernance religieuse, a signifié que l’influence islamiste dans la région était de plus en plus importante. Al-Saleh a estimé que ces groupes politiques sont « frères » avec le Hamas, et que ce dernier s’attendait à recevoir leur soutien. « Ce devrait être une priorité de concilier les différences entre les deux (Fatah, le gouvernement laïque en place en Cisjordanie, et le Hamas, le gouvernement islamiste à Gaza). »
Israël, avec toutes ses innovations, dans les domaines de la biotechnologie, de l’agriculture, de la médecine, de l’irrigation, avec sa réputation d’être la Silicon Valley du Moyen-Orient, était comme le soleil qui dominait la Cisjordanie. Le développement d’Israël crée un ressentiment des Palestiniens, leur lutte pour récupérer des territoires « volés » devenait une lutte pour la survie. Pour cette raison, le leader palestinien Yasser Arafat est une figure légendaire à la mode parmi la jeunesse palestinienne d’aujourd’hui: « Il a changé la légitimité révolutionnaire en légitimité internationale », m’a dit un ami de Kaied, ajoutant : « Si quelqu’un est debout sur votre tête avec une botte, bien sûr, vous ferez tout ce que vous pouvez pour le sortir de votre tête. Notre mouvement est restreint et nous nous sentons asphyxiés- il suffit d’aller voir dans cette direction » dit-il en pointant la colline derrière nous. « Et vous arriverez à un point de contrôle. Je les déteste, je veux qu’ils dégagent».
Bien que la plupart des Palestiniens aient aimé l’idée de la résistance comme moyen de changer l’ordre naturel et d’atteindre la justice, le gouvernement élu en Israël était trop puissant, trop sûr de lui-même et avait peu à perdre tout en continuant son expansion coloniale. Les Palestiniens ont le sentiment que toutes les taxes et autres impôts versés au gouvernement israélien servait in fine à financer leur propre répression.
La première Intifada a commencé en vue de briser la relation que les Palestiniens entretenaient avec leurs occupants. Le mot intifada signifie littéralement secouer. L’idée était que les Palestiniens devaient mettre fin au système de contrôle, en refusant de continuer à travailler en Israël, de ne plus manger et porter des vêtements achetés en Israël et de payer des impôts à Israël. Pour Abed Al-Menim Wahdan, commissaire adjoint pour la jeunesse du Fatah, qui a vécu cette première Intifada, ce fut une expérience de solidarité radicale. Il nous a expliqué comment, avant cette première Intifada, le Fatah et trois principaux partis politiques palestiniens de gauche avaient tranquillement construit des réseaux locaux d’organisations de jeunesse, de comités de femmes et de syndicats. Par conséquent, lorsque le boycott toucha les produits alimentaires israéliens, les comités agricoles palestiniens ont pu le suppléer ; lorsque les Israéliens ont fermé les écoles, des comités éducatifs étaient prêts à enseigner aux enfants.
Comparée à la première Intifada, au caractère révolutionnaire, qui avait connu un succès relatif, la deuxième Intifada fut désastreuse. La résistance militaire a entraîné la mort de milliers de Palestiniens, la construction du mur et l’installation d’autres postes de contrôle. La deuxième Intifada s’est soldée par un échec : des terres perdues, des militants emprisonnés, et comme l’a dit un ami palestinien, le mot « palestinien » devenu synonyme du mot « terroriste ». En 2016, les cicatrices étaient encore fraîches et une série d’attaques au couteau a renforcé la perception internationale qu’Israël menait une lutte nécessaire contre des terroristes.
Shawan Jabarin, le directeur de l’ONG des droits de l’homme Al-Haq était connu comme un champion des droits de l’homme, mais la Cour suprême israélienne le considérait comme un terroriste en raison de ses « prétendues » relations avec le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP). Il avait de l’autorité et de l’influence au sein de la société civile palestinienne, pour pouvoir expliquer les ressorts des récentes attaques terroristes.
« Ils ont le droit de résister », dit-il. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de mon sentiment d’être légèrement déstabilisée, d’être dans un rêve. Après avoir trouvé un chauffeur de taxi arabe (les Israéliens juifs ne peuvent pas se rendre en territoire palestinien), après avoir franchi le point de contrôle et roulé lentement au milieu du trafic, nous avons trouvé le bureau de Jabarin sur Rokab Street, l’une des artères centrales de Ramallah.
L’entretien s’est déroulé sur fond de panique : chaque seconde précieuse avec le directeur passait trop vite. Le chauffeur de taxi s’impatientait, pressé de retourner à Jérusalem-Est. Vu la tension et le risque de nouvelles attaques de la part des Palestiniens contre les forces de sécurité Israéliennes, on pouvait s’attendre à passer des heures au poste de contrôle de Qalandia où les gens et les véhicules passaient au compte-gouttes.
« C’est une question difficile, et je sais que vous n’êtes pas responsable, mais avec le pic de violence, pourriez-vous me dire ce qui pousse les jeunes Palestiniens à piéger les forces de sécurité et les citoyens israéliens ? », ai-je demandé. Sa réponse comprenait la version officielle donnée par les autorités palestiniennes et son avis personnel de la situation. Il a expliqué qu’il existe plusieurs conditions qui créent ces vagues de violence, mais que la colère est la principale raison. Avec l’idée d’une « réaction collective » selon laquelle ces actes commis par des individus constitueraient une vengeance de la part de toute la société palestinienne pour avoir subi une inégalité de traitement dans le domaine légal, l’humiliation aux postes de contrôle et les souffrances économiques liés aux impôts élevés payés à l’Etat Israélien.
« Alors tu vois », dit-il, lentement et pensif, en ramassant le couteau placé dans le bol de fruits devant nous et l’agitant ensuite dans l’air, « la frustration s’accumule jusqu’à ce que nous ne puissions plus la supporter et les gens alors craquent… » Il a ajouté qu’il était même préoccupé par sa propre fille, parce qu’elle lui avait dit avoir été arrêtée par des soldats israéliens au check point. N’importe quel manque de respect, comme mâcher un chewing-gum, pouvait vous valoir des heures de détention.
« …Mais le monde est plein d’injustices », ai-je dit, reprenant sa dernière phrase. « Les gens souffrent partout de traitements inégaux et pourtant ils ne poignardent pas la personne la plus proche, responsable à leurs yeux leurs problème. »
Un lourd silence remplissait l’air. L’assistante du directeur, une jeune femme qui vivait à Jérusalem-Est, soupira et leva les yeux au ciel. Le directeur s’assit tranquillement sans changer d’expression. Peut-être pensait-il que je ne comprendrais jamais. Après tout, nous venions tous deux d’horizons différents. Je n’avais jamais connu la terreur d’une fouille nocturne ou la démolition de ma maison. Peut-être ne voulait-il pas entrer dans la polémique. Les attaques étaient de la légitime défense mais au bout de compte ils constituaient un crime.
Je n’ai pas cru, comme la plupart des Palestiniens me l’ont expliqué, que les coups de couteau étaient des actes de désespoir incontrôlés. Ces actes étaient délibérés, d’une nature dramatique et théâtrale. Les Palestiniens le voulaient ainsi. Ils ont tablé sur les images de violence pour dénoncer le conflit. Comme dans la tragédie de Shakespeare Macbeth, la violence était intime et avait l’intention d’infliger des dommages physiques et psychologiques aux juifs israéliens.
J’aurais voulu pousser le directeur dans ces derniers retranchements mais il fallait partir… Nous nous sommes séparés cordialement. Je me retrouvai dans le long escalier, dans la chaleur vive et chaude de la journée, et repris mon taxi.
Au point de contrôle pour Jérusalem-Est, je fus surprise de voir que mes mains tremblaient en tendant mon passeport. Devant nous, les soldats israéliens venaient juste de passer un long moment à inspecter un camion blanc géant. Ses larges portes avaient été ouvertes de sorte que tout l’intérieur soit exposé à la vue de tous. L’atmosphère de suspicion intense était omniprésente et j’étais convaincue qu’il y aurait un problème avec mon document.
« Où est le visa d’entrée ? », demanda d’emblée la soldate israélienne. C’était la petite feuille de papier rose donnée à l’aéroport, en lieu et place du tampon sur le passeport. Je l’avais laissée à l’hôtel. Avec le chauffeur, j’ai attendu dans un état d’anxiété et d’incertitude alors qu’elle consultait ses collègues. Nous nous sommes garés sur le côté et avons attendu ce qui nous a semblé une éternité avant qu’elle revienne et nous dise que nous pouvions y aller.
Alors que nous nous éloignions, j’ai pensé à cette étrange situation dans cette région du Moyen-Orient. Les jeunes Israéliens passent leurs soirées à patrouiller aux frontières à la recherche de voitures piégées plutôt que de dîner chez eux avec leur famille. Et des étudiants palestiniens passent des heures à faire la queue aux postes de contrôle où ils sont traités comme des terroristes par défaut avant qu’ils puissent aller en cours ou rentrer chez eux. Il n’y avait pas un bon côté ou mauvais côté. C’était simplement une tragédie au cours de l’histoire humaine.
À ce moment-là, la paix n’a jamais semblé aussi inaccessible en Israël et en Cisjordanie. Même affaiblis militairement, les Palestiniens continuent d’insister sur l’« empowerment », et en particulier sur la nécessité d’acquérir plus d’autonomie pour eux et aussi pour leurs institutions. «Sans savoir comment et quand les Israéliens quitteraient» ou dans le cas où leur propre État serait créé, ils pourraient acquérir leur propre identité nationale. Avant tout, il est important de conserver un sens de l’humanité: «Ils ont la bombe nucléaire, nous avons Mahmoud Darwisch (poète palestinien)», comme me l’a dit Shawan Jabarin.
Ce serait une erreur aujourd’hui de considérer le sort des Palestiniens du seul point de vue des frontières géographiques. A travers le nomadisme des Palestiniens en exil, on observe le même état de déplacement perpétuel ressenti par les milliers de réfugiés qui fuient la guerre en Syrie et en Irak. La cause palestinienne est incrustée sur la réalité d’aujourd’hui, d’où qu’on l’appréhende.
Dans l’impossibilité de traverser Israël, Kaied, mon interlocuteur, se trouve contraint de faire le voyage éreintant de dix heures à travers la Jordanie pour se rendre à l’étranger. Le même itinéraire était réservé à ses parents syro-palestiniens qui passaient par Amman pour se rendre à Paris en fuyant Alep. À travers eux, j’ai appris que l’imagination palestinienne vit et a une caractéristique unique: le désir de paix de son peuple et un effort désespéré de forger leur vie à l’image de leurs tapisseries traditionnelles, harmonieuses et symétriques et cela au sein de tout le chaos du monde.
(1) Entre 2006 à 2013, les FDI ont démoli plus de 1 600 structures non autorisées dans la zone C, ce qui a déplacé près de 3 000 Palestiniens.
Journaliste, revue Passages, collabore au Télégramme et à France24.
-
Sonya Ciesnikhttps://lepontdesidees.fr/author/sciesnikauteur/
-
Sonya Ciesnikhttps://lepontdesidees.fr/author/sciesnikauteur/
-
Sonya Ciesnikhttps://lepontdesidees.fr/author/sciesnikauteur/
-
Sonya Ciesnikhttps://lepontdesidees.fr/author/sciesnikauteur/




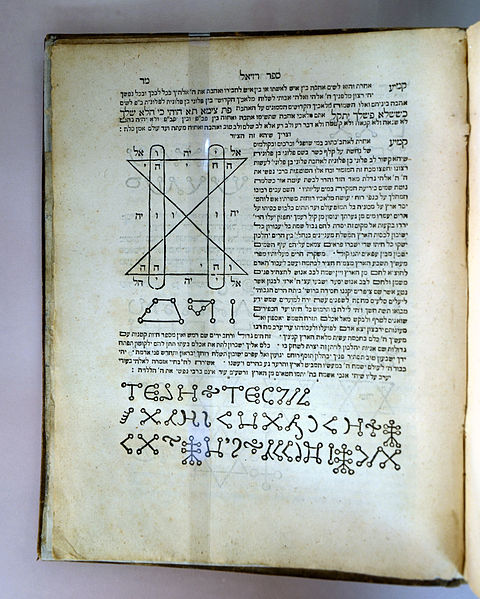


Responses