Mali : trancher le nœud gordien


Roland Pourtier
Souvenons-nous, c’était le 2 février 2013, le Président François Hollande en déplacement à Tombouctou jubilait, « Sans doute la journée la plus importante de ma vie politique ». Le Président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré, déclarait à l’unisson que « chaque Malien est reconnaissant à la France d’avoir répondu rapidement à leur appel au secours ». C’était il y a neuf ans.
Novembre 2020, le Président Macron déclarait « On ne discute pas avec les terroristes, on se bat ». Un an plus tard il ne fait guère de doute qu’il s’est rallié à l’idée d’une réorganisation sinon d’un retrait total des forces militaires françaises du Mali. Comment en est-on arrivé là ? Est-il envisageable de quitter le Mali sans remettre en cause la totalité du dispositif militaire français au Sahel ? L’heure n’est-elle pas d’une réévaluation radicale des orientations stratégiques de la France dans son ancien empire colonial africain ? Il n’est pas question ici de dresser un bilan de l’échec au Mali, cent fois établi, mais de soumettre quelques réflexions à un débat qu’on ne peut esquiver autour d’un conflit multidimensionnel d’une rare complexité.
Le film des neuf années écoulées repasse en boucle des images donnant chaque fois une impression de déjà-vu : militaires harnachés de technologie, décalés dans les paysages désolés du Sahel ; attentats meurtriers, Radisson Blu à Bamako, Ouagadougou et tant d’autres devenus routiniers ; éliminations de chefs terroristes aussitôt remplacés par d’autres ; cercueils dans la cour des Invalides, hommages aux morts pour la France en Opex, cinquante-trois fois répété.
L’expulsion, début février, de l’ambassadeur de France à Bamako scelle la fin d’une illusion : il ne peut y avoir de solution miliaire aux problèmes fondamentalement politiques, non seulement du Mali, mais de l’ensemble du Sahel. Ce n’est pas le rôle de l’armée de les régler. La chose n’est pas nouvelle, mais on tire rarement, les « leçons de l’histoire ». Ni le Vietnam, ni l’Algérie, ni, tout récemment l’Afghanistan n’ont servi de leçon. La France se trouve bel et bien dans l’«impasse», ou le «bourbier », au choix des figures de style lapidaires qu’affectionnent les médias pour résumer une situation en réalité très complexe.
Il est certes confortable, l’événement advenu, d’en donner les raisons, inversant le rôle de Cassandre. Il est pourtant vrai que l’élargissement de l’engagement militaire français au Mali à l’ensemble démesuré du « Sahel » avec la substitution en 2014 de Barkhane à Serval, a suscité maintes inquiétudes et réserves. Des chercheurs connaissant bien les réalités de terrain ont alerté sur les risques d’une telle décision, en expliquant pourquoi il ne pouvait y avoir de solution militaire à la crise globale des espaces saharo-sahélien.[1]
La déploration des 53 Français morts en mission tend à faire oublier que la guerre a fait des milliers, sans doute des dizaines de milliers de victimes africaines, une des causes du retournement de l’opinion publique contre la France rendue responsable de n’être pas parvenue à protéger les populations civiles après bientôt une décennie de présence qui, pour certains s’apparente désormais à une occupation étrangère. Au cours des deux dernières années, la situation sécuritaire s’est fortement dégradée, le nombre des attentats et des victimes a beaucoup augmenté. Le nouveau dispositif Katuba n’a pas fait ses preuves, les 13 000 Casques bleus de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) assistent, impuissants, à cette dégradation. La lassitude et l’exaspération envers les militaires étrangers est devenue palpable, leur bulle de technologie sophistiquée, de protection, de confort, contrastant violemment avec les conditions d’une population qui « souffre » au quotidien. L’armée française peut se féliciter de « neutraliser » tel ou tel chef djihadiste, comme Droukdel, ancien commandant d’AQMI en novembre 2020, ou Abou Walid-al-Sahraoui, chef de l’EIGS en août 2021, grâce au renseignement, à la traque numérique et aux drones, ces succès ponctuels ne suffisent pas à décapiter les mouvements terroristes qui, comme l’hydre, se régénèrent avec le soutien d’une large fraction de populations désemparées.
Ce Sahel géopolitique
Les travaux d’ACLED, The Armed Conflict Location & Event Data Project, apportent de précieuses informations sur le conflit : le rapport Sahel 2021 « Communal Wars, Broken Ceasefires and Shifting Frontlines », localise et cartographie les événements liés à la guerre. Cette vision géographique est importante, car ce qu’on appelle communément Sahel – mais qui est en réalité autant saharien que sahélien – couvre un immense espace de quelque 5 millions de kilomètres carrés qui est tout sauf homogène. Les conditions de la guerre comme les dynamiques socio-politiques varient selon les lieux. Les contextes locaux réagissent différemment à la crise structurelle globale de ce Sahel géopolitique. L’épicentre des conflits a glissé du Nord-Mali vers le Liptako Gourma, pays des « trois frontières » (Mali-Niger-Burkina Faso), aujourd’hui la zone la plus névralgique du Sahel, tandis que des métastases se projettent jusque dans les pays riverains du Golfe de Guinée (Côte d’Ivoire, Togo, Bénin) sans parler de Boko Haram qui, depuis vingt ans, a installé une insécurité durable au nord-est du Nigeria et dans les régions proches du lac Tchad. L’attentat du 8 février dernier au Bénin, dans le Parc du W, frontalier du Niger et du Burkina Faso, confirme la stratégie des mouvements djihadistes de déstabiliser l’ensemble de l’espace ouest-africain.
Le champ d’intervention militaire est aussi immense qu’hétérogène. 5000 militaires français, bientôt réduits de moitié, même secondés par le renseignement américain et le maigre apport de pays européens au sein de Takouba, ne sont pas en mesure de contrôler un espace étiré sur plusieurs milliers de kilomètres de N’Djamena à l’Azawad. Quand aux forces conjointes du G5 Sahel déployées sur le papier plus que sur le terrain, elles se sont montrées peu combatives, exception faite des contingents tchadiens, les seuls aguerris au combat. Débusquer des terroristes dispersés et mobiles sur un espace grand comme dix fois la France c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. Contrairement aux images des dépliants touristiques, le Sahara n’est pas un immense erg où le regard embrasse des étendues infinies, (sauf quand souffle l’harmattan, ce vent de sable qui obscurcit l’atmosphère et entrave les opérations terrestres et surtout aériennes). Il est aussi fait de reliefs rocheux burinés par l’érosion, aux parcours propices à la dissimulation, aux innombrables caches naturelles où entreposer armes et munitions. Les espaces sahéliens et sahélo-soudaniens, à la végétation arbustive et arborée se prêtent aux actions de guérilla. Les mouvements rebelles, de quelque nature qu’ils soient, tirent parti des particularités du terrain, en évitant le combat frontal. Très mobiles, ils savent se fondre dans la population. Ayant bénéficié du repli de milliers de combattants et du pillage des arsenaux libyens après l’élimination de Khadafi en 2011, ils disposent en abondance d’armes légères, dont la kalachnikov, emblématique des guerres africaines. Les réseaux de commerce, établis de longue date entre la Méditerranée et le golfe de Guinée, enrichis par des trafics de drogue florissants (pas uniquement dans le « narcot-État » qu’est devenue la Guinée Bissau), les pourvoient en armement et en munitions. L’insécurité entretient un commerce dont les réseaux se jouent de frontières particulièrement poreuses ; l’interpénétration des commerçants et des chefs politiques et militaires, à tous les niveaux de la hiérarchie, fait le lit d’activités illicites. Les véhicules motorisés ont en outre modifié les pratiques de la guerre. Depuis leur apparition en Afghanistan les « technicals », véhicules tout-terrain équipés de mitrailleuses, canons légers, mortiers etc… se sont invités dans les guerres africaines pour le plus grand profit de Toyota. Plus récemment, les motos, dont l’usage se répand à grande vitesse sont devenues l’auxiliaire logistique de tous les conflits. Leur capacité à se faufiler sur des terrains impropres aux véhicules lourds leur confère une grande mobilité, et une réactivité hors pair, favorisée par l’impossibilité de distinguer leur usage domestique de leur appui aux attentats. Enfin, les mines artisanales et engins explosifs rendent hasardeux les déplacements, y compris de véhicules blindés, avec pour conséquence une tendance au confinement des militaires, tant étrangers que maliens, dans des bases qui laissent le champ libre aux djihadiste dans le pays profond.
Dans ces conditions, la supériorité militaire française tient surtout à la maîtrise des airs et du renseignement numérique – lequel les rend toutefois dépendants des Américains. Davantage que le renseignement classique, c’est de plus en plus l’outil numérique qui permet de localiser les cibles, mais combien de mois ou d’années faut-il pour fixer une seule d’entre elles ? Il a fallu dix ans aux forces spéciales américaines pour dénicher et abattre Ben Laden. Les succès français au Sahara-Sahel dans la traque des chefs djihadistes restent ponctuels et n’ont qu’un effet limité sur des groupes ectoplasmiques capables de se réorganiser rapidement,
La maîtrise du ciel, renforcée par l’usage de drones de plus en plus performants, a ses limites, car la guerre se gagne in fine au sol. Les forces djihadistes ne disposent certes pas d’une puissance de feu comparable à celle des troupes françaises, mais elles sont en mesure d’annuler les bénéfices de leurs opérations en multipliant les attentats contre les points faibles du dispositif que sont les forces armées maliennes, et contre les populations civiles en appliquant la stratégie de la terreur. La vraie raison de leurs succès n’est pas dans les armes mais dans l’état d’esprit, l’acceptation de la mort, le sacrifice suprême au service de leur cause, y compris en recourant aux attentats-suicides. Le feu sacré est du côté des rebelles, pas des étrangers qui prônent une guerre « zéro mort » et ne vont au combat qu’assurés de leur supériorité technique. Pas plus que de ceux qui ne s’engagent dans l’armée nationale que pour y trouver un moyen d’existence. Les débâcles successives de l’URSS et des États-Unis en Afghanistan devraient servir de garde-fou, mais ce n’est pas le cas.
Instabilité politique
L’intervention militaire française au Mali, à la demande de Bamako, conformément aux accords de défense et avec l’aval des Nations Unies aurait dû être de courte durée avant d’être relayée par une armée malienne qu’il faudrait entre temps remettre sur pied. Des années d’instruction militaire et d’investissement n’ont pas eu les résultats escomptés. Minée par la corruption et l’absence de discipline, les Forces armées maliennes (FAMA) n’ont pas été à la hauteur de leur mission. Elles en ont payé le prix fort. Démoralisées, humiliées, elles seront le bras armé du coup d’état d’août 2020 qui renversa le régime d’Ibrahim Boubakar Keïta considéré comme responsable de leurs déboires, et de celui de mai 2021 qui a porté au pouvoir Choguel Maïga. Ces soubresauts politico-militaires ne sont pas isolés. Ils affectent une partie de l’Afrique de l’Ouest et s’inscrivent dans une vague de contestation des pouvoirs en place, voire dans une remise en cause d’un ordre constitutionnel qui n’est plus en phase avec les évolutions socio-politiques. Le putsch de janvier 2022 au Burkina Faso, sans être une réplique de ceux du Mali, participe de ce contexte. Le désarroi militaire n’est qu’un élément d’une crise plus générale dont témoigne le coup d’état en Guinée qui, en septembre 2021, a renversé Alpha Condé, ou plus récemment la tentative manquée de coup d’état en Guinée Bissau en janvier 2022. L’élimination en avril 2021 d’Idriss Déby, probablement par son entourage militaire, après trente ans de règne, relève de cette instabilité générale qui, dans ce cas d’espèce s’articule à l’engagement militaire tchadien dans le combat contre Boko Haram dans la région du lac Tchad.
La compréhension des soubresauts actuels du Sahel impose le recours à la profondeur historique. Le Sahel, « rivage » en arabe, par définition terre de contact, a toujours vécu dans l’insécurité, climatique ou politique. La guerre actuelle ne déroge pas à ce schéma d’affrontement séculaire de populations, les unes paysannes et sédentaires sur son flanc sud, les autres pastorales et mobiles dans ses franges sahariennes. Sociétés ancrées dans le terroir d’une part, sociétés mobiles d’autre part, la compétition pour l’accès à la terre et à l’eau a de tout temps été le ferment des conflits locaux.
Pendant des siècles, les peuples pasteurs (Maures, Touaregs, Peuls) ont dominé les sédentaires (Dogon, Bambara etc.). Au cours de leurs razzias, ils réduisirent en esclavage des villageois, transférés dans les oasis pour y travailler la terre (Harratins, aujourd’hui salariés agricoles) ou dans les campements des nomades (Iklan, Bella) pour s’occuper des trouoeaux. Les conflits d’aujourd’hui réactivent la mémoire des violences d’antan. Au Mali, les Peuls d’une part, les Dogons et les Bambaras d’autre part, se sont rendus coupables ces dernières années de massacres réciproques. Aux exactions de la Katiba Macina dirigée par le prédicateur peul Amadou Koufa, a répondu le massacre, par des miliciens Dogon, des Peuls du village d’Ogossagou, près de Mopti, en mars 2019. La paix coloniale avait apaisé les tensions entre communautaires. Les Dogon, autrefois repliés sur la falaise de Bandiagara pour échapper aux razzias des esclavagistes, avaient alors réinvesti les plaines du Gourma. Les crises climatiques des années 1970-1980 poussèrent les pasteurs peuls à rechercher des pâturages dans ces espaces de reconquête agricole des Dogon, provoquant d’inévitables conflits.
La question foncière est centrale dans la genèse des conflits saharo-sahéliens, beaucoup plus que les affiliations religieuses. Elle se pose dans l’ensemble du Sahel, doublement affecté par la péjoration des conditions climatiques (raréfaction des ressources en pâturage et en eau suite à des épisodes récurrents de sécheresse), et surtout par une croissance démographique insoutenable, la plus forte au monde dans les pays les plus pauvres du monde. Dernier pays sur l’échelle du développement humain, le Niger détient le record mondial de fécondité (6,8 enfants par femme), le Mali, le Burkina et le Tchad n’étant pas loin. Hors d’Afrique, le taux le plus élevé – ce n’est pas un hasard- est celui d’Afghanistan (4,3 enfants par femme). La corrélation entre conflits et fécondité n’est pas fortuite, dès lors qu’une croissance démographique incontrôlée attise la compétition entre groupes ethniques pour l’accès aux ressources naturelles.
Le djihadisme se nourrit de ce terreau sur lequel se greffent les appartenances confessionnelles : éleveurs nomades islamisés d’un côté, agriculteurs villageois animistes ou christianisés de l’autre. Ce contexte conflictuel africain n’a aucune incidence directe sur la sécurité de la France. Il n’est pas comparable de ce point de vue au conflit syrien qui a vu un grand nombre de musulmans français aller combattre au côté de Daech. La justification de l’intervention de la France au Sahel au nom de sa sécurité intérieure ne résiste pas à l’analyse. En engageant l’armée française au Mali, François Hollande restait dans la ligne des relations habituelles de la France avec ce qui reste de son pré carré.
Après le succès éclair de Serval, Barkhane, porté par une représentation passéiste des relations franco-africaines, était promu à l’enlisement, faute d’une vision stratégique prospective, et de perspectives de résolution des problèmes structurels du Sahel. L’impossible mission militaire a eu comme résultat inéluctable un rejet populaire de la présence française perçue comme une survivance de la domination coloniale. Le ressentiment antifrançais habilement exploité fait toujours recette. Les bénéfices du discours de Ouagadougou du président Macron en novembre 2017 se sont volatilisés, la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel laissant planer le doute sur la sincérité de ses intentions.
Les pouvoirs maliens aux abois cherchent une sortie dérobée en faisant de la France un bouc émissaire qui les dédouanerait de leur impéritie. L’argument du néocolonialisme, a nouveau recyclé, laisserait accroire que la France manœuvre afin que le Mali soit mis au ban des nations en faisant pression sur les organisations régionales supposées lui être inféodées comme l’UEMOA, coupable d’entraver le passage du franc CFA à l’Eco, et la CEDEAO. Il est vrai que cette dernière, tout comme l’Union européenne et plus généralement la « communauté internationale » a pris position contre la junte quand celle-ci a ouvertement défié les principes de ce qu’il est convenu d’appeler la gouvernance démocratique en repoussant aux calendes grecques les échéances électorales. Cherguel Maïga dénonce le « deux poids deux mesures », puisque Paris a cautionné le troisième mandat d’Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire et donné son onction à la succession au Tchad de Mahamat Idriss Déby à son père assassiné, sans être trop regardant sur le respect des normes constitutionnelles.
Les mercenaires de Wagner
Le contentieux entre Paris et Bamako s’est naturellement aggravé quand la décision a été prise unilatéralement de réorganiser Barkhane en réduisant ses effectifs. Le paradoxe est que la France est accusée contradictoirement de vouloir imposer des relations néocoloniales, et en même temps de réduire son dispositif de défense du territoire malien contre les djihadistes – un « abandon en plein vol » comme le déclara à la tribune de l’ONU le chef de la junte. Celle-ci s’est tout naturellement tournée vers la société Wagner dont on peut supposer qu’elle n’attendait qu’une telle occasion pour déployer ses activités africaines en proposant sa protection. Les mercenaires de Wagner, faux nez du Kremlin, n’ont aucune chance – ni l’objectif- de régler les problèmes de fond du Mali, pas plus qu’ils n’ont réglé ceux de la RCA. Ils ne sont là, quelques centaines, on ne sait trop, que pour avancer les pions de la Russie de Poutine qui cherche à regagner une influence en Afrique, perdue depuis la fin de l’URSS, en profitant de l’effacement de la France. Les recettes de l’État malien, tirées de l’exploitation de l’or (plus de 70 tonnes produites en 2020) paieront les mercenaires, et Wagner cherchera probablement des compensations à ses prestations en devenant acteur du secteur minier aurifère.
Dans ce contexte labile, la réorganisation du dispositif militaire français au Mali a été annoncée sur France Inter par Jean-Yves Le Drian le 10 février, sans qu’on en connaisse encore le format. La nature ayant horreur du vide, il est probable qu’un retrait laisserait le champ libre aux mouvements djihadistes, en particulier à ses deux principaux groupes rivaux.
D’une part, le « Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans » (GSMI), formé en 2017 par le regroupement de 4 groupes (Ansar Dine, al-Mourabitoun, Katiba Macina et Katiba al-Furquan), fortement implanté dans le nord et le centre du Mali. La coalition est dirigée par Iyad ag Ghali qui dirigea la rébellion touarègue de 1990-1996 à la tête du Mouvement populaire pour la libération de l’Azawad (MPLA). Le GSMI, affilié à AQMI, Al Qaida au maghreb islamique, compte dans ses rangs un grand nombre de Touaregs et de Peuls.
D’autre part, le groupe « État islamique au Grand Sahara » (EIGS) dont le chef Abou Walid-al-Sahraoui a été tué par l’armée française en août 2021. Très actif dans la région des trois frontières, il est principalement constitué de Peuls. Contrairement à GSMI il a fait allégeance à Daech.
Les affrontements sont fréquents entre GSIM et EIGS, souvent pour des questions de préséance ou de contrôle foncier. Ils le sont aussi entre leurs affiliés, pas forcément islamistes mais toujours musulmans, et les diverses organisations de défense ou milices villageoises recrutant parmi les populations animistes ou chrétiennes. Un desserrement de l’encadrement militaire en cas de retrait de Barkhane, créerait sans aucun doute des situations localement chaotiques, voire remettrait en cause l’organisation territoriale du Mali. Mais n’est-il pas temps de laisser l’histoire africaine se dérouler sans la tutelle de puissances extérieures, selon son rythme et ses choix de modèles politiques alternatifs ?
La crise du Sahel soulève en effet un problème de fond : celui de la légitimité d’imposer un modèle politique à prétention universelle, à des sociétés dont les pratiques sociales ne répondent pas forcément au système de valeur qui sous-tend cette « universalité » dont les Français en particulier sont friands, mais qui n’est qu’une vision occidentalo-centrée, forgée par une histoire spécifique dans un cadre géographique spécifique. La crise du Sahel pose clairement une question qui n’est pas sans rappeler l’argumentaire de la colonisation, justifiée au nom de la « civilisation ».
Le djihadisme, plus qu’un mouvement religieux, peut être interprété comme une réaction de rejet d’un modèle de civilisation étranger. Il n’est pas interdit de s’interroger sur la pertinence des modèles politiques adoptés lors des indépendances africaines, que ce soit dans le droit fil des démocraties occidentales ou des régimes se réclamant du marxisme. Le Mali, ne l’oublions pas, a connu cette expérience avant de revenir dans le giron démocratique où il fut un temps exemplaire. S’interroger pour savoir si les legs hérités de la colonisation (intangibilité des frontières proclamée par l’OUA en 1963, principes fondateurs d’un État de droit) répondent aux trajectoires propres des sociétés africaines ne devrait pas être un tabou.
L’histoire du monde montre qu’il n’y a jamais eu de gel ni des configurations géopolitiques, ni des formes du politique. L’illusion de Fukuyama d’un triomphe définitif de la démocratie libérale après l’effondrement de l ’URSS a fait long feu, les fracas du monde l’ayant brutalement démenti. Il n’y a pas de « fin de l’histoire ». La partition du Soudan en 2011 a été un premier accroc significatif à un ordre territorial qui semblait immuable dans un laps de temps en réalité minuscule. La sacralisation des frontières, fussent-elles considérées « artificielles et arbitraires » va à contre-courant de l’histoire qui, par définition, est mouvement et recomposition. Il est vrai que les États institués redoutent toujours le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », porteur de risque d’amputation territoriale et de remise en cause d’un ordre rassurant pour les puissants. Au nom du droit, ils récusent un autre droit. Pourtant, quoi de plus légitime que la revendication des Touaregs à un territoire ? La question de la démocratie et celle du territoire se rejoignent.
Le Sahel illustre la fragilité congénitale de « l’État importé » selon les analyses de Bertrand Badié. La « greffe de l’État » a du mal à prendre quand un pouvoir s’échine à imposer des normes qui ne se nourrissent pas de la sève humaine. Quand les politistes parlent d’«État failli », ils s’intéressent aux aspects institutionnels sans s’interroger sur le bien-fondé du modèle, ou sur le sens d’un mimétisme formel qui réduit la démocratie à une liturgie électorale, et à une litanie abstraite des droits de l’homme et du citoyen.
Fruit de l’histoire de la colonisation et du partage du continent, les États africains sont tous pluri-ethniques. La notion même de « citoyen » qui n’a à vrai dire de sens que dans l’héritage de la Révolution française, n’en a guère dans celui de sociétés construites en fonction de la place de l’individu dans un groupe de proximité généalogique, qu’il s’agisse du lignage ou du clan, ou de leur élargissement à l’ethnie. La nation vient de surcroît quand elle parvient à subsumer les particularismes ethniques. Dans le cas du Mali, associer pacifiquement des populations historiquement et culturellement antagonistes n’est envisageable dans la durée que dans le cadre d’un État accordant la plus large autonomie à ses différentes composantes territoriales. C’est envisageable dans le cas des Touaregs de l’Azawad, plus difficile ailleurs étant donné l’imbrication des éleveurs, principalement la nébuleuse Peul, et des agriculteurs. Seuls des accords à l’échelle locale, peuvent garantir une cohabitation pacifique, comme ce fut longtemps le cas avec une gestion coutumière de l’accès aux ressources, du partage du territoire, et du règlement des conflits. Un État de fonctionnaires ne le permet pas. C’est pourquoi une solution à la crise sahélienne passe par une réforme radicale de l’État, ce qu’aucune action militaire n’est évidemment en mesure de réaliser.
Le principe électoral considéré comme constitutif d’une démocratie qui voudrait qu’un homme égale une voix, n’est pas en phase avec des sociétés fondées sur des communautés. Bien des conflits sont nées de l’inadéquation entre nombre et démocratie, et de l’application irréfléchie de la règle selon laquelle the winner takes all. La démocratie électorale, au demeurant de plus en plus contestée dans les sociétés occidentales qui voient les populations se détourner massivement des urnes, ne répond pas au mode d’organisation et d’exercice du pouvoir des sociétés africaines. Ce n’est pas leur faire injure de penser qu’elles pourraient expérimenter d’autres modèles politiques que ceux que leur ont légué les puissances coloniales, au risque de faire face à des recompositions territoriales allant de pair avec une réévaluation du fonctionnement de l’autorité publique.
Cette question cruciale de l’État se pose, non seulement au Mali, mais dans l’ensemble du Sahel et, peut-on dire, de l’Afrique noire. Le déplacement du centre opérationnel français du Mali au Niger n’y changera rien. Le maintien d’une force militaire qui mène un combat biaisé contre un ennemi largement imaginaire est non seulement contre-productif en termes d’influence politique, mais sans issue car rien n’empêchera les Africains d’être les acteurs pivots de leur propre histoire. Il suffit pour en être convaincu d’observer les courbes de la croissance démographique. C’est elle qui, au bout du compte, tranchera le nœud gordien.
Roland Pourtier est Professeur émérite des Universités, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer.
[1] Parmi eux, Marc-Antoine Pérouse de Montclos, notamment, L’Afrique nouvelle frontière du djihad ?, La Découverte 2018, et Une guerre perdue. La France au Sahel, J.C.Lattès, 2020.
Professeur émérite des Universités, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer
-
Roland Pourtierhttps://lepontdesidees.fr/author/rpourtierauteur/
-
Roland Pourtierhttps://lepontdesidees.fr/author/rpourtierauteur/





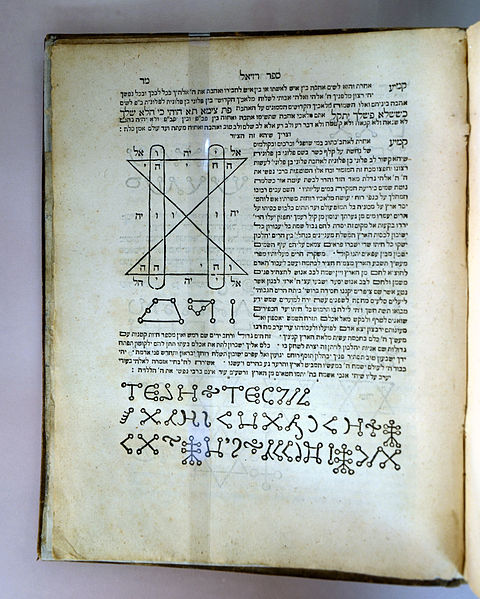

Responses