La haine du bourgeois fait toujours recette

Dans un livre terriblement lucide, « Les origines », le sociologue Gérald Bronner décrit le complexe des « pauvres » qui ont réussi. Comme la Nobel Annie Ernaux, nombre d’entre eux méprisent à la fois la bourgeoisie et le peuple.
Longtemps, Gérald Bronner, professeur à la Sorbonne et membre de l’Académie de médecine, crut appartenir à un monde d’exception : ni bourgeois ni paysan ni prolétaire mais intellectuel. Lorsque, né au lendemain de mai 1968 dans une famille modeste, il fréquente l’école publique à Nancy, son brillant parcours scolaire l’incite à se croire « membre d’une forme d’aristocratie ». Il lui faudra quelques années pour prendre conscience de sa « différence » sociale et réfléchir sur « le mystère insondable des origines ». Quelques années encore pour disséquer ce « sentiment de honte du milieu » avoué parfois par des auteurs comme Didier Eribon, mais le plus souvent refoulé…à moins qu’il ne soit, au contraire, exagéré jusqu’à l’outrance par Annie Ernaux ou Edouard Louis dans leurs souvenirs réinventés. Jamais, en tout cas, le phénomène de falsification de ses véritables origines, pas toujours enjolivées pour se vanter mais parfois noircies à dessein comme pour se faire pardonner une réussite sociale qui suscite des jalousies, n’avait été décrit avec autant de lucidité. Car Bronner n’est dupe d’aucune illusion ou posture.
Le complexe des « transclasses »
Dans son précédent livre, « Apocalypse Cognitive » (Puf , Prix Aujourd’hui 2021), il étudiait l’emprise des petits écrans sur nos enfants. Il prédisait les retards scolaires et donc, les inégalités sociales qui allaient en résulter, alors que les grands-parents pouvaient rêver d’une nouvelle ère de temps libre à consacrer non seulement au sport mais au développement de l’intelligence et des savoirs. Dans son nouvel ouvrage « Les origines – Pourquoi devient-on qui l’on est ? », Bronner analyse les raisons apparemment obscures pour lesquelles certains individus enjolivent leur enfance et s’inventent des ascendants flatteurs tandis que d’autres, non moins vaniteux, mentent autrement : en noircissant le tableau de leur village et de leur milieu social et en dépeignant leurs propres parents sous des traits grossiers. Leur mal commun porte un nom : la honte. « Honte de quoi ? » s’interroge l’auteur. De la manière dont on est regardé lorsque l’on accède à certaines catégories sociales sans en avoir les codes : la façon de se vêtir, de parler, de se nourrir ou même de se tenir dans une pièce ferait honte à ces « transclasses » qui auraient assez de lucidité pour percevoir la moquerie implicite… » Bronner se garde de rien affirmer. Mais il n’est pas loin de voir, sous cette honte trop longtemps affichée, une forme d’imposture.
Une enfance inventée
Voyez Edouard Louis, enfant d’un village de la Somme. Il n’a que 21 ans lorsque, ayant obtenu une bourse et poursuivi des études de sociologie, il publie son premier livre « En finir avec Eddy Bellegueule » (Seuil) où il raconte une enfance cauchemardesque, dans un milieu homophobe gagné par l’alcoolisme et la misère. C’est un énorme succès, qui lui vaudra le Goncourt du premier roman. Mais sa marraine, qui se souvient de lui avoir offert les droits d’accès à l‘université, est humiliée, comme ses parents et son village tout entier, par « ce tissu de mensonges… » Bronner cite Le Courrier Picard : « Installée dans un pavillon propret à l’entrée d’Hallencourt, la vraie famille d’Edouard Louis n’a, à première vue, pas grand-chose à voir avec celle à la Germinal, misérable, inculte et vulgaire, décrite dans son roman ». Le romancier finira par en être gêné. Quatre ans plus tard, il publiera, sous le titre « Qui a tué mon père » (Seuil) un bref plaidoyer pour ce père, décrit auparavant par lui comme un minable. En chargeant, cette fois, une élite – la sienne ! – coupable de mépriser les braves gens.
On trouve dans le livre de Bronner bien d’autres cas, français ou étrangers. Mais le portrait qui retient le plus notre attention est évidemment celui d’Annie Ernaux.
Un homme d’hier, une femme d’aujourd’hui
Depuis de nombreuses années déjà, son statut de professeure agrégée de lettres mariée à un haut fonctionnaire, puis divorcée, et la vente de ses livres de féministe de gauche assuraient à cette fille de petits commerçants normands, dont on croyait qu’elle avait grandi elle aussi dans la misère, une vie de grande bourgeoise. A 82 ans, première Française Prix Nobel de Littérature, couverte d’honneurs, Annie Ernaux ne renie pas ses engagements : on l’a vue, le 16 octobre dernier, défiler place de la République au côté du fondateur de la Nupes – ce qui n’allait pas l’empêcher, interrogée sur Adrien Quatennens, de déclarer cruellement (dans Libération le jour de Noël) « Quand Jean-Luc Mélenchon l’a soutenu, c’est l’homme d’hier qui a parlé ». On l’a vue aussi, le mois dernier, signer dans « Politis » une tribune contre une réforme des retraites « archaïque et terriblement inégalitaire ». Personne n’a songé à lui reprocher cette fidélité. Mais pourquoi, alors qu’elle eut la chance de se voir, adolescente, offrir par une mère dépeinte par elle sous des traits vulgaires, des déjeuners au restaurant et des livres comme « Autant en emporte le vent », n’avoir pas cessé, dans tous ses ouvrages, depuis « Les Armoires vides » jusqu’à « la Honte », de décrire un milieu d’origine – le sien – aussi misérable ? Son récent film « Les Années Super Huit » réalisé avec son fils David, nous la montre pourtant, jeune femme élégante et hautaine, faisant du ski à la Clusaz ou passant quelques semaines en famille dans un bel hôtel sur une plage du Maroc. Son dernier livre « Le jeune homme » (Gallimard, décembre 2022) dresse, lui, le portrait cruel d’un jeune amant qui ne sait pas se tenir à table et s’essuie la bouche « comme un plouc » avec un bout de pain. Et cependant, la grande bourgeoise qu’est devenue Annie Ernaux s’acharne, dans la presse comme dans son discours de Nobel, à vouloir « venger ma race dont l’opposé, dit-elle dans une interview à Libération, est la bourgeoisie incarnée par les filles du Havre ». En lisant cela, on songe aux « tricoteuses » de la Révolution, mais aussi à ce jeune élu LFI tout fier de shooter dans un ballon orné de la tête coupée d’un ministre…. Mais ce dernier ignorait peut-être encore ce que sait Annie Ernaux : à quel point la haine sociale est un poison. ♦
(Gérald BRONNER « Les Origines » Pourquoi devient-on ce que l’on est ? » Autrement, Flammarion. 2023)
Journaliste et écrivaine
-
Christine Clerchttps://lepontdesidees.fr/author/cclercauteur/
-
Christine Clerchttps://lepontdesidees.fr/author/cclercauteur/
-
Christine Clerchttps://lepontdesidees.fr/author/cclercauteur/
-
Christine Clerchttps://lepontdesidees.fr/author/cclercauteur/




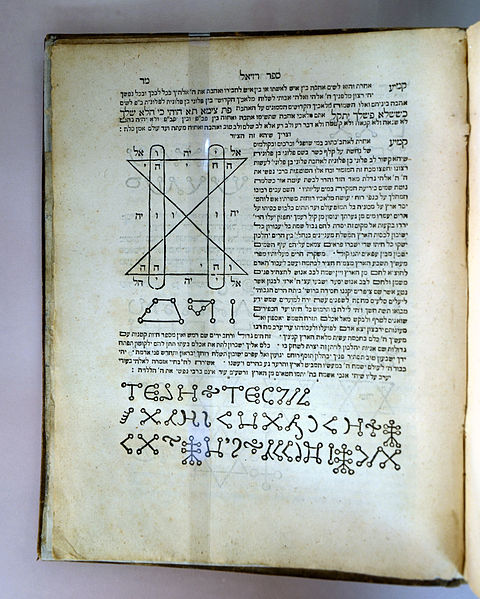


Responses